Victor Barrucand
LA VIE VÉRITABLE DU CITOYEN JEAN ROSSIGNOL
Vainqueur de la Bastille et Général en Chef des
Armées de la République dans la guerre de Vendée
(1759-1802)
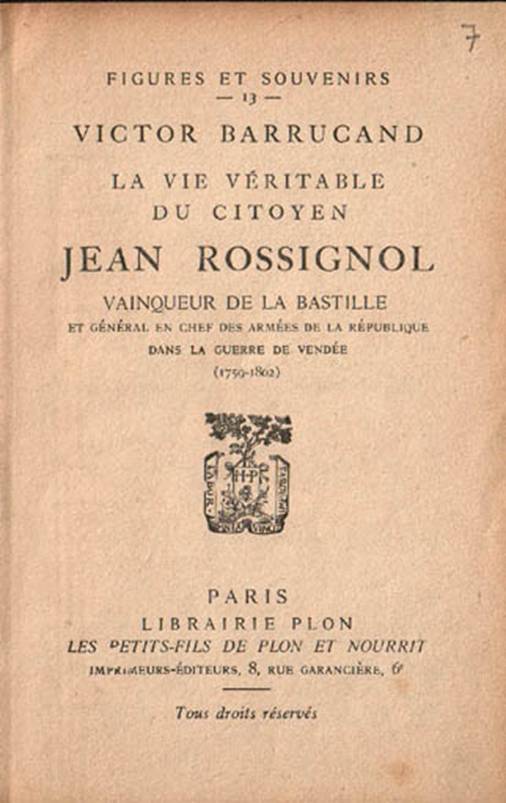
Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/
Table des matières
LA DÉPORTATION ET LA MORT DE ROSSIGNOL
À propos de cette édition électronique
PRÉFACE
Encore des mémoires touchant intimement à l’histoire de la Révolution poursuivie jusqu’à la domination consulaire, mais des mémoires d’extrême-gauche, par conséquent, plus rares, car les ouvriers de la Révolution maniaient mieux la pique que la plume. Beaucoup d’entre eux quittèrent du reste la scène au fort de l’action, sans avoir eu le temps de juger les événements et de se convertir aux régimes successifs. Ils se faisaient sans doute une haute idée de leur œuvre, une idée trop nette même et sans nuances, c’est pourquoi ils eussent été bien empêchés d’en écrire avec esprit et de mettre en bonne place le bloc qu’ils avaient dégrossi à coups de hache. Le peuple n’écrit d’ordinaire ses mémoires qu’en édifiant ou en détruisant ; il s’attelle aux rudes besognes historiques en y croyant comme aux travaux de la terre, prend pour lui la peine, laisse à d’autres la gloire et les profits de l’aventure, et s’en remet à l’histoire du soin de le trahir. Mais si, pour quelque raison que ce soit, il s’essaye à parler avec des mots, il est bien évident que la critique voulant être compréhensive doit oublier toute infime rigueur, s’humaniser, et, sans indulgence, s’élever à quelque hauteur philosophique, pour apprécier la juste valeur des motifs qui ne s’expriment pas et qui font agir.
D’ailleurs, la psychologie historique encore incertaine reconnaît dans toute contribution à un fait une valeur de touche que les conséquences générales n’altèrent pas : les choses et les hommes valent par eux-mêmes, en dehors de toute synthèse. Par ces notations à vif, par ces touches individuelles que recherche la méthode nouvelle et qui sont comme des plaques sensibilisées plus immédiates que les clichés de jadis, par la multiplicité des apparences successives dont elle tient compte, le sang du passé remonte sous le masque de la froide vérité acceptée et souvent la transfigure. Mais en même temps, et pour ces raisons, la chronique d’hier reste mystérieuse ; et, pour ne parler que d’un relief mémorable, devant un examen plus attentif, les aspects de la Révolution perdent leur rigueur logique, les noms impérieux de la Montagne s’atténuent et, comme au chaos des nuages, l’esprit inquiet demande à la foule le secret des illuminations soudaines.
Que savons-nous des véritables auteurs de cette révolution par laquelle on jure, et qui a ses prêtres, ses docteurs et ses pharisiens ? Presque rien que des calomnies et des injures. L’étude des clubs et des motionneurs, la sensibilité des foules excitées par le sang et la famine, le hasard des stratégies populaires, l’inspiration des démagogues et la folie d’une race débordée déroutent une opinion rectiligne. Il devient difficile de prouver quelque chose, même la raison du peuple, dès qu’on scrute ces dessous : l’instinct collectif, la contagion de l’exemple, l’irresponsabilité, le réveil atavique des massacres dans le sang des journées chaudes ; en vertu de telles circonstances à jamais inconnues, les mots et les émotions s’opposent ou s’exaltent ; et tout est possible et tout est douteux, avec ces facteurs d’énergie, l’hallucination du danger et la naïveté des masses.
C’est en somme le système du mouvement impersonnel donnant une science plus compliquée, et plus vraie sans doute, à cause des centres et des foyers innombrables, véritable tourbillon où la théorie des grands hommes s’efface.
L’intérêt d’une telle décentralisation historique apparaît un peu frivolement dans le succès de certains mémoires ; mais cette vogue à tout prendre n’est pas insignifiante si le défilé des personnages de second plan modifie nos idées sur le passé appris, et si la vie contemporaine s’en trouve influencée autant et mieux peut-être que par des lectures romanesques.
Rossignol dont nous publions les Mémoires est-il donc un de ces personnages écoutant aux portes des salons et des chancelleries, potinant sur les choses vues et sur les hommes rencontrés ?
Plus curieux son rôle est peut-être unique. Si Rossignol avait eu le tempérament littéraire, ses mémoires composeraient plusieurs tomes car il fut toujours mêlé aux actions de son temps et les suscita parfois ; mais il n’a pas le sentiment des nuances et des proportions ; le moindre incident de sa vie d’atelier ou de garnison a pour ce batailleur plus d’importance que le récit d’une bataille rangée. Irrespectueux et naïf, insoumis et brave, non sans vantardise, ridicule souvent, entêté jusqu’à l’inconscience et parfois énergique jusqu’au frisson, Rossignol est une étonnante personnification de ce peuple de Paris qui fit les grandes journées ratifiées par les constitutions. Il semble que sa robustesse franche, où les défauts s’accusent sans honte, explique l’âme obscure de la Révolution, non pas la vie des assemblées, mais l’émotion d’un peuple s’essayant à la liberté avec des gaucheries et des cataclysmes. Sans effort et sans pose qui ne soit naturelle, ce compagnon orfèvre devient nécessairement général quand la foule a pris la tête du mouvement révolutionnaire ; sans se guinder il atteste ainsi le rôle du peuple qu’il ne peut pas trahir sans se trahir lui-même. Ses mémoires ont à ce titre une importance autre que littéraire et vraiment typique.
Le 12 juillet 89, Rossignol, c’est lui-même qui le dit, ne savait rien de la Révolution et ne se doutait en aucune manière de tout ce qu’on pouvait tenter, et le 14 il était avec ceux qui prenaient la Bastille ; dans la démonstration d’octobre, il était à Versailles avec les femmes et les masses indisciplinées qui réclamaient à Paris le Boulanger, la Boulangère et le petit Mitron ; délégué par la section des Quinze-Vingts à la commune insurrectionnelle, il était à la journée du Dix-Août ; son nom figure sur les registres de la Force parmi ceux des magistrats du peuple envoyés pour calmer l’effervescence, qui firent acte de présence aux exécutions de septembre et ne purent rien empêcher. Le cahier de ses mémoires qui intéresse le Dix-Août et les Journées de Septembre a disparu, à l’instigation sans doute de Fouché.
On retrouve Rossignol, « l’enfant du Faubourg », partout où l’exaltation populaire s’affirma sans mesure. Il était en Vendée presque au début de la guerre opposant le fanatisme du nouveau dogme patriotique à la superstition séculaire ; d’accord avec les « exagérés » à moustaches de la cour de Saumur comme avec les hébertistes et les enragés de Paris, il poursuivait l’exécution des plus grands desseins : avec eux, la guerre civile tendait à devenir guerre de religion ; ils avaient eu l’intention de déchristianiser la France, et d’ailleurs ils « sanctifiaient » les excès de la démagogie par l’espoir entrevu d’une rénovation sociale qui manqua avec ses inspirateurs, quand prévalut par tant de ruses la politique des « hommes d’État ».
Plus favorisé par les succès de son parti que par ses luttes personnelles, bien qu’il fût brave à l’excès et doué d’un rare esprit naturel – mais les meilleurs généraux éprouvèrent des défaites en Vendée, – Rossignol apparaît toujours fidèle à son caractère, et ce que nous savons de la péripétie de sa fortune et de la fin tourmentée de sa vie concentre beaucoup d’intérêt et de grandeur sur le front vulgaire de ce combattant aux prises avec la fatalité. Après avoir connu les honneurs militaires, les acclamations de la Convention, les applaudissements des tribunes et la confiance inébranlable du Comité de salut public, après avoir conduit des foules et des armées, Rossignol, « le fils aîné de la patrie », fut le jouet des successives réactions post-thermidoriennes qui, de chute en chute, précipitèrent la République aux mains de Bonaparte. Il avait été des premiers combattants révolutionnaires et tomba le dernier. Acquitté dans le procès fait aux babouvistes, participant de près ou de loin à tous les mouvements du Faubourg, tant qu’il resta un espoir d’aboutir il fut un démagogue infatigable ; et, même à l’heure des défections obligées, il se résignait mal au culte naissant de César. Pendant plus d’un an il attendait à Toulon une occasion de s’embarquer, sans mettre aucun empressement à rejoindre en Égypte le général Bonaparte, comme il en avait reçu l’ordre du Directoire. La nostalgie du Faubourg le retenait, et sans doute gardait-il encore cette répugnance de sa jeunesse à faire la guerre « à des gens qu’il ne connaissait pas ». Sa santé était du reste ébranlée, il demanda la permission de retourner à Paris « pour y respirer l’air natal » et l’obtint ; mais Paris silencieux, oublieux des grands principes et tendant aux sommeils du despotisme, n’était plus pour lui le chef-lieu du monde ; un ordre de police l’en éloigna du reste bientôt, au moment où, convaincu de son impuissance à lutter contre le courant nouveau, « il passait ses journées sur la rivière à pécher à la ligne ». Retiré près de Melun, il n’aspirait plus qu’au repos ; dans sa petite maison des champs, il allait rappeler près de lui sa femme et sa fille, restées à Toulon, et déjà n’était plus que « Monsieur Durand », quand l’attentat royaliste de la rue Saint-Nicaise fut pour Bonaparte un facile prétexte à se débarrasser des républicains compromis qui restaient en France. La liste promulguée en vertu du sénatus-consulte du 14 nivôse an IX, portait cent trente-deux noms arbitrairement choisis. Sans autre forme de procès et sans plus attendre, soixante et onze d’entre eux furent déportés aux îles Seychelles. Quelques mois après une nouvelle proscription coloniale, voulue à l’Île-de-France par des propriétaires négriers, frappait au hasard trente-trois de ces malheureux, dont Rossignol, et les conduisait sur l’îlot insalubre d’Anjouan, où ils moururent presque tous en peu de jours dans les plus atroces souffrances. Leurs incroyables misères et la grandeur d’âme de Rossignol nous sont attestées par l’architecte Lefranc, « l’une des deux seules victimes qui aient survécu à la déportation ».
Rossignol mourut à Anjouan en 1802. Mais le peuple refusa de croire à la mort de son héros : il semblait que ce fût le suicide du Faubourg. Rossignol se survivait donc dans les souvenirs, et il prenait position dans la légende avec un mauvais roman en quatre volumes : LE ROBINSON DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE. Au frontispice de ce roman, le général plébéien est représenté, comme fondateur d’une république nouvelle en des Indes imaginaires, avec un diadème de plumes farouches. Ainsi, « finalement il arriva au port de Utopie, distant de la ville des Amaurotes par trois lieues ».
La conduite du général Rossignol en Vendée, comme celle de tous les généraux hébertistes, a été mal appréciée par des historiens qui jugeaient les passions de loin. L’opinion du général Turreau consignée en ses « Mémoires pour servir à l’histoire de la Vendée », est plus près de la vérité et des motifs intérieurs qui présidèrent à la destinée du général Rossignol.
On sait que le Comité de Salut public redoutait la dictature militaire à l’égal de la trahison et que les principes et le caractère de Rossignol furent pour beaucoup dans son élévation au premier grade. Certes, il supportait mal l’esprit d’autorité, et cette indication de « Parisien mauvaise tête » se manifeste déjà dans la première partie de ses mémoires. Son mépris de la hiérarchie lui vaut de la part des historiens plus d’une rebuffade ; mais on oublie trop que l’époque tendait au nivellement des institutions, et rien n’est moins contradictoire à ce principe que l’esprit de camaraderie et d’égalité apporté dans l’armée par ceux-là mêmes qui l’avaient proclamé dans la vie civile. À ce point de vue, les généraux de l’armée de Mayence étaient des réactionnaires pénétrés de l’importance du grade et souffrant mal l’élection d’un illettré au premier commandement. De là ces jalousies, ces rivalités, ces désaccords néfastes dont parlent tous les historiens de la guerre vendéenne. Le jugement que Rossignol porte sur Kléber, dans une lettre au ministre Bouchotte, est très significatif de l’état d’esprit qui les divisait : « C’est un bon militaire qui sait le métier de la guerre, mais qui sert la République comme il servirait un despote. »
Pour remplacer avantageusement, en théorie, l’obéissance passive dénoncée par Rossignol comme insupportable à des hommes libres, il ne fallait que de l’entente fraternelle et du dévouement à la chose publique et, dans la simplicité de son âme, il ne doutait pas que les soldats de la Raison fussent à la hauteur des principes républicains, mais c’était compter sans les contradictions humaines et les ambitions personnelles.
À plus forte raison, l’âpre attitude de Rossignol ne pouvait être approuvée par les écrivains hostiles à l’esprit de la Révolution ; mais leurs railleries sont trop faciles et leurs calomnies évidentes : ils n’ont voulu voir en lui qu’un général incapable. Certes Rossignol n’était pas un grand stratège. Quand il accepta la charge redoutable de général en chef dans cette grande campagne de la Vendée, charge qui eût été lourde à d’autres épaules que les siennes, il ne le fit qu’à contre-cœur en confessant « l’insuffisance de ses lumières », mais ses amis et les représentants du peuple promettaient de l’assister ; il savait que, derrière Ronsin, il y avait Berthier, homme à talents, et il pensait naïvement que l’art de la guerre n’est qu’un moyen au service d’idées plus hautes ; il se savait sûr de lui-même, incapable de trahir ou de temporiser ; on le persuada que si un bon patriote comme lui n’acceptait pas le premier grade, la guerre s’éterniserait par la mauvaise volonté des chefs, et que, d’ailleurs, les intrigants étaient nombreux tout prêts à profiter de cette place pour ensuite trahir le peuple plus facilement ; il accepta donc, et non sans bravoure morale, de représenter à la tête de l’armée l’intransigeance des principes républicains. Voilà ce qu’on n’a pas voulu voir, et ceux qui ont compris la franchise désintéressée de Rossignol lui en ont fait un crime. Le Comité de salut public était mieux inspiré, et la fin de la République le démontre assez.
Dans son « Histoire de la Terreur », M. Mortimer-Ternaux pousse la haine des démocraties jusqu’à l’erreur volontaire quand, sans plus de preuves, il porte contre Rossignol l’accusation de lâcheté. Au contraire, tous les témoignages sont unanimes à reconnaître sa bravoure et son patriotisme. Ses ennemis contemporains eux-mêmes ne lui contestaient point ces titres.
L’empreinte matérielle de Rossignol sur la destinée de la Révolution n’est pas non plus négligeable ; on le voit encore bien vivant en dehors des figurations idéales. Les événements de la Vendée, on le sait, eurent à Paris une influence directrice. Rossignol pèse sur Robespierre qui le soutient d’accord avec le Comité de salut public et les assemblées populaires : c’est toute une politique.
Quand Rossignol est attaqué devant la Convention et aux Jacobins par un faux personnage comme Bourdon de l’Oise, ce n’est qu’un écho de la grande querelle qui se poursuit en Vendée et qui divise les représentants du peuple ; en ces occasions, Robespierre lui-même défend Rossignol appuyé par le parti populaire et par Hébert reprochant aux généraux qui ont précédé Rossignol en Vendée d’avoir fait de cette guerre civile leur pot-au-feu ; il met Bourdon de l’Oise et ses amis en mauvaise posture ; bien plus, il porte contre eux des menaces non équivoques et les invite à revenir de leurs erreurs.
Rossignol, général, est accusé d’impéritie ; plus près des faits nous voyons ceci : le plan qu’il proposait aux avocats du conseil de guerre de Saumur était qualifié d’absurde par le vertueux et peu clairvoyant Philippeaux et par les guerriers de l’armée de Mayence intéressés en la circonstance ; Rossignol insiste et montre que le projet qu’il soutient est le seul qu’on puisse exécuter ; les votes se partagent également. – Je vois ce qu’il en est, dit en substance Rossignol, le plan est indiscutable, et c’est moi qui vous gêne ; eh bien, je me retire : il ne faut pas abaisser notre grande décision jusqu’à des rivalités personnelles ; j’accepte de servir sous les ordres de Canclaux, pour faire cesser toute querelle, si Canclaux veut commander la marche qui s’impose.
Ce beau mouvement ne décida personne et Rossignol, en s’abstenant de prendre part au second vote, permit à ses présomptueux contradicteurs de triompher en principe, mais en principe seulement, car la marche tournante qu’ils avaient conçue eut pour résultats les retards que l’on sait et la glorieuse défaite des Mayençais eux-mêmes.
On pourrait croire que le plan de Rossignol, ce général ignorant, n’était pas meilleur, mais nous avons sur ce point une autorité de quelque valeur, celle de Napoléon Ier qui, jugeant à distance les opérations de la guerre vendéenne, déclare que le seul parti à prendre au Conseil de Saumur était de marcher directement et en masse, et Napoléon refait en quelques lignes le plan proposé par Rossignol.
À suivre autrement l’histoire que par la marche des événements extérieurement enregistrés, en étudiant plutôt les déformations que ceux-ci exercent sur le caractère des peuples, Rossignol atteste une façon d’être, un état d’autant plus intéressant que son personnage est plus simple et que la morsure des faits y accuse, comme sur une pierre de touche, son caractère franc, incapable de se plier adroitement aux circonstances. Rossignol n’est pas un esprit supérieur, car il ne doute jamais ; il va droit à son but et persiste ; les ruses qu’il emploie sont très apparentes et font sourire ; mais il représente un élément avec lequel les esprits les plus fins devront toujours compter : la force d’action, la volonté vivace qui, en dehors de toute prévision, crée les événements. Sans Rossignol et les hommes de sa trempe, la Révolution était impossible, car la logique des assemblées parlantes ne fait pas de révolutions, et c’est, pour une bonne part, grâce aux émeutiers et aux justiciers révolutionnaires se portant à des excès, comme tous les justiciers, que les délibérations de la Convention furent possibles, et que ce qui est arrivé arriva. Il ne s’agit point ici de légitimer l’histoire ni de la combattre au nom d’une vérité supérieure au jeu des événements, mais de comprendre sans aigreur les hommes et les choses du passé : et c’est pourquoi on lira Rossignol ; car, si de on propre aveu, il fut entraîné par le courant sans pouvoir en apprécier rien, il fut encore un des éléments actifs de ce courant et chorège de la foule, premier acteur, du reste toujours semblable à lui-même, et tel qu’on le voit déjà aux années d’enfance, d’apprentissage et de service militaire.
Malgré que la littérature des écrivains soit absente de ses mémoires et même les passages soignés, on y trouvera pourtant des choses de lecture très impressionnantes et des mots d’un grand style. Les naïvetés de Rossignol sont souvent superbes ; ainsi, quand on veut l’incarcérer à Niort sur l’ordre de Westermann : « Je pensais, dit-il, qu’il ne devait plus exister de cachots depuis que j’avais renversé la Bastille. » Cependant je me persuade aisément qu’on pourrait mal juger ce récit d’un ouvrier illettré qui devint général. D’ailleurs, il faut y apporter une intelligence assez parfaite des scènes accessoires du drame révolutionnaire, et ne pas y chercher la vérité complexe et littéraire, mais une note essentielle et la première, qui rarement apparaît dans les documents vulgaires de cette sorte : j’entends le caractère d’un homme du peuple, acteur et jouet des événements les plus considérables et leur opposant une âme toujours ferme avec la sainteté de son ignorance. Le sourire indulgent du critique qui juge des caractères par leur complexité serait ici hors de propos : on peut rire de Rossignol, mais c’est un homme de Plutarque.
À preuve de l’authenticité rigoureuse des mémoires que nous publions, on consultera, aux Archives historiques de la guerre, les cahiers rédigés par Rossignol lui-même pendant sa détention au fort de Ham, et l’on verra que notre texte, en redressant parfois l’écriture fruste de cette autobiographie, n’en altère jamais le style. L’allure de la phrase et tous les détails sont conservés ; quelques dates à leur place et des justifications orthographiques sont la seule correction qu’ait subie le travail original qui garde ainsi toute sa valeur documentaire.
La narration de Rossignol s’interrompt, en 1791, brusquement, à la fin d’un cahier, pour reprendre avec le départ par la Vendée des Vainqueurs de la Bastille, et sans doute il ne faut voir là qu’une lacune étrangère à sa volonté, à moins qu’on ne préfère croire que, Rossignol écrivant après les événements de Thermidor, il eût été imprudent à lui, dans les circonstances où il se trouvait, de préciser l’importance de son rôle révolutionnaire au Dix-Août comme aux jours de septembre, et qu’il s’en abstint. Elle s’arrête en 1795 avec un mémoire justificatif publié en deux fois sur la fin de la même année.
Mais dans les détails du procès Babeuf, dans les lettres qui sont au dossier administratif de Rossignol et dans les relations inédites de la déportation aux îles Seychelles et à l’île d’Anjouan, où il fut compris, nous en avons cherché la suite.
Il se trouve, en effet, que les compagnons d’exil de Rossignol, dans l’espoir d’une justice tardive, ont noté scrupuleusement un récit collectif de leurs misères communes, où la vie de notre auteur se confond habituellement, pour reparaître, à l’occasion et d’une façon émouvante, sur le relief des événements. Ce mémoire et quelques autres pièces que nous citons sont aux Archives coloniales.
« La vie véritable du citoyen Jean Rossignol » n’est donc point une fantaisie écrite après coup par quelque secrétaire zélé, ou moins directement encore, comme presque tous les mémoires de l’époque révolutionnaire ; ce n’est point une contrefaçon moderne de la mode de 1820, mais un document complet relevé sur les écritures originales, et présentant les meilleures garanties.[1]
VICTOR BARRUCAND.
PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE PREMIER
L’état de mes parents. – Quand j’étais petit. – Entre les écoliers des maîtres d’écriture. – Le caractère de ma mère. – Contre le guet. – J’entre en apprentissage. – Pour être mon maître.
Je suis né d’une famille pauvre[2]. Défunt mon père était Bourguignon. Il vint à Paris et, après quelques années, il chercha à se marier. Il fit donc connaissance de ma mère et ils se marièrent. Des cinq enfants qu’ils eurent, trois garçons et deux filles, j’étais le dernier.
Par sa bonne conduite, mon père avait obtenu une place à la Messagerie de Lyon ; il y était facteur ; ma mère y était factrice. Je n’avais que neuf ans à la mort de mon père, mais j’étais déjà en âge de le connaître et je me souviens qu’il m’aimait beaucoup parce que j’étais de mes frères le plus espiègle.
J’allais à l’école aux enfants de la paroisse et, comme j’avais une assez belle voix, je devins enfant de chœur à Sainte-Catherine, ci-devant canonicat de Sainte-Geneviève.
Je n’y fus que très peu de temps parce que j’eus une dispute avec le cuisinier de la maison. On me retira de cet endroit, et l’on me remit à ma première école jusqu’à l’âge de douze ans ; alors je changeai pour aller de suite chez un nommé Gourmera, maître d’écriture. Ce fut là le commencement de ma jeunesse. Tous les jours, en sortant de l’école, j’allais avec les autres enfants jouer à la ci-devant place Royale.
Au bout d’un an, comme je promettais d’écrire assez bien, on nous envoya les trois garçons que nous étions chez un maître d’école pour l’écriture nommé Roland.
Cette classe avait alors dispute avec les écoliers de Gourmera : ce fut là, deux ou trois fois par semaine, que nous nous battions les uns contre les autres avec les armes des écoliers : règles, compas, canifs, tout en était ; plusieurs fois je fus blessé, cela ne me dégoûtait pas. Sitôt que j’étais à même de reprendre ma revanche, je m’y trouvais avec plaisir, et par un nouveau combat je revenais quelquefois vainqueur ou d’autres fois vaincu.
Je mentais assez bien à la maison, surtout quand j’avais été battu : c’était que j’étais tombé ou que l’on m’avait fait cela sans le vouloir. J’avais une mère à qui il ne fallait jamais se plaindre ; elle était très dure ; elle ne nous cajolait pas, au contraire : « Va, disait-elle, aujourd’hui t’as trouvé ton maître. » Cela m’outrait à un tel point que souvent je sortais en colère de la maison, et, sur le premier que je rencontrais il fallait que je passe ma colère, puis j’étais satisfait. Un jour, je me souviens que nous avions fait une partie carrée de six contre six sur la demi-lune des boulevards, mais, comme nous étions très animés, la garde vint nous surprendre et le guet de Paris tenait déjà deux de nous, lorsque tout à coup notre colère cessa les uns contre les autres, et nous cherchâmes à retirer des mains de la garde nos camarades ; mais cela fut inutile, car j’avais fait tomber un soldat du guet par terre ; je tombai aussi ; alors un autre soldat me prit et l’on nous emmena tous au corps de garde et l’on nous menaçait de la charbonnière. Mes autres camarades eurent peur de la garde, s’enfuirent et furent avertir plusieurs personnes qui vinrent nous réclamer : nous en fûmes quittes pour la peur. Sitôt que nous rencontrâmes les fuyards, nous leur dîmes des injures : qu’ils étaient des poltrons, qu’ils n’avaient point de cœur.
Enfin ma mère se résolut à me faire apprendre un métier, et j’ai choisi celui d’orfèvre. Me voilà en apprentissage. Le marché était ainsi conclu que j’y resterais quatre années pour quatre cents francs d’argent. J’étais content d’avoir quitté la maison paternelle. Le bourgeois chez qui j’étais était un brave homme, mais sa femme, vieille bigote, était le bon Dieu à l’église et le diable à la maison. J’étais forcé les dimanches et fêtes d’aller à la messe de la paroisse avec elle : cela m’ennuyait assez ; enfin, comme j’avais la voix très forte, je faisais tous mes efforts pour l’empêcher de prier, et je chantais tant que je pouvais afin de l’étourdir dans ses prières ; ce qui lui fit prendre le parti de m’envoyer du côté du Cours, avec ordre de la venir reprendre sitôt la grand’messe finie. Je profitais de cette occasion pour aller jouer avec les autres apprentis sur le portail, puis je rentrais reprendre ma bourgeoise.
Je restai dans cette boutique pendant trois années et, comme je savais un peu travailler, je croyais qu’en province les alouettes tombaient toutes rôties ; ce qui m’a décidé à voyager : et le tout pour être mon maître.
Alors je n’avais que quatorze ans. J’étais assez fort pour mon âge, mais je n’avais point de taille.
CHAPITRE II
Projet d’embarquement. – À Bordeaux, mon patron me met à la porte. – Je travaille à La Rochelle. – Dispute à la canne avec mon premier. – Chez un brave homme de Niort. – Le pan de mon habit en payement. – Retour à Paris. – Je gagne ma vie. – La petite drôlerie.
Quand je partis de Paris j’avais deux desseins : le premier, en arrivant à Bordeaux, de chercher un bâtiment pour passer à l’île Saint-Domingue, parce que j’avais un de mes oncles du côté de ma mère qui était très riche. Il était sûrement fripon, car il était procureur. Je ne puis attester le fait, mais le proverbe dit : « tel métier, tel homme, » et j’avoue que, quoique très jeune, j’avais déjà mauvaise opinion de son état ; mais je me disais : il me fera sûrement apprendre le commerce et je ferai fortune dans ce pays-là.
Arrivé à Bordeaux, je parlai à plusieurs capitaines de vaisseaux ; aucun ne voulut me passer à moins de trois cents livres. Je n’en avais alors que deux cents, et par conséquent je fus réduit à chercher de l’ouvrage, ce qui était mon second point de vue.
Je n’étais pas encore bien fort dans mon état, cependant je trouvai un marchand orfèvre qui m’occupa, je ne fis pas son ouvrage à son goût et, au bout de huit jours, il me mit à la porte. Je commençai à sentir ce que c’était que la province et je me repentis d’avoir quitté Paris.
Je revins de Bordeaux à La Rochelle ; là j’entrai chez un orfèvre et j’y restai deux mois. Je n’y « faisais » que pour vivre.
Il y avait dans cette boutique un premier ouvrier qui se moquait de moi. Nous eûmes ensemble une dispute très vive et il me proposa de me battre, mais, le sentant plus fort que moi à la poigne, je lui proposai la canne et nous fûmes nous battre. Je fus heureusement le vainqueur, et je lui donnai entre autres deux coups sur la figure, si bien qu’il lui fut impossible de venir travailler le lendemain. Le bourgeois, qui avait besoin de cet ouvrier, sut qu’il avait été blessé par moi et me mit à la porte.
Me voilà encore en route et très léger d’argent.
Je vins à Niort en Poitou, là je trouvai de l’ouvrage. J’étais tombé chez un brave homme, et au bout de quelque temps il me regarda comme son enfant : je mangeais chez lui, à sa table, et il me donnait dix-huit livres par mois. J’étais selon la circonstance et mon âge assez heureux.
Je n’avais qu’un seul habit. Un jour, un danseur de corde vint dans la ville pour y faire des tours. Il fit battre au son de la caisse qu’un grand voltigeur ferait ses exercices à cinq heures du soir au Château, et qu’il prendrait deux sols par personne, et que l’on ne payerait qu’en sortant. Il avait fait fermer la grande porte et il fallait passer par la petite qui ressemblait beaucoup à une porte de prison. Là, il avait placé deux personnes pour recevoir la recette. Je ne voulais pas le payer parce qu’il nous avait annoncé des tours de force qu’il ne nous avait pas faits. Je m’y connaissais assez, car j’avais été plusieurs fois chez Nicolet, et, comme je me trouvais pressé, l’on m’attrapa par le pan de mon habit qui leur resta dans la main avec tout le côté. Je n’avais pas le moyen d’en avoir un autre, je rentrai chez mon bourgeois : « Où avez-vous donc laissé le reste de votre habit ? Vous voilà joli garçon avec ce costume-là ! » Je lui répondis que plusieurs libertins et ivrognes m’avaient attaqué, je ne sais pourquoi, et que, me voyant frappé, j’avais été contraint de me revenger, mais comme ils étaient plusieurs, j’avais été forcé de leur laisser le champ de bataille, et que cherchant à échapper de leurs mains un d’entre eux m’avait attrapé par mon habit, et par conséquent le morceau lui était resté dans la main, et que je me trouvais fort heureux de n’avoir que cela. Le marchand orfèvre compatissant me fit arranger une de ses vieilles redingotes qu’il me donna jusqu’à ce que mon mois fût échu. Mon mois échu, sur-le-champ j’achetai un habit avec mes dix-huit livres. Vous imaginez bien qu’il n’était pas de la première qualité.
J’ai passé chez ce brave homme tout l’été jusqu’à la fin des vendanges, et puis je pris la route de Paris. J’avais alors quatorze ans et demi.
En arrivant, je cherchai de l’ouvrage et j’eus assez de peine à en trouver. Après bien des démarches, je travaillai chez le sieur Langlois. Je n’y restai que deux mois. De là, je fus chez le nommé Taillepied, au Marché-Neuf. Je gagnais par semaine vingt francs de moyenne. Un jour, je m’avisai d’aller voir les femmes et j’attrapai la petite drôlerie. Les ouvriers avec lesquels je travaillais s’en aperçurent et ce fut une risée dans la boutique. Je me désespérais ; cela m’occasionnait des disputes avec mes camarades. Je me battais souvent, et je me trouvais à dos avec tous mes camarades. Je grandissais à vue d’œil et j’avais à quinze ans la taille de cinq pieds trois pouces, assez bien fait, sans être joli, mais très passable.
CHAPITRE III
Être soldat. – Le marchand de chair humaine. – Nous ratifions. – Sous le nom de Francœur. – J’apprends à tirer avec des baguettes. – Dans la chambrée. – Mon premier duel. – Ruse de recrue. – Le vainqueur de la Giroflée. – Dispute sur un liard. – Je suis blessé. – Ma revanche. – En vrai luron.
Je pris le parti de me faire soldat. Je fus trouver un officier qui me donna cent livres d’engagement et un billet de dix écus pour le régiment. Je vendis mes outils et je fus faire mes adieux à ma mère avec l’officier à qui je m’étais engagé. L’officier avait ses desseins : il croyait que ma mère ne me laisserait pas partir et, apparemment, il comptait sur quelques louis d’or de bénéfice. Mais ma mère, sitôt qu’elle me vit avec une cocarde, me dit : « Ah, ah Monsieur, vous avez fait la sottise, vous la boirez ! » Cependant l’officier lui dit : « Madame, si vous le voulez, il ne partira pas ; moyennant quelque petite chose, je vous rendrai votre fils. » Mais à l’instant je dis que je m’engagerais à un autre. Ma mère prit le parti de me dire : « Eh bien, Monsieur, allez et soyez sage. » Je partis sans rien regretter.
Mon recruteur, marchand de chair humaine, avait aussi engagé un boulanger. Ce même jour-là nous ratifiâmes chez Sommeiller ensemble. Le lendemain, le recruteur, un sergent dudit régiment et un de mes frères, l’horloger, que je n’ai plus vu depuis, vinrent jusqu’à une auberge que l’on appelait le Chaudron ; là, nous déjeunâmes, et après nous nous dîmes adieu.
Me voilà en route jusqu’à Dunkerque qui fut ma première garnison.
J’arrivai avec mon camarade le 13 août 1775, et le 14 on nous signala tous deux dans la même compagnie de Jumécourt. J’y pris le nom de Francœur, que je portai jusqu’au doublement, qui se fit en 1776. Dans la compagnie que je doublais alors, il se trouva un militaire qui portait mon même nom de guerre ; je fus obligé d’en prendre un autre, et je m’en tins à Rossignol : c’était mon nom de famille, que j’ai toujours porté depuis et que jamais je ne changerai. Aucune bassesse ne s’est jamais faite dans ma famille ; j’ose l’attester à la face du ciel.
Me voilà donc dans le ci-devant Royal-Roussillon-Infanterie. Pour huit jours, je fus d’abord aux exercices militaires comme recrue, et bientôt à la première classe ; en moins de deux mois je montais ma garde ; le troisième mois, je n’allais plus qu’avec la compagnie. À la vérité, j’aimais les évolutions et je me plaisais beaucoup à ce métier-là.
Je fis ensuite connaissance avec un de mes camarades qui apprenait à tirer des armes et, comme je n’avais pas le moyen de payer un maître, je priai mon ami de m’enseigner ce qu’il savait. J’allais chercher des baguettes et, avec cela, j’apprenais de mon ami tout ce qu’il savait. Cet exercice dura pendant plus de quatre mois entiers. Enfin je reçus de mon frère la somme de vingt-quatre livres, qui me fit bien plaisir. Je priai mon ami de venir boire avec moi, mais il ne voulut pas, vu que l’on me traitait encore de recrue. Il disait que l’on trouverait à redire si l’on voyait un vieux soldat aller au cabaret avec des jeunes gens ; cependant quelques jours après je fis une ribote avec les plus lurons : – c’étaient ceux qui se battaient le mieux et le plus souvent que l’on appelait ainsi ; – cela m’occasionna une dispute que des amis arrangèrent à l’amiable.
Un soir que j’étais à fendre du bois entre quatre fers, plusieurs de mes camarades de la chambrée me prièrent donc de conter un conte. Je me mis alors en fonction et, au bout d’une demi-heure, un de mes camarades de lit qui avait besoin que nous soyons endormis tous pour aller voir sa maîtresse, se mit à me dire que, si je ne finissais pas, il allait me faire taire d’une belle manière. Les autres qui n’étaient pas encore endormis me dirent de continuer. Moi, qui ne me plaisais qu’à être en contradiction, je me mis de plus belle à forcer ma voix qui a toujours été très forte. Lui, voyant que je le faisais exprès, me donna un coup de poing. Me sentant frappé, je le lui rendis. Nous voilà à nous battre jusqu’à ce que le caporal de la chambrée se réveillât et mit le bon ordre et fît finir toute l’histoire. Nous cessâmes notre dispute, mais il me dit que je lui payerais cette scène, le matin. En effet, cinq heures sonnent : il me réveille et me dit de prendre ma baïonnette et qu’il allait me corriger. Il prit un de ses amis, et moi, je réveillai un musicien qui couchait avec nous ; celui-ci ne voulait pas venir, disant que j’étais trop jeune et que cela le compromettrait. Je fus donc obligé de dire : Allons-y, nous deux, nous n’avons besoin de personne. Il ne voulut jamais. C’est alors que je fus réveiller mon camarade avec lequel je m’étais engagé : celui-là ne me refusa pas.
Nous voilà partis. Il faisait clair de lune. Quand nous fûmes au bord du rempart, il se déshabilla et moi aussi. Je fis comme lui, j’entortillai mon poignet avec mon mouchoir. C’était la première fois que je me battais avec du fer, en exceptant le temps où j’étais écolier. Après plusieurs minutes de combat, je le serrai de près et je lui portai un coup sur le sein. Il tomba par terre et moi je me mis à dire : Ah mon Dieu, il est mort !
Je repris vite mon habit et je me rendis à la caserne à toutes jambes. Je me mis dans le lit très doucement et je fis semblant de dormir. Pour le blessé, les deux spectateurs lui donnèrent des secours et le portèrent chez une vivandière du régiment. On le pansa ; le chirurgien vint qui le soigna, et on le conduisit à l’hôpital militaire. Il y resta deux mois entiers.
Le matin, l’on questionna les spectateurs que la vivandière connaissait, et l’on sut que c’était moi qui m’étais battu. Un caporal envoyé pour me questionner me demanda où était la baïonnette ; je lui répondis qu’elle était sous le pied du lit. Il la cherche et la trouve : elle était pleine de dents, parce qu’en parant cela avait fait des brèches. Il me demanda si c’était moi qui avais blessé la Giroflée, c’était le nom de celui avec qui je m’étais battu et par conséquent mon camarade de lit. Je lui répondis que je ne savais pas ce qu’il me demandait. Il me dit : « Voilà pourtant ta baïonnette qui a porté le coup car voilà le sang encore après. » Je dis qu’il était très possible qu’un autre que moi eût pris ma baïonnette pour aller se battre avec. – « Allons, jeune homme, venez parler au sergent-major, et prenez votre bonnet de police… Et qu’on lui donne un vieil habit pour aller au cachot. » Ces paroles me firent frémir.
Me voilà bientôt costumé pour aller en prison. Le caporal me mena chez le sergent-major. C’était le matin ; il se faisait coiffer pour aller au rapport à neuf heures du matin. Le sergent-major me questionna et voulut me faire dire la vérité. Après plusieurs interrogatoires que je subis, je me coupai dans mes réponses. Il m’assura que si je ne lui avouais pas que c’était moi, il allait me faire aller au cachot pour trois mois. Cela me fit une si grande peur que je répondis qu’à la vérité cela était vrai, mais que j’y avais été forcé par mon adversaire après des insultes qu’il m’avait faites, et qu’un soldat qui avait reçu des soufflets ne pouvait faire autrement que de se battre, sans quoi il était déshonoré, et que j’aimais mieux, tout jeune que j’étais dans le service, être tué ou blessé plutôt que de passer pour un lâche. Ma réponse fit plaisir au sergent-major : « Allez-vous-en, me dit-il, et que cela ne vous arrive plus. »
Me voilà exempt du maudit cachot. Le jour même, le bruit s’était répandu que l’on avait porté un soldat de la compagnie de Dutrémoy à l’hôpital. (Alors le doublement était fait et Dutrémoy était le nom du capitaine, et Jumécourt le commandant en second.) Ce premier coup d’essai me donna une certaine hardiesse, et j’entendais que l’on disait en parlant de moi : « Tiens, le voilà, celui qui a mis la Giroflée à l’hôpital ! » Il est bon que l’on sache que celui-ci avait douze ans de service, et moi je n’avais alors que six mois de présence.
Un mois après je tombai de garde à un poste qu’on appelait le fort Mardic. Nous nous amusions à jouer de gros sols au liard, le plus près gagnant, avec un nommé Malfilâtre qui était Normand. Nous disputâmes sur un liard, et après avoir bien mesuré, le liard m’appartenait. Il le ramassa. Je me mis en colère et je lui vomis des injures : tout le monde sait ce qu’un soldat peut dire en injures. Le caporal vint aussitôt et nous fit prendre à tous deux nos fusils et il nous mit en faction, l’un d’un côté et l’autre de l’autre. Nous y restâmes trois heures chacun, que nous fîmes en plus des six heures que nous avions à faire. Quand nous fûmes relevés, Malfilâtre me dit qu’en descendant de garde je lui payerais ça. Je lui répondis que je n’avais pas peur de lui : et, à la vérité, nous descendîmes la garde, et, le soir, après la soupe, nous fûmes nous battre. Celui-là avait plus de talents que moi, car il avait quatre ans de salle, et moi je n’avais pas appris grand’chose, encore c’était avec des baguettes. Il me désarma du premier coup et me toucha deux fois : un coup dans le bras et un coup dans le pouce. Je tirais à tort et à travers, mais il parait de la main gauche. Les spectateurs nous séparèrent et réellement je fus content car le coup du bras me faisait extrêmement mal. Je revins à la chambre et un camarade me pansa. Personne, que ceux de la chambrée, ne s’en aperçut, et en six jours de temps je fus guéri.
Ce fut après ma guérison que je voulus me revenger avec le même, et la seconde fois, je fus vainqueur : je le blessai à mon tour. Depuis ce temps nous avons toujours été amis ensemble sans plus jamais avoir aucune discussion.
Cela m’avait fait un renom dans la compagnie et les lurons commencèrent à frayer avec moi. J’étais content de voir qu’on ne me regardait plus comme un blanc-bec. Mon premier maître, qui m’avait donné des leçons avec des baguettes, se fortifiait de jour en jour sur les armes.
CHAPITRE IV
Prévôt d’armes. – Rivalités. – Le travail des soldats. – Comment je manquai d’être pendu à Paramé. – Intervention de l’aumônier, du major, et de la marquise de mon capitaine. – Sur la paille. – Je fais des excuses. – Quelques bons tours à ce coquin de sergent. – Une rossée comme il faut. – J’avais une maîtresse.
Nous partîmes de Dunkerque pour le Hâvre-de-Grâce. Ce fut dans cette ville que je me perfectionnai au point de devenir en une année un des plus forts écoliers de la salle. Mon premier maître avait obtenu la permission d’enseigner ; il m’avait pris en amitié et me fit son prévôt. Tous les maîtres des grenadiers et chasseurs voulurent nous empêcher d’exercer. C’est à cette époque qu’il a fallu se battre les uns contre les autres. Plusieurs fois, nous avons remporté la victoire sur les grenadiers. Après plusieurs combats qu’il y eut, l’on mit à l’ordre que les premiers qui se battraient feraient trois mois de cachot ; c’était un lieutenant-colonel nommé Poulaillé qui prit cette mesure, un Provençal qui, depuis quarante années, n’avait pas seulement été dans son pays ; il se trouva à cette époque qu’il commandait le régiment, dont il eut quelque temps après le cordon rouge.
On portait plainte de temps en temps contre notre compagnie, et malgré l’ordre sévère de temps en temps l’on se battait. Je reçus dans un seul jour trois coups au bras d’un maître des grenadiers. Je ne voulais pas aller à l’hôpital. J’avais alors un sergent dans la compagnie qui m’estimait beaucoup ; il me pansait mon bras qui était devenu enflé ; il allait sur le rempart pour chercher des ronces et il en faisait lui-même des cataplasmes. Enfin, en quinze jours, je fus guéri.
Nous partîmes de cette garnison au bout de dix-huit mois. C’était une bonne garnison pour la troupe, tous les soldats y travaillaient. Les moindres journées étaient alors de trois livres.
Je n’ai jamais eu de goût tant que j’ai été au service pour tous ces genres de travaux : je n’aimais que les armes, et je suis resté près de quatre années au régiment sans aller en prison, pas même à la salle disciplinée.
Nous partîmes du Havre dans le mois de février (vieux style). Nous fîmes plusieurs petites garnisons, les unes de deux mois, les autres de trois, et nous reçûmes l’ordre pour aller au camp de Paramé, à côté de Port-Malo. Nous y restâmes un mois entier (en 1779) ; ce fut en cet endroit que je manquai d’être pendu. Voici le fait :
On demanda dans chaque compagnie ceux qui voulaient aller en semestre. Je me fis enregistrer pour y aller, comme étant un des plus anciens ; cela me touchait de droit après quatre ans passés de service et sans prison, mais je n’étais pas dans les amitiés du sergent qui n’était qu’un véritable sot. – Nous lui avions donné plusieurs sobriquets ; il s’appelait d’Ardennes de son nom ; il était du pays des marchands de bas rouges, c’est-à-dire Catalan ; c’était l’homme le plus injuste que j’aie connu, mais il était très aimé du capitaine appelé Dutrémoy.
Dans ce temps-là les sergents-majors dirigeaient les compagnies, car bien des officiers n’y connaissaient seulement pas trois individus, et plusieurs fois j’ai souvent vu des sots, de ces officiers-là, aux exercices militaires, demander où était leur compagnie et leur place…, et bien d’autres faits, que l’on a appris par la suite, et que le peuple ignorait alors.
En fin des trois jours que la liste des semestres était donnée, c’était un matin, nous étions tous sous la tente ; on fit lecture de la liste de tous ceux qui devaient partir ; j’écoutais avec grande attention, mais ce fut inutile, mon nom n’y était pas. Je sortis alors en colère de la tente, et je dis au sergent-major que tous ceux qu’il venait de nommer étaient moins anciens que moi, et je demandai quelle était la raison qui m’empêchait d’aller au pays. Il me dit que ce n’était pas lui qui y avait apporté obstacle, mais que le capitaine ne le voulait pas ; alors je lui dis que c’était qu’il avait fait un faux rapport. Je fus trouver le capitaine qui était chez sa marquise, et voici les paroles que je lui adressai : Mon commandant, je viens d’entendre nommer ceux qui sont pour aller au pays, et je ne suis pas sur cette liste ; mon sergent-major m’a dit que c’était vous qui ne vouliez pas ; je viens savoir de vous la vérité. – Il me répondit d’un ton insolent qu’il fallait que je sorte sur-le-champ et qu’il n’avait pas de compte à me rendre. Enfin je lui dis que je voulais savoir quels motifs il avait contre moi, que je ne croyais pas avoir mérité aucun reproche concernant la probité et l’honneur. Il se mit en colère et me dit : « Monsieur, laissons la probité à part… tous les autres défauts vous les avez ! » Il me répéta de nouveau de sortir, je lui dis que je ne le voulais pas, que je voulais avoir une raison ; enfin il me menaça de son épée. Je fus à l’instant si en colère que je lui dis : « Vous passez pour le plus juste du régiment, mais en ce moment-ci ceux qui le disent ne vous connaissent pas comme moi. » Il tira alors son épée ; je lui dis que je me foutais de son épée comme de lui, qu’il était indigne d’être mon capitaine, qu’il avait une croix de Saint-Louis qu’il n’avait pas gagnée, qu’il l’avait volée. Il voulut me conduire à la grand’garde, je ne voulus jamais y aller. Il me donna plusieurs coups en me poussant, je lui en ripostai d’autres : enfin notre combat dura près d’un quart d’heure. Il passa alors un sergent de la compagnie : ce fut à ce dernier que je me rendis.
Le sergent me conduisit à la garde du camp. Sitôt arrivé, on m’attacha, les mains derrière le dos, à un piquet de tente ; on mit une sentinelle de plus, avec ordre de faire feu sur moi si je voulais m’évader. Ce fut après quelques heures de réflexions que je m’aperçus que j’avais manqué grossièrement à mon capitaine et que les ordonnances du roi étaient très sévères à ce sujet.
Je ne pouvais me consoler et je me disais : D’après les ordonnances, tu seras pendu. Je passai la nuit à de pareilles réflexions et j’avoue que c’était bien fait pour effrayer. Ce n’était pas la mort que je craignais ; je n’ai jamais eu peur, mais le déshonneur d’être pendu.
Le lendemain de cette malheureuse scène, mon premier maître d’armes vint m’apporter la soupe. Je lui dis qu’il fallait faire tout le possible pour m’acheter du poison, et qu’à la parade, s’il entendait à l’ordre commander le Conseil de guerre, que je l’obligeais à mettre dans mon manger le poison en question, mais qu’il ferait bien de me le faire apporter par un autre que lui. Je lui rappelai qu’il avait un ami, un garçon apothicaire, qui me connaissait, et qu’il fallait l’amener à fournir ce qui était nécessaire.
Ce brave homme avait un grand caractère ; il me dit : « Sois tranquille, je t’achèterai tout ce qu’il faut, tu ne seras point pendu ; je suis charmé de voir en toi pareils sentiments. »
Je lui remis pour cette opération, vingt et une livres que j’avais conservées pour aller au pays. Le voilà parti, et au bout de trois heures il vint me dire qu’il avait ce qu’il fallait. Cela diminua un peu mon chagrin.
J’attendais l’heure de midi pour demander s’il n’y avait rien de nouveau pour moi ; la garde montante me dit que non.
Je pensais que j’étais criminel, mais non pas de ces criminels comme il s’en trouve, car moi, c’était la justice que je réclamais. À la vérité, je m’étais emporté.
Enfin, le troisième jour, l’aumônier dudit régiment vint me voir, et il s’assit auprès de moi. Il me connaissait beaucoup, mais non pour m’avoir confessé, car depuis ma première communion je ne l’avais pas été. Il me questionna sur mon affaire. Je lui dis qu’il fallait me laisser tranquille, que je ne me trouvais pas en état de l’entendre. Il me dit : « Je vais aller trouver votre capitaine et je lui dirai que vous êtes très repentant de tout ce que vous lui avez dit, que ce n’est que la colère qui s’était emparée de vous, mais que vous êtes au désespoir, enfin que vous implorez sa clémence. » À peine avais-je la force de lui répondre oui.
En effet, l’aumônier fut trouver mon capitaine.
Après des discussions, celui-ci dit qu’il voulait un exemple et qu’il demanderait un conseil de guerre.
L’aumônier fut trouver le major, à qui le rapport avait été fait, mais qui n’en avait pas encore rendu compte au colonel.
Le major était un nommé d’Allons, Provençal et officier de fortune très vif, très instruit de l’art militaire, connaissant beaucoup les manœuvres. Il avait remporté plusieurs fois des prix pour sa bonne prononciation et le zèle qu’il mettait à son service. Il m’estimait beaucoup. De temps en temps, quand il était de bonne humeur, nous raisonnions ensemble sur l’art militaire ; mais ce qu’il avait de désagréable pour moi, c’est qu’il voulait toujours avoir raison ; cela me mettait dans des colères fortes et il fallait, comme on se l’imagine bien, que je m’en aille.
Enfin, il vint me voir et m’interroger à la garde du camp. Il me fit délier et commença par me dire : « Est-il bien vrai que tu as manqué à ton capitaine aussi grossièrement ? » Je lui répondis que de telle manière qu’on eût fait le rapport, il était impossible que l’on eût écrit tout ce que je lui avais dit, que ce n’était malheureusement que trop vrai. En fin de plusieurs remontrances qui m’outraient considérablement, je lui dis : Mon major, je n’ai de ressource qu’en vous ; dites à mon capitaine qu’il peut me perdre s’il le veut. Je suis repentant. Il peut me faire finir mon congé dans un cachot, mais je le prie de ne pas demander un conseil de guerre. – « Va, me dit le major, tu n’y passeras pas, ou j’y perdrai mes épaulettes. » Et il me reconduisit à la tente avec ordre de ne pas m’attacher. J’avoue que cette scène m’avait ôté toutes mes forces et que, si je les avais eues, j’aurais déserté, afin de me soustraire au fatal jugement. Plus j’y réfléchissais, plus je diminuais mes forces. Le major, l’aumônier et plusieurs officiers se joignirent ensemble à la marquise de mon capitaine, et ils obtinrent de lui que je ferais six mois de cachot. Mon ami, qui avait entendu leur conversation, vint m’avertir et me dit : « Tu as ta grâce ! tu ne passeras pas au conseil… » Je tombai faible ; l’on me fit boire un peu d’eau et après quelques minutes je revins à moi. J’embrassai de joie mon maître d’armes, car ce fut lui qui m’annonça cette nouvelle.
On leva le camp et nous eûmes pour garnison Saint-Servan-Saint-Malo. On me mit en prison à la tour du Solidor, prison qui existe encore actuellement. Notre garnison ne fut pas longue à trouver, car il n’y a qu’une lieue de Paramé à Saint-Servan. Je fis la route, comme tous les prisonniers militaires, à la tête de la garde, l’habit retourné et la crosse du fusil en l’air. J’étais fort content de cette punition.
Au bout de quinze jours, mon capitaine se trouva de visite de prison et il vint dans le cachot où j’étais. Il me vit étendu sur la paille et tout seul : c’était l’ordre de ce maudit sergent-major. Le capitaine ordonna que l’on me mît en haut, dans la salle de discipline, et je lui dis : Capitaine, je vous remercie des bontés que vous voulez bien prendre pour moi ; je vous demande excuse de tous les propos et injures que j’ai commis en votre personne. Vous voyez mon repentir et certes je ferai mes six mois de prison sans me plaindre ; je les ai bien mérités. – « Allez, monsieur, soyez sage », me dit-il ; et le treizième jour après, il me fit sortir, de sorte que je n’aie fait en tout que vingt-huit jours de prison.
Je n’en ai jamais voulu à mon capitaine ; mais, ce coquin de sergent-major, je le détestais ; je ne pouvais le sentir ; aussi j’imaginais tout ce qui pouvait lui déplaire et tous les jours je lui faisais quelque tour nouveau : je lui coupais du crin dans ses draps ; il se grattait toute la nuit, vous eussiez dit plusieurs chevaux dans une écurie, il jurait, je riais de tout mon cœur ; d’autres fois, comme il ne se levait jamais la nuit pour uriner, je lui perçais son pot de chambre, de manière qu’il ne s’en aperçoive pas, et il était obligé dans la nuit de changer de draps. Pour toutes ces farces, il n’y avait que moi et un de mes amis qui lui en voulait qui savions cela. Le lendemain, on entendait dire qu’on avait fait telle farce au sergent-major ; mais personne ne pouvait le souffrir, de manière que cela faisait une réjouissance et de grandes risées dans la compagnie. Mais tous ces tours-là ne me vengeaient pas assez.
Il avait une maîtresse qu’il allait voir tous les jours après la retraite, et il restait souvent jusqu’à minuit. Je voulais absolument, à tout prix, me venger. Je choisis pour cet effet un soir qu’il n’y avait pas de lune ; – j’avais aussi une maîtresse qui avait chez elle un grand manteau ; – je parus à l’appel qui se fait après la retraite ; je me couchai comme les autres et je me levai sur les dix heures et demie du soir ; je sortis doucement et je laissai la porte de la chambrée tout contre ; j’avais mis à la brume mon manteau sous de gros pieux de bois de construction ; – je le pris et je me munis d’un gros bâton ; je fis faction dans une petite rue où devait passer le sergent ; je le vis sortir ; j’entrai dans une allée et, quand je jugeai qu’il était près de moi, je m’entortillai bien dans mon manteau et je ne mis dehors que le bras droit ; je tombai sur lui ; je lui détachai cinq ou six bons coups ; je l’étendis, et, comme il criait, et qu’il appelait tant qu’il pouvait « à la garde » je lui en détachai un autre sur la mâchoire et je le laissai là. Je revins par une autre rue à la caserne. Dans cette garnison, l’on ne posait point de sentinelle à la porte des casernes. Je remis mon manteau sous les mêmes pieux de bois ; je rentrai tout doucement dans la chambrée et je me couchai, bien content de mon expédition. Au bout de deux heures, on apporta le sergent à la caserne. On fit l’appel dans toutes les chambres : tout le monde y était. Le chirurgien vint et le pansa sur-le-champ. Il dit qu’il se doutait que c’était moi qui lui avais donné ces coups, mais qu’il n’en était pas sûr. On fit un rapport le lendemain au capitaine qui vint le voir, parce que c’était un flatteur et qu’il l’estimait beaucoup. Plusieurs soldats étaient dans la chambre et ils entendirent que le sergent disait au capitaine : « Je présume que c’est Rossignol. »
Le capitaine m’envoya chercher et il se mit à me questionner. Je lui répondis que je n’étais pas sorti et que je m’étais couché après la retraite battue, et que par conséquent ce ne pouvait être moi, que cela marquait encore une vengeance de la part du sergent à mon égard. Le capitaine me dit : « Conservez-en le secret, car si jamais j’apprends que ce soit vous, je vous ferai pourrir au cachot. » Nous nous disions les uns aux autres : « On y en a foutu, ni peu ni trop, mais assez. » Je n’avais garde de dire que c’était moi, mais tous mes camarades s’en doutaient. Il garda le lit pendant un mois ; la compagnie était pendant tout ce temps bien tranquille ; mais lui me gardait toujours une rancune.
Quelque temps après j’eus une dispute ; je fus pour la vider ; et comme j’avais été vainqueur, le sergent fut averti que c’était moi qui m’étais battu. Il fit son rapport, et me voilà pour trois mois en prison, au pain et à l’eau. Heureusement que j’avais une maîtresse qui tous les jours m’envoyait quelque chose.
CHAPITRE V
En semestre. – Je commence à m’ennuyer à Paris. – Une remarquable affaire. – Je suis pris pour un autre. – Un louis à qui me prête une épée. – Ma conversation avec le nommé Patrès. – Blessure mortelle. – Avec la protection du marquis de Livry.
L’année s’écoula. Vint ensuite le temps des semestres : mon homme me demanda si je voulais aller au pays. Je lui répondis que je le priais de me laisser tranquille et qu’il avait beau faire qu’il ne me prendrait pas cette année comme l’autre, que je ne voulais pas y aller. Il est bon de savoir que mon capitaine avait dit que tant qu’il aurait des oreilles au régiment, je n’irais pas en semestre. D’après ces paroles, il n’y fallait donc pas penser. Mais quelle fut ma surprise quand le capitaine vint un jour à la soupe et me demanda si je voulais aller en semestre. Je lui répondis qu’il en était le maître, mais que je ne voulais pas m’exposer à le lui demander, que j’avais couru de trop grands dangers. Il me répondit : « Si vous êtes tranquille, je vous promets que vous irez voir vos parents. » Et il s’en fut.
Il y avait encore un mois jusqu’au départ des semestres. J’enseignai alors à tirer des armes ; je ramassai l’argent de tous mes écoliers ; j’avais une vingtaine d’écus ; c’était beaucoup pour un simple soldat. On me délivra au temps dit ma cartouche et partis un des premiers de la compagnie.
J’arrivai à Paris au milieu de ma famille qui ne m’attendait pas, et je fus assez bien reçu. Pendant plusieurs jours j’allai voir mes parents ainsi que mes amis qui étaient tous des ouvriers de mon état. Je commençais à m’ennuyer et je pris le parti de chercher de l’ouvrage. J’allai chez un nommé Pagnon avec plusieurs de mes camarades.
J’eus pendant mon semestre plusieurs disputes avec des militaires. Je tirai l’épée sept fois : une surtout était remarquable. Ce fut dans le Bois de Boulogne que la scène se passa.
J’allai un beau jour à Passy, de là à Saint-Cloud, avec mon frère et un de mes amis appelé Fontaine, orfèvre, et depuis la Révolution officier dans l’artillerie, homme très brave, bon patriote, mais selon moi un peu exalté. Mon frère devait se marier et j’allais pour voir sa prétendue, qui était la fille assez bien faite d’un aubergiste. Nous dînâmes tous ensemble, ses parents et nous trois. Le dîner fini, nous allâmes nous promener pendant une bonne heure et demie. En rentrant dans ladite auberge, j’aperçus plusieurs militaires qui caressaient de très près la fille de la maison. J’en fis l’observation à mon frère et à mon ami. Nous bûmes quelques bouteilles de vin et nous entrâmes en conversation l’un avec l’autre groupe : nous parlâmes de la partie militaire, J’étais en bourgeois, mais j’avais cependant une culotte de drap bleu d’Elbeuf. Plusieurs contestations s’élevèrent entre nous. Ils étaient cinq ensemble. Ils me firent beaucoup d’honneur ; ils me prirent pour un mouchard et me dirent que je n’avais pas l’air d’un militaire. Cette insulte me parut très forte. Je leur dis : Messieurs, vous vous trompez et sûrement vous me prenez pour un autre. Ils m’invectivèrent encore derechef. Je perdis enfin patience et me voilà à leur en dire, mais des belles et de la bonne manière : qu’il était très heureux pour eux que je n’eusse pas mon épée ; que, s’ils voulaient m’en procurer une j’allais leur faire voir qui j’étais. Ils me répondirent à cela que les mouchards se déguisaient de toutes les manières et tiraient l’épée aussi. Je sortis et je fus chez le fourbisseur pour acheter une épée, mais aucun ne m’en voulait vendre. Je me désespérais. Un de mes insulteurs se détacha de la bande, et bientôt je vis arriver dix ou douze militaires armés de sabres et dont plusieurs avaient des épées. On s’expliqua ; et, remarquant un grenadier assez bien monté en épée, je lui offris un louis de son arme, en ajoutant que je me chargeais de lui faire remettre une lame si je venais à la casser. Il me refusa net et me dit qu’il ne prêtait jamais ses armes surtout contre ses amis. Je lui dis : Votre réflexion est très juste, mais alors empêchez-les d’insulter un homme qui n’a point de quoi se défendre.
Résolus à coucher dans l’auberge, nous donnâmes l’ordre de nous préparer des lits. Les disputeurs se disposaient à partir, mais nous eûmes encore à nous entendre avec eux, car il y avait douze pintes de vin bues, et d’autorité ils voulaient me forcer à les payer. Je dis que je payerais mon écot et rien de plus. Alors je soldai trois brocs de vin et l’aubergiste leur fit payer le reste : ils s’en allèrent très mécontents.
Mon ami, au bout d’une heure, me dit : « Il faut nous en retourner à Paris. » Il était marié et avait deux enfants. Enfin, nous décidâmes que nous irions coucher à Paris. Nous avions tous trois chacun une bonne canne de jonc ; nous mîmes nos couteaux au bout que nous avions très bien attachés, et nous partîmes ; il était à peu près dix heures du soir. En route nous ne rencontrâmes aucun obstacle ; mais nous avons appris le lendemain que la bande était revenue dans l’auberge sur les onze heures et qu’ils avaient fait des perquisitions dans toutes les chambres, et même qu’ils avaient visité les paillasses : la boisson les avait sûrement portés à faire de pareilles sottises.
Je résolus d’en tirer vengeance. Je savais leurs noms, surtout ceux des trois qui m’avaient le plus insulté ; en conséquence, j’avertis plusieurs de mes camarades que nous irions le dimanche d’ensuite tous ensemble.
Le dimanche venu, nous partîmes huit militaires et quatre bourgeois, et comme il y avait deux de ces insolents qui demeuraient au Point-du-Jour, route de Versailles, à cet endroit, nous entrâmes dans un cabaret, et nous les fîmes demander. Ils vinrent de suite, ne croyant pas trouver pareille réception. À notre vue, ils changèrent de contenance. Je leur portai la parole et leur dis : Dimanche dernier, vous m’avez insulté par des propos et des paroles très graves, qu’un vrai militaire ne peut passer ; aujourd’hui, je viens vous en demander raison l’épée à la main, ou bien il faut que vous conveniez de vos torts envers moi. L’un de ces deux me fit réponse qu’il allait chercher son épée. Nous l’attendîmes pendant une heure, mais il ne revînt pas. Pendant ce temps son frère, qui était resté, nous dit que celui qui la première fois m’avait proposé l’épée était un nommé Patrès, demeurant à Boulogne, et que, sans doute, si son frère ne revenait pas c’est que sa mère et sa sœur le retenaient. Il nous dit qu’il l’allait chercher. Nous le laissâmes partir, mais il ne revint pas plus que son frère. Cependant, la mère et la sœur de ces militaires vinrent nous demander excuse et, après bien des supplications, nous les quittâmes pour aller à Boulogne.
Arrivés dans le pays, il pouvait être trois heures après-midi, nous nous informâmes de la demeure du nommé Patrès ; on nous dit qu’il était dans un cabaret à jouer ; je fis aussitôt entrer mes amis dans un cabaret vis-à-vis, et seul j’entrai où il était. Je lui demandai s’il se ressouvenait d’un militaire qu’il avait insulté le dimanche dernier ; il me répondit que oui, qu’à la vérité, il me reconnaissait, et il m’invita à lui dire ce que je lui voulais. Je lui répondis que je venais lui demander satisfaction. Il me toisa de la tête aux pieds et, avec un air de dédain, il me demanda si j’avais envie de me faire tuer. Je lui répondis qu’il pourrait bien se tromper. Il me dit qu’il était maître d’armes. Je lui fis cette réponse : Je ne viens pas ici pour connaître ce que vous dites, mais bien pour que vous conveniez de vos torts envers moi. Il me dit qu’il allait en convenir, mais l’épée à la main. Je lui dis : Allons, venez tout de suite. Il me dit qu’il allait chercher son épée chez lui. – Venez, venez, lui dis-je, je serai plus honnête que vous ne l’avez été à mon égard dimanche dernier ; j’ai des amis avec moi, vous choisirez l’épée qui vous plaira. Non, non, dit-il, je ne suis sûr que de la mienne. Il me donna parole à l’entrée du Bois de Boulogne, aux premiers arbres sur la route. Ayant averti mes camarades j’allai seul au rendez-vous ; mais bientôt, ils vinrent avec des gens de l’endroit. C’était un dimanche, comme je l’ai dit, et ce Patrès était extrêmement connu, et surtout connu pour un de ces hommes qui font contribuer.
J’attendis près d’une heure et je croyais qu’il allait faire comme ceux du Point-du-Jour.
Pendant ce temps, il avait fait le tour du pays avec son épée, afin de faire venir tout ce qu’il pourrait trouver d’habitants, et, en effet, plus de trois cents personnes étaient présentes. Plusieurs étaient armées d’échalas sur quoi l’on attache les cordes pour étendre le linge. Comme il aperçut mes amis qui étaient armés, il me dit qu’il ne voulait pas qu’ils approchassent. Je lui fis réponse que si ces gens-là, en montrant les gens du pays, n’approchaient pas, que les miens n’approcheraient pas non plus. Il se tourna vers ses connaissances et leur défendit de se mêler de sa querelle. Il me fit encore observer qu’il y avait défense faite de se battre dans le Bois de Boulogne, qu’il fallait rentrer dans le pays et que derrière des murs nous nous battrions. Je lui dis que je ferais deux, trois lieues, s’il le voulait, mais que pour rentrer dans son pays, je n’y rentrerais pas, vu l’affluence des spectateurs. Enfin, il se décida à se déshabiller, et nous mîmes l’épée à la main.
Je reçus un coup fort léger au ventre, ce qui ne m’empêcha pas de continuer et, après une minute, je lui perçai le bras jusque sous l’aisselle. Le sang commençait à couler. Je lui dis qu’il était blessé. « Tire toujours ! » cria-t-il, et il courut sur moi. Je lui pris un coup d’arrêt et lui frappai le second sur l’estomac : il tomba par terre ; alors les paysans qui étaient présents le ramassèrent et l’emportèrent chez lui.
Plusieurs de mes amis avaient pris mes habillements, de sorte que j’étais resté en bras de chemise pendant quelques minutes. La cavalerie de la maréchaussée vint et voulut m’arrêter ; mais en même temps se présentait le marquis de Livry qui descendit de cheval et s’informa comment la dispute était venue. Je ne lui cachai rien. Il m’accorda sa protection et me dit qu’il n’était pas fâché de cela, au contraire, que c’était un mauvais sujet de moins, et il renvoya la cavalerie. Plusieurs personnes vinrent lui dire que Patrès se mourait ; il me dit : « Allez-vous-en, et si les parents veulent faire des poursuites, réclamez-vous de moi. »
Je partis fort tranquillement ; arrivé à Passy, je commençai à perdre la respiration ; je me fis panser, et je repartis avec mes amis.
À la maison paternelle, contraint de me mettre au lit, je me fis saigner : le tout fut une affaire de six jours.
Les parents prirent bien quelque information contre moi : ils allèrent trouver Sommeiller, inspecteur de police militaire alors, mais j’étais appuyé par le marquis de Livry, de manière que toutes poursuites cessèrent.
Plusieurs autres aventures m’arrivèrent dans mon semestre : je fus contraint et forcé de tirer l’épée sept fois en six mois de temps ; mais les autres affaires furent sans graves conséquences. Enfin, je rejoignis le corps à Saint-Servan, d’où j’étais parti.
CHAPITRE VI
Maître d’armes. – On embarquait pour les Indes. – Déjà des trahisons. – Les millions de l’Actionnaire. – Le pillage. Et des bombances. – Chez la belle lsabeau. – Une vraie boucherie. – À l’hôpital. – Duel à la baïonnette. – Une double opération. – J’échappe à l’embarquement.
J’avais dans Paris fréquenté l’Académie, j’étais devenu fort sur les armes, de manière que je les enseignai à mes camarades pendant trois ans, temps qui me restait encore à faire de mes huit ans.
Nous partîmes, le second bataillon, de Saint-Servan, en 1781, pour embarquer à Brest en Bretagne, en vue d’aller aux Indes. C’était alors Langeron qui commandait. J’étais malade et je restais à Brest, à l’hôpital.
Une partie des bâtiments de transport furent pris par les Anglais ; les équipages furent faits prisonniers et conduits à Plymouth. Au bout d’un mois, deux cent cinquante hommes du régiment d’Aquitaine, qui avaient été pris, furent échangés et vinrent former un dépôt à Morlaix, en attendant un second embarquement. J’étais rétabli de ma maladie et je fus rejoindre le dépôt, à Morlaix.
Alors, il y avait déjà des trahisons et voyez la conséquence qui s’en tire selon mon jugement :
Les soldats embarqués sur le navire appelé l’Actionnaire nous ont rapporté qu’étant sur le bord, le vaisseau anglais qui les somma de se rendre leur dit avec un porte-voix : « Vous êtes l’Actionnaire, rendez-vous, vous avez sept millions à bord, ou bien nous vous allons couler à fond… »
L’Actionnaire se rendit.
À la vérité, les sept millions s’y trouvèrent : ils étaient à fond de cale. Plusieurs soldats de Roussillon et plusieurs d’Aquitaine descendirent à la cale et, avec une hache, brisèrent une caisse et emplirent leurs sacs ; les officiers des deux corps jetèrent leurs effets pour remplir leurs malles d’argent. Les officiers n’étant point fouillés par l’ennemi arrivèrent en Angleterre avec tout leur argent : aussi les ai-je vus après leur échange briller comme des lords… Les soldats ne furent pas si heureux, car ils furent déshabillés et fouillés, de sorte que seuls les cinq ou six qui s’embarquèrent dans les canots avec les officiers ont eu leur part…
Arrivé à Morlaix, comme je l’ai dit plus haut, je profitai de cet argent. Plusieurs de mes écoliers me firent présent, l’un d’une montre, l’autre de bas de soie, enfin, ces « braves gens » ne savaient que faire de leur argent ; aussi ne voyait-on qu’eux dans la ville faire des bombances ; j’ai fait avec eux des repas de sept cents livres.
Ce fut dans cet intervalle de temps que je fus blessé mortellement et bien malheureusement. Voici le fait :
Il était arrivé des prisonniers anglais à Brest, que l’on faisait refluer sur les derrières. En conséquence, un détachement les avait conduits depuis Brest jusqu’à Morlaix ; là, un autre détachement les reprenait et les menait jusqu’à Dinan où ils restaient en prison. Le sergent qui les avait conduits depuis Brest, était un de mes amis et parisien ; il s’appelait Bourgeau, dit Baisemoy, du régiment de Champagne. Comme il avait été maître d’armes, il fallut lui faire une réception. Tous les maîtres d’armes s’assemblèrent et l’on fit un assaut général ; les écoliers de chacun y furent invités ainsi que tous les amateurs. L’assaut fini, il fallut aller dîner, comme c’est l’usage. Il est bon de remarquer que Baisemoy était resté en garnison à Morlaix pendant dix-huit mois, qu’il y avait beaucoup de connaissances, entre autres une maîtresse nommée la belle Isabeau, qui tenait une auberge et donnait à boire. Isabeau avait une tante qui demeurait avec elle, et cette tante menait une petite boutique qui était en bas. Après le repas fini des maîtres d’armes, chacun s’en fut à son quartier. Bourgeau me dit : « Viens avec moi, nous allons aller dans une maison boire une bonne bouteille de vin. » J’observai que nous n’en avions pas besoin ; cependant, nous n’étions pas hors de raison, mais bien gaillards. Il me montra la porte et me dit : « Entre et demande une bouteille et trois verres. » J’entre et demande une bouteille. La vieille tante nous dit : « Montez ! » nous montons. Il y avait avec nous un nommé Bel-Air, du régiment de Bourbon-Infanterie. Sitôt que la vieille aperçut Bourgeau, elle nous dit : « Si vous êtes avec ce coquin-là, vous n’en aurez pas. » Cela ne nous empêcha pas de monter. La vieille criait de toutes ses forces : « Isabeau, voilà le coquin de Bourgeau qui monte : » Aussitôt un matelot, amoureux de cette belle Isabeau, depuis que Bourgeau était parti, prit la broche à rôtir où la gigue était après, et vint se placer derrière la porte d’entrée. Je me trouvais le premier et c’est moi qui fus embroché. Je sentis quelque chose de chaud qui m’était entré dans l’estomac : aussitôt, je me retourne sur le carré et je crie : Je suis blessé ! – Ce fut en ce moment que nous tirâmes nos sabres et que nous entrâmes tous trois le sabre nu à la main. Je courus sur celui qui avait la broche ; je parai de la main un second coup qu’il me portait et, d’un coup de sabre, je lui coupai le bras. Le coup ne fut pas plus tôt donné que je tombai par terre, moi d’un côté, et mon adversaire de l’autre. Quant à mes deux amis, ils furent assiégés aussi par d’autres matelots, mais ils eurent le bonheur de n’être pas blessés dangereusement, et ils en blessèrent trois, dont un eut le mollet coupé, un autre un coup à la cuisse, et le troisième au flanc, de sorte que nous nous sommes trouvés sept par terre : c’était une véritable boucherie ; le sang coulait dans la chambre de tous côtés.
La garde vint : une descente de justice se fit dans toutes les formes et l’on enleva les blessés. Pour moi, qui avais perdu connaissance, je fus mis sur un brancard et porté à l’hôpital des Dames. Je fus dix-huit jours dans le transport. Ce n’est qu’après six mois de traitement que je pus marcher avec des béquilles, et je me traînai ainsi pendant deux autres mois.
J’observe qu’on a fait courir le bruit que nous étions entrés le sabre à la main pour assassiner les matelots, tandis que c’est moi qui fus blessé le premier, et certes je n’avais pas plus que Bel-Air, aucune mauvaise intention, puisque je ne connaissais personne dans la maison, et même je n’y étais jamais entré ; à coup sûr, s’il y avait eu quelque dessein prémédité, j’aurais pris mes précautions, et j’aurais commencé par faire entrer Bourgeau, puisque je sus depuis qu’on avait cru le tuer, lui Bourgeau.
Celui qui eut le bras coupé fut porté au même hôpital que moi ; il fut guéri bien plus tôt, mais il resta estropié pour sa vie : il n’a plus qu’un bras. Nous eûmes conversation plusieurs fois ensemble étant à l’hôpital ; il m’avoua que Bourgeau s’était mal conduit, qu’il était entré chez la belle Isabeau, la veille, et qu’il y avait fait du dégât pour plus de cinquante écus en cassant la vaisselle. J’observe aussi que c’est le jour même de son arrivée qu’il alla seul chez son ancienne maîtresse ; la trouvant entre les bras d’un autre amant, il se porta à tous ses excès et ce n’est que le lendemain de son séjour que notre malheureuse scène arriva.
Au bout d’une année je fus guéri ; mais j’avais la poitrine qui me causait des douleurs.
Quatre mois après ma guérison, j’eus dispute avec un chasseur du régiment Royal-Vaisseaux qui m’avait provoqué sur tous points. Je m’étais déjà battu avec lui au fleuret moucheté, au sabre, et toujours il avait été blessé ; il me proposa le pistolet, que j’acceptai J’avoue que c’était la première fois que je me battais avec cette arme. Nous prîmes chacun deux témoins qui chargèrent les armes et nous placèrent près d’un buisson qui faisait le rond. L’un parti d’un côté et l’autre de l’autre, à la première rencontre on se tirait dessus à volonté. Je l’avais aperçu et je l’ajustais lorsque la peur le prit et il tomba par terre. Son pistolet lui échappa de la main, je saisis l’instant, je courus dessus, lui mis le pistolet sur la gorge et le forçai à me demander excuse, ce qu’il fit de la meilleure foi du monde. Il nous dit qu’il n’avait pu tirer la gâchette et qu’on lui avait donné le plus mauvais pistolet. Aussitôt un de ses témoins lui fit voir le contraire et déchargea le pistolet sur-le-champ : ainsi il fut prouvé qu’il n’avait pas assez de courage.
Cette affaire semblait arrangée, mais au bout de quelque temps, il me chercha encore castille : il fallut se battre avec des baïonnettes. Il fit si bien qu’il me tendit la baïonnette, et nous fûmes blessés tous les deux. J’avais tellement d’amour-propre que je ne voulus pas aller à l’hôpital comme lui. Je me fis panser à la chambrée par un de mes amis, de sorte qu’au bout de huit jours j’étais censé guéri, mais toutes les nuits, je perdais la respiration quand j’étais couché, et à force de me plaindre j’empêchais mes camarades de dormir. Le sergent de la chambrée me força d’aller à l’hôpital. À la visite du chirurgien-major, il fut reconnu que c’était un dépôt qui s’était formé dans l’estomac. On commença par ouvrir la première blessure qui était au milieu du téton droit, et l’on en fit sortir du sang caillé, ce qui me soulagea beaucoup, pendant plus de huit jours. Mais le dépôt avait tellement pris de force qu’après une consultation de chirurgiens, il fut décidé qu’on m’ouvrirait l’estomac. Je subis cette opération deux fois ; avec la première opération, la plaie n’était pas assez large ni assez longue pour la quantité de matière. – J’ai bien vu des plaies dans ma vie, mais jamais je n’en vis rendre de cette manière. Mes plus grandes souffrances ont été les pansements, et surtout quand on renouvelait le séton. J’ai souffert pendant deux mois consécutifs et je fus six mois à guérir.
J’étais convalescent lorsqu’on fit un second embarquement : je fus obligé de partir pour Brest. Langeron nous passa en revue. Je lui représentai qu’étant blessé comme je l’étais je ne pourrais pas supporter la mer ; il me fit réponse, avec cet air brutal que tous les militaires lui connaissent que cela n’empêchait pas de m’embarquer, et que je guérirais aussi bien à bord qu’à l’hôpital. Cela me déconcerta, car j’avoue que je ne voulais pas aller aux Indes faire la guerre à des hommes, sans savoir pourquoi.
Je montai donc à bord avec mes autres camarades, et le lendemain je fus à l’ambulance pour me faire panser par le chirurgien du bord. Sitôt qu’il vit ma plaie, il fut trouver le capitaine commandant et lui dit que j’étais hors d’état de pouvoir supporter la traversée et qu’il fallait me débarquer. L’on me mit à terre avec un billet d’hôpital : je fus à Recouvrance et j’y restai jusqu’à ce que le convoi fût parti.
J’étais attaqué d’une hernie d’estomac : on me fit faire un bandage avec un certificat constatant que j’étais hors d’état de supporter la mer. Ce certificat est signé du chirurgien-major des hôpitaux militaires, Girardeau [3].
Je m’en retournai à Morlaix joindre le dépôt qui y était resté. Ce dépôt était composé de toutes sortes d’infanteries restées malades en route. Beaucoup n’avaient pas voulu embarquer et avaient employé toutes les sortes de ruses dont le soldat est capable.
Le détachement qui prit la mer n’eut pas plus de bonheur que la première fois ; il fut fait prisonnier et envoyé à Worcester ; il n’y resta qu’un mois, fut échangé, repassa en France et vint encore à Morlaix où nous restâmes pendant deux mois.
CHAPITRE VII
En route pour Longwy. – Soldats contrebandiers. – Le souper de Verneuil. – Huit jours à Paris. – La prison en route. – Repas fraternels. – Une lettre des grenadiers de la Sarre. – Les usages du régiment. – Encore les petites questions. – Mon congé absolu.
L’ordre nous vint de rejoindre notre premier bataillon et nous nous mîmes en route pour Longwy, où il était en garnison.
En partant de Morlaix, je n’avais pas d’argent ; je fus trouver mon capitaine pour qu’il m’avançât sur ma masse : j’y avais trente-six francs, et l’ordonnance n’était que de quinze francs. Malgré mes réclamations, qui étaient justes, je ne pus rien obtenir de lui.
Je fus contraint de faire la contrebande du sel avec d’autres soldats. Nous fûmes assez heureux et, y ayant trouvé intérêt, nous fîmes une seconde expédition avec des chevaux que les bourgeois de Mortagne nous avaient prêtés, à condition que sur trois chevaux, il y en aurait un chargé à leur profit, ce que nous avions accepté. Mais nous fûmes vendus et les gabelous vinrent pour nous arrêter. Nous fîmes contenance et, comme il était nuit, ils ne pouvaient savoir combien nous étions. Ils eurent peur par deux coups de fusil que nous tirâmes en l’air, de manière qu’ils se mirent aux barrières et les fermèrent. J’y fus seul, armé ; mes autres camarades, au nombre de trente, étaient en bataille vis-à-vis de la barrière et à une demi-portée de fusil, mais ils faisaient plus de tapage que s’ils avaient été deux cents. J’entrai dans le corps de garde des employés et leur dis que nous étions militaires qui nous étions résolus à faire ce métier afin de nous procurer de l’argent pour faire la vie. Le brigadier ainsi que les subalternes nous ouvrirent la barrière, rentrèrent dans leur corps de garde, soufflèrent leur lumière et nous laissèrent passer.
Depuis huit jours, nous manquions à l’appel, de manière qu’on attendait que nous soyons tous rentrés pour nous mettre en prison. Nous restions encore quatre en arrière, qui ne parûmes au détachement que près de Verneuil. Il nous restait à chacun cent cinquante francs en écus. C’était beaucoup en ce temps-là, et surtout pour des soldats. En arrivant à Verneuil, il était nuit, nous envoyâmes chercher chacun nos amis et plusieurs du grade de sergent ; nous soupâmes tous ensemble. Le sergent de ma compagnie me dit qu’il était obligé de rendre compte de mon arrivée, qu’il fallait m’attendre à aller en prison ; sur quoi je lui dis : Pour ce coup-ci, je ne l’ai pas volé. Il fut après souper, rendre compte au capitaine-commandant. Pendant ce temps, je partis et m’en allai à Paris voir ma famille. J’avais fait une permission moi-même, présumant bien qu’étant Parisien, on me garderait à vue pour que je n’aille pas au pays, mais je les prévins. Je fus arrêté à Houdan par des cavaliers de maréchaussée ; je leur montrai ma permission, et ils me laissèrent passer. Je restai huit jours à Paris à me divertir, après quoi, je partis pour rejoindre le détachement qui était près de Châlons.
En arrivant, on me mit à la tête du détachement, l’habit retourné et je fus en prison le long de la route.
Arrivé à Verdun, on me mit en prison à la ville. Le régiment était lié d’amitié avec le nôtre. Les maîtres d’armes des chasseurs s’en furent demander ma liberté à notre capitaine qui la leur refusa, mais ils furent trouver leur colonel ; le colonel de la Sarre l’obtint de mon capitaine et je fus mis en liberté, à condition que je me constituerais prisonnier en partant de Verdun, jusqu’à la garnison. Je pus donc me divertir avec mes camarades.
Le lendemain, il y eut un assaut entre les maîtres des chasseurs, moi, et les bons écoliers qui étaient dans notre détachement. Tout se passa le mieux du monde jusqu’au soir où les grenadiers vinrent me demander de faire assaut avec eux. Les chasseurs de la Sarre étaient en dispute avec leurs grenadiers, de sorte qu’ils s’y opposèrent fortement : je fus donc obligé de refuser, et ceux-ci en tirèrent vengeance, comme on va le voir par la suite.
J’arrivai prisonnier à Longwy jusqu’à la ville basse et l’on me mit en liberté pour entrer dans la garnison. Il y eut des repas fraternels entre ceux qui arrivaient et ceux qui y étaient. Cela dura pendant quatre jours.
Je n’avais plus que deux mois à faire pour mon congé absolu. Le major d’Allons, dont j’aurai occasion de parler dans la révolution du 10 août, avait reçu une lettre que les grenadiers de la Sarre avaient écrite au premier maître des grenadiers de Royal-Roussillon. Ce maître d’armes, après en avoir fait lecture à la compagnie de grenadiers, la porta au major qui me fit appeler. J’y fus : il me fit lecture de la lettre ; elle était à peu près conçue ainsi :
« Les maîtres des grenadiers de la Sarre à leurs amis de Royal-Roussillon.
« Votre détachement a passé à Verdun ; nous nous sommes empressés de le recevoir ; mais nous sommes affligés de vous marquer que le nommé Rossignol nous a provoqués d’une manière outrageante pour des militaires. Après le repas, on lui a proposé de faire assaut ; il a répondu qu’il n’y en avait pas d’assez fort pour se mesurer avec lui… Les grenadiers espèrent que vous corrigerez cet impertinent comme il le mérite. Si la retraite n’avait battu, nous l’aurions corrigé nous-mêmes. Il nous a été rapporté qu’il allait avoir son congé absolu, nous lui donnerons la passade. »
La lettre était signée par les deux premiers maîtres du régiment de la Sarre au nom de tous.
On me fit lecture de la lettre chez le major et l’on me questionna sur le contenu. Je répondis que la lettre était remplie de faussetés et que je ne leur avais tenu aucun propos malhonnête, que c’était une méchanceté de leur part pour ce qu’ils ne pouvaient tirer vengeance de leurs chasseurs, je ne les avais vus que le soir, veille de mon départ, et toute la compagnie des chasseurs attesterait que je ne leur avais fait aucune insulte.
Le major me dit que je serais puni. Je lui demandai à écrire aux chasseurs ; je leur écrivis, mais ce fut de la prison… car j’y fus condamné pendant un mois, et mis au piquet, une fois par jour, à l’heure de la parade. C’est, de toutes les punitions que j’ai essuyées, celle qui m’a fait le plus de peine.
J’ai aussi porté des fusils, au nombre de dix, c’est-à-dire cinq sur chaque épaule. Ce fut à Saint-Servan que je fus condamné à cette peine ; j’avais été chercher du bois pour faire la Saint-Martin afin que l’argent nous servît à avoir quelques pots de cidre. Nous eûmes tort… mais surtout de nous faire prendre : ce fut le sergent-major qui nous dénonça. Quoique ce fût la mode de recevoir des coups de plat de sabre, on ne m’en a cependant pas distribué. Je n’ai pas non plus bu d’eau – car ceux qui avaient le malheur de se griser étaient condamnés à boire, le lendemain, un seau d’eau de huit pintes.
Dans ce régiment, et depuis que nous avions pour colonel le marquis de Vauborel, qui n’était autre chose qu’un bigot, dans chaque chambre il y avait une prière du matin et une du soir, que le chef de chambrée était obligé de faire tous les jours, le matin au roulement et le soir une demi-heure après la retraite. Tous les dimanches et fêtes, il fallait aller à la messe du régiment. Pour lui, colonel, il ne manquait jamais les vêpres et encore moins le salut, de sorte que les autres troupes de lignes nous appelaient le régiment des capucins, ce qui de temps en temps nous attirait des disputes où plusieurs furent tués sans compter les blessés. Je me rappelle qu’un jour j’étais le plus ancien de chambrée, parce que le caporal était de garde, le sergent-major dont j’ai parlé voulut me faire lire la prière, je lui fis réponse que je ne savais pas lire : il me fit mettre en prison quinze jours. Du reste, le régiment était assez tranquille et bien entretenu.
Au bout de mes huit ans, jour pour jour, j’ai eu mon congé. J’essuyai cependant une petite difficulté au moment où l’on devait me délivrer. Il m’était dû de mes écoliers une quarantaine de livres et je leur en devais une trentaine. Ceux à qui je devais furent chez le major pour être payés : cela était juste. Le major me fit appeler et me dit que je n’aurais pas ma cartouche si je ne payais mes dettes. Je lui fis réponse que je ne demandais pas mieux de payer ce que je devais, mais qu’il était de toute justice qu’il me fît payer ce qui m’était légitimement dû. Sur quoi, il me répondit que je payerais et que je ne serais pas payé. Cela me mit en colère et je lui dis : Puisque vous exigez que l’on me fasse banqueroute, moi je vous avertis que je ne peux payer qu’après être arrivé à Paris, puisque je n’ai que juste l’argent pour faire ma route. – Et je sortis de chez lui. Cependant, à l’heure de la parade, il fut ordonné que tous ceux qui me devaient reconnaîtraient leur dette en présence d’un sergent-major, et que celui-ci me rembourserait ; ce qui fut exécuté. Je fus payé et je payai : cela me mit une quinzaine de livres de plus dans ma bourse.
Je partis[4] après avoir vendu tout ce qui avait rapport à l’habillement militaire ; je ne voulus plus rien revoir de ce qui avait rapport au métier de soldat tant je le détestais.
Comme je savais être attendu à Verdun par les maîtres des grenadiers du régiment de la Sarre, je fis courir le bruit que je ne partirais que trois jours après mon congé. Le soir, on me délivra ma cartouche et le lendemain matin, à la poste, je louai une voiture qui me fit la moitié du chemin de Longwy à Verdun. Je voyageai avec mon ancien camarade, celui-là même qui s’était engagé en même temps que moi, à Paris, en 1775. Nous eûmes soin de n’arriver que comme on allait fermer les portes de la ville, et nous fûmes coucher de l’autre côté, afin de n’être pas surpris dans la ville par aucun militaire.
Nous n’avons essuyé aucun accident dans notre route, et nous sommes arrivés à Paris après cinq jours de marche.
CHAPITRE VIII
Je reprends mon métier. – Bonne paye et malchance. – Entre maître et compagnon. – Je me moquais de ses grenades. – Bousculade dans la cour du Palais. – « Montez en voiture ! » – Étapes du travail.
Mon camarade resta avec moi quatre jours pour se divertir ; après ce temps il partit pour Angers, son pays natal. Pour moi, au bout de huit jours, je me mis à travailler : ce fut chez le nommé Sommier, que je travaillai en sortant de la troupe. Pendant un an il fut assez content de moi, et moi de lui ; mais il survint une dispute entre le maître et le compagnon qui fut une cause que nous ne nous sommes jamais parlé depuis. Voici le fait en peu de mots : j’avais, depuis un mois, occupé une place avantageuse et très préférable, puisque celle que je quittais ne me rapportait qu’un écu par jour, tandis que la dernière me rapportait huit et neuf francs, ce qui fait deux fois de plus la valeur. Il est bon de savoir que j’avais remplacé un autre ouvrier qui revint demander de l’ouvrage. La place lui fut rendue et l’on voulut exiger de moi que je reprisse ma première. Je ne voulus pas d’évêque devenir meunier, et je fus porter mon mémoire au patron en lui disant que je ne voulais plus travailler chez lui. Cet homme était brutal, fier, hautain ; jamais ouvrier ne lui avait demandé son compte ; il fut si en colère qu’il déchira mon mémoire et dit qu’il fallait que je finisse la semaine. Je lui dis qu’il ne cherchait pas le jour, lui, pour me faire une sottise, qu’il n’y avait pas d’arrêt de la cour du Parlement qui me forçât à travailler chez lui… Enfin, de part et d’autre, nous nous échauffâmes et l’on fut obligé de nous séparer. Je sortis de la boutique ; il me suivit et me voulut forcer à me battre. Il est bon d’observer qu’il avait servi dans l’arquebuse. Je le plaisantais, à la vérité, sur ses grenades… Il me proposa d’aller aux Champs-Élysées nous battre à coups de canne ; je ne voulus jamais y consentir. Il me mit à plusieurs reprises le poing sous le nez. La patience à la fin m’échappa : je le jetai, lui d’un côté, sa pipe et son bonnet de l’autre. Cette affaire se passait dans la cour du Palais. J’eus la chance de sortir et d’échapper à la garde, qui courait après moi. Il ne fut pas content de cette petite correction : il me suivit et, au quai de la Vallée, il voulut me faire monter en voiture pour aller nous battre. Je ne voulus pas, mais je lui dis : Montez dans la voiture, je vais vous suivre ; – ce qu’il fit, et il crut, jusqu’au quai des Théatins, que réellement je le suivais ; cependant il en fut désabusé, et il s’en retourna chez lui en voiture.
Cette dispute me fit tellement haïr que personne ne voulait plus me donner de l’ouvrage. Cependant j’entrai chez un orfèvre pour le moins aussi brutal. Ce fut dans cette boutique que je me perfectionnai. L’ouvrage vint un peu à baisser ; j’eus quelque dispute militaire ; je fus contraint de quitter Paris, et je fus trois ans passés en province. Je n’avais pas vu la Provence et ce fut de ce côté que je fis une tournée.
Je suis resté deux ans à Toulouse.
DEUXIÈME PARTIE
CHAPITRE IX
Mon ignorance révolutionnaire. – Henriot levait l’impôt du marché. – Scènes de pillage et de probité. – Remarques sur l’affaire Réveillon. – Le peuple contre les soldats. – Simple observation.
Le 12 juillet 89 je ne savais rien de la Révolution, et je ne me doutais en aucune manière de tout ce qu’on pouvait tenter.
D’abord, beaucoup de troupes que je fus voir au Champ-de-Mars, par curiosité.
Je connaissais et j’avais vu l’affaire Réveillon, qui a été très funeste au peuple. Cela dura trois jours. Le premier jour, en allant visiter mes parents qui étaient établis au faubourg Antoine, je m’étais aperçu que, sur les cinq ou six heures du soir, une troupe d’ouvriers, environ cinq ou six cents, armés de bâtons, bûches, piques, fourches, etc., s’attroupaient et faisaient des motions pour brûler la maison de Réveillon et celle du nommé Henriot, maître salpêtrier.
D’abord le bruit avait été répandu par tout le faubourg que les ouvriers étaient déjà trop payés à raison de vingt sols par jour.
Henriot retirait alors l’impôt sur le marché de toutes les marchandises qui y étaient exposées ; il exigeait qu’on lui payât son tribut d’avance et le demandait souvent avec une arrogance… telle qu’était son caractère ; en sorte que le peuple était outré contre lui.
Sa maison fut dévastée et tous ses effets furent portés dans un grand feu au milieu du marché. On avait établi une barrière, et toutes les personnes qui sortaient étaient fouillées. Tant pis pour celui qui se trouvait porteur de quelques effets volés ; on les lui faisait jeter dans le feu, puis il recevait des coups selon le vol qu’il avait fait. Enfin tout fut brûlé, jusqu’à l’argenterie, et les balcons furent brisés et mis aux flammes. La maison devait l’être aussi, mais on fit observer justement que, si l’on se portait à cette barbarie, plusieurs propriétés seraient également brûlées. On voulait pendre le propriétaire, mais il eut soin de monter à cheval et de se sauver au grand galop.
Mais voici un trait bien remarquable qui est malheureusement arrivé chez Réveillon : les gardes-françaises s’étaient emparés de toute la rue de Montreuil et par conséquent aucun ouvrier n’y était plus ; mais on vint leur dire que l’on se rassemblait pour faire une seconde marche sur la dite maison : les hommes qui s’avançaient étaient armés de bûches, piques, fourches, bâtons. Que firent les deux compagnies de gardes-françaises ? – Elles abandonnèrent le poste, et marchèrent par peloton jusqu’à la hauteur de la Barrière. Alors les hommes armés, voyant ce rétrograde de la troupe, tombèrent dans le piège qui leur était tendu : ils se portèrent en foule dans la maison ; beaucoup jetaient les meubles par les fenêtres d’autres descendirent dans les caves. Ce fut un quart d’heure après qu’ils furent entrés que les gardes-françaises remarchèrent au pas redoublé et attaquèrent la maison par une décharge du premier peloton ; ensuite le deuxième peloton entra dans la cour, et fit une deuxième décharge ; les hommes du troisième marchèrent par le flanc de droite et de gauche et passèrent dans un grand jardin où ils firent un feu de file terrible sur les personnes qui se sauvaient. Le quatrième et le premier pelotons firent un feu de peloton sur les citoyens qui étaient dans la rue. Tous ceux qui étaient dans le jardin et dans les caves furent tués.
Royal-Cravate bordait la chaîne dans la grand’rue à la hauteur de la maison de Réveillon ; une compagnie était en bataille au milieu de la grand’rue à la hauteur de l’église Saint-Pierre ; une autre compagnie de cavalerie dont je ne me rappelle pas le nom y était aussi : c’était, je crois, le régiment de Berry. Là, il y eut trois hommes blessés des coups de sabre de cette cavalerie. Ce fut alors que les Suisses arrivèrent en colonnes avec leurs pièces de canon : heureusement les troubles commençaient à s’apaiser ; mais les esprits s’échauffaient et, des maisons, l’on commençait à jeter des pierres. Plusieurs spectateurs furent tués aux fenêtres, même aux fenêtres des maisons d’où l’on n’avait rien jeté. On n’a jamais su le nombre des personnes tuées dans cette affaire, mais je puis attester que j’en ai vu plus de cent cinquante, encore n’ai-je vu que ceux tués dans le jardin et ceux de la rue vis-à-vis la maison de Réveillon. Le coup de feu dura pendant une bonne heure, mais les Suisses n’y ont aucunement participé ; ils n’y ont pas même brûlé une amorce.
Toute la garnison fut contrainte de se retirer parmi les huées. Ils quittèrent le carnage vers les sept heures du soir et ne rentrèrent plus dans le faubourg, pas même pour monter la garde dans les postes qui leur étaient destinés, et dont ils faisaient le service régulier. Le peuple s’était porté dans tous les corps de garde et en avait brisé les lits de camp, ôté les bancs, poêles, etc., et fermé les portes. La haine des habitants dans ce quartier contre les gardes-françaises était à un tel point qu’aucun de ceux-ci ne pouvait venir dans le faubourg sans y être poursuivi par des coups de bâton et des injures terribles. Plusieurs y furent tués les uns après les autres. Cette animosité dura jusqu’au moment où ils sauvèrent la France à l’affaire de Versailles, lorsqu’ils refusèrent d’obéir à leurs chefs. Ce fut à cette époque que toute querelle personnelle cessa.
J’observe que, dans l’affaire Réveillon, aucun officier n’était à leur tête : il n’y avait pour commander cette troupe que des sergents. Et j’ai remarqué qu’avant le coup de feu il est arrivé un homme à cheval, qui venait par les derrières du faubourg et qui a donné des ordres : ce fut trois minutes après qu’il fut parti, par le même chemin qu’il était venu, que le feu commença.
CHAPITRE X
Le 12 juillet. – Les violons quittent le bal. – Vive le Tiers-État ! – Crier sans comprendre. – Le 13 au matin. – Au Palais-Royal. – La cuisinière aux écus. – Dans l’église de ma paroisse. – Ces gros aristocrates. – Les bras retroussés. – « Vous trompez le peuple ». – Tous coquins. – À la santé du Tiers-État.
Je reviens au 12 juillet :
C’était un dimanche et j’étais allé, avec quatre de mes amis, en promenade du côté de Belleville, et sur le coup de six heures nous étions entrés chez un marchand de vins à l’enseigne du Fer à Cheval, pour nous y rafraîchir, et vers les huit heures j’avais pris un cachet pour danser une contredanse. On vint répandre le bruit qu’on abattait les barrières et qu’on les brûlait. Tout le monde quittait les divertissements, et chacun se retirait. Les joueurs de violon s’en allaient avec les autres personnes ; mais, comme j’avais payé ma contredanse, je leur dis : J’ai payé les violons et je veux danser. La terreur était chez eux ; ils n’eurent pas le courage de continuer et par conséquent je me fis rendre mon argent. Ce fut dans cet endroit que j’appris l’affaire des Tuileries, qui avait eu lieu ce jour-là : le prince Lambesc et sa troupe contre le peuple.
Je pris donc le chemin pour m’en retourner au port Saint-Paul, lieu de ma résidence chez ma mère, et vis, à la vérité, que l’on jetait les barrières en bas et que plusieurs étaient brûlées. Une troupe que l’on appelait les passeux, c’est-à-dire les contrebandiers, s’était chargée de cette expédition. Sans aucune résistance, toutes les barrières dans la même nuit furent jetées par terre. Ils étaient armés de bâtons, fourches, etc. Tous les individus qui passaient, ils les interpellaient : « Es-tu du Tiers-État ?… Crie : Vive le Tiers-État ! » Je criai vive le Tiers-État, et l’on ne me fit aucune peine. Mais un d’entre nous, par entêtement, ne voulut pas crier, et je puis dire qu’il ne connaissait pas le mot ; il fut arrêté parmi nous et conduit depuis la barrière du Temple jusque sur les marches du pas de l’hôtel de ville, où on lui fit faire amende honorable. J’étais resté désespéré de ne pouvoir le venger, parce qu’il y avait impossibilité : ils étaient plus de deux cents pour cette expédition. Je lui représentai, cependant, qu’il fallait faire comme les autres et que le nom de Tiers-État voulait dire classe d’ouvriers, et que, puisqu’il l’était lui-même, il ne pouvait faire autrement. Après cependant bien des instances, il reçut plusieurs coups de bâton, et il se détermina à crier : « Vive le Tiers-État ! » et il fut abandonné et contraint de se sauver chez lui ; heureusement que ce n’était pas loin, car il demeurait sur le quai Pelletier. Je rentrai à la maison de suite.
Le 13 au matin, je fus du côté de la rue Saint-Honoré. Là, je rencontrai une foule de citoyens qui marchaient ensemble armés de bâtons, épées, pistolets, fusils de chasse, qu’ils prenaient chez les fourbisseurs. Plusieurs d’entre eux me demandèrent si j’étais du Tiers-État, je leur répondis que oui, et ils ajoutèrent : « Eh bien, marche avec nous ! » Je leur fis observer que je ne pouvais agir, vu que je n’avais point d’armes. Ils me dirent qu’il y en avait chez un fourbisseur, rue Plâtrière ; j’y courus, mais toutes les armes étaient prises. – Je fus au Palais-Royal : là je vis des orateurs montés sur des tables, qui haranguaient les citoyens et qui réellement disaient des vérités que je commençais à apprécier. Leurs motions tendaient à détruire le régime de la tyrannie et appelaient aux armes pour chasser toutes les troupes qui étaient au Champ-de-Mars. Ces choses m’étaient si bien démontrées que je ne désirais plus que l’instant où je pourrais avoir une arme afin de me réunir avec ceux qui étaient armés. Comme j’étais à écouter un orateur, on vint nous avertir que l’on savait un endroit où il y avait plus de deux cents fusils et même autant de pistolets. Je vis aussitôt plus de six cents individus qui me dirent, après leur avoir demandé où ils allaient : « Nous allons chercher des armes, près d’ici. » Je les suivis. C’était chez le nommé Site, au premier au-dessus du café de la Régence. La porte de l’allée était fermée ; les esprits s’échauffaient et l’on fit la motion qu’il fallait la jeter en dedans ; mais plusieurs montèrent pardessus et l’ouvrirent. Ce fut alors que je dis à tous les citoyens qui étaient là qu’il y avait dans la maison des effets très précieux et que, si tout le monde entrait, ces effets seraient brisés, qu’il ne fallait prendre que les armes défensives. En conséquence, je les invitais à nommer plusieurs personnes qui feraient la visite et qui distribueraient les armes tant qu’il y en aurait. Ce que je proposais fut appuyé et je fus nommé un des personnages chargés de cette recherche. Nous y fûmes, moi et un autre citoyen que je n’ai jamais revu par la suite. Dans l’escalier, nous rencontrâmes la cuisinière qui avait dans son tablier beaucoup d’écus de six livres ; il y avait aussi parmi les gros des petits écus de trois livres. Je lui demandai où elle portait cet argent ; elle me dit que c’était pour jeter à ces gens-là. Je lui dis que nous ne venions pas pour avoir de l’argent mais des armes, que nous savions qu’il y en avait et qu’il nous les fallait. Elle me répondit qu’elle n’en connaissait pas dans la maison. Sur le carré du magasin je rencontrai le domestique, qui avait aussi un sac d’au moins douze cents livres : il me dit que c’était pour le même objet ; alors les garçons de magasin se présentèrent. Je leur fis part de la demande dont j’étais chargé par le peuple. Ils me répondirent, à trois qu’ils étaient, qu’il n’existait aucune arme dans le magasin, ni même dans la maison. Je leur dis que je ne pouvais me contenter de leurs réponses, qu’il me fallait voir par moi-même, ainsi que le citoyen qui était avec moi, que nous avions été nommés exprès pour cela, et que le seul moyen à employer était de nous ouvrir les portes, afin d’éviter que le magasin fût dévasté : ils se décidèrent à les ouvrir et nous fîmes la perquisition partout ; je puis attester qu’elle fut faite exactement, sans qu’il y ait eu un seul objet de cassé.
Je me mis à la fenêtre et je dis à mes concitoyens que nous venions d’examiner tout en général, et qu’il n’y avait aucune arme, que l’on nous avait trompés. On me fit réponse que les armes étaient cachées sur les toits ; je me transportai sur le toit, je fis la visite que l’on exigeait, mais je ne trouvai rien qui fût propre à la défense. Je redescendis et je vis avec douleur que plusieurs individus, et particulièrement trois soldats de Vintimille, déserteurs de leur régiment, qui était alors à Saint-Denis, se battaient dans les escaliers et ramassaient les écus qu’on leur jetait parce qu’ils avaient menacé le magasin. Cet argent semé évita que le magasin fût attaqué. – Je puis dire que moi et le citoyen qui était avec moi avons fait tous nos efforts pour empêcher ces excès… et nous avons réussi.
Le 13 juillet au soir je retournais dans mon quartier, quand l’on me dit qu’on distribuait des armes à la paroisse. J’y fus avec une douzaine de mes concitoyens, tous enfants du même quartier et desquels j’étais bien connu. Nous nous rassemblâmes, entre gens de connaissance, et nous nous trouvâmes plus de soixante dans un instant, tous bien décidés, car la plupart d’entre nous avaient au moins un congé de service dans la ligne. Nous entrâmes dans l’église ; nous y vîmes tous ces gros aristocrates s’agiter ; je dis aristocrates, parce que, dans cette assemblée, ceux qui parlaient étaient pour la plupart chevaliers de Saint-Louis, marquis, barons, etc. Le seul homme qui me plût, et que je ne connaissais pas, fut le citoyen Thuriot de la Rozière, qui s’est bien montré dans cette assemblée. Là, on était occupé à nommer des commandants, des sous-commandants, et toutes les places étaient données à ces chevaliers de Saint-Louis. Enfin, je fis une sortie contre cette nomination parce qu’aucun citoyen n’y était appelé.
Un nommé Dégié, alors notaire, Saint-Martin et les derniers chevaliers de Saint-Louis proposaient les candidats. Je fus si outré de voir cette clique infernale se liguer pour commander les citoyens que je demandai la parole. Je montai sur une chaise et je leur dis que l’on commençait par où l’on devait finir, et que ce n’était pas de cette manière qu’il fallait agir pour nous préserver des troupes qui étaient aux environs de Paris, que de tous les commandants que l’on venait de nommer aucun n’était dans le cas d’empêcher que les citoyens fussent massacrés.
On me dit que je n’avais qu’à en donner le moyen.
Je leur répondis qu’il fallait commencer par avoir des soldats et ensuite des armes à leur distribuer : – qu’il fallait absolument des armes pour pouvoir se défendre ; – ensuite on devait se rassembler par quartiers ; chacun étant armé, chacun devait avoir le droit de nommer son chef ; – dans chaque quartier il fallait établir des postes d’observation ; une forte garde resterait en dépôt dans un endroit désigné et surtout dans le centre du quartier, afin de se trouver à portée de secourir chacun des avant-postes. La difficulté était d’avoir des armes. Je proposai d’aller chez tous les seigneurs qui résidaient dans la paroisse, d’y faire une perquisition et d’apporter dans l’église toutes les armes que l’on trouverait. J’ajoutai que la distribution devrait en être faite légalement par chaque quartier, en donnant surtout les fusils aux mains des hommes connus qui en savaient le maniement : c’était là le bon moyen, selon moi.
Ma motion fut rejetée et improuvée comme venant d’un homme suspect, et le Bossu, alors curé de Saint-Paul, dit qu’il fallait me mettre à Bicêtre ; ce à quoi je répliquai que j’étais soutenu de tout mon quartier et que, s’il voulait me faire arrêter, j’allais lui tomber sur le corps. En me regardant, il vit que j’étais entouré de plus de trente hommes qui avaient les bras retroussés : il eut peur et ne souffla plus mot. Plusieurs de mes amis me dirent : « Allons-nous en », et je m’en fus.
Deux des motionneurs descendirent de la chaire à prêcher qui s’appelait alors l’égrugeoir et me suivirent sur le portail ; ils me dirent que dans deux heures la Ville allait leur envoyer deux cents fusils ; je leur répondis que tous les échevins étaient des coquins et que dans quatre heures même aucun fusil ne viendrait. La vérité fut telle que je restai jusqu’à neuf heures du soir sans qu’aucun fusil arrivât de la Ville, encore moins des autres endroits.
À neuf heures, on vint me dire que l’on faisait des listes chez le curé. Je m’y rendis et j’y fis grand tapage afin qu’aucun de mes amis venus pour s’inscrire sur cette liste, qui était à bien nommer liste de proscription, n’y fût inscrit ; et je demandai : Où sont les fusils de cette Ville, que vous aviez promis dans deux heures ? en voilà six de passées et rien n’est encore arrivé ! – Thuriot qui était là me dit : « La Ville nous a trompés. » – Eh bien, vous, vous trompez le peuple et c’est encore pire ! Il y a des armes sur la paroisse, à toutes ces belles portes cochères qui sont sur la place Royale. Croyez-vous qu’il n’y en ait pas chez ces gens-là ? – Il me répondit que sans doute il devait y en avoir. J’ajoutai : Si tous ces meneurs avaient une bonne intention, ils viendraient avec leurs armes et donneraient l’exemple ; dès qu’ils ne le font pas, il faut qu’ils soient désarmés et que leurs armes soient entre les mains du Tiers-État. Je fus encore hué dans le comité de tous ces chevaliers, mais je fus appuyé par Thuriot.
Mes camarades et moi nous les laissâmes délibérer et nous nous en fûmes boire, tout le Tiers-État ensemble, avec promesse de nous rejoindre le lendemain, le plus qu’il nous serait possible, afin d’avoir des armes.
CHAPITRE XI
Le 14 juillet. – Thuriot de la Rozière va aux renseignements. – Quarante mille fusils aux Invalides. – La cocarde verte. – Dans le courant. – Le peuple était debout. – Ce que j’ai vu. – Les femmes et les enfants servaient le feu. – La trahison du mouchoir blanc. – La capitulation. – Dans la Bastille – Sur les tours. – Les vrais vainqueurs.
Le 14 juillet, sur les neuf heures du matin, je revenais avec un de mes amis de déjeuner, et devant Saint-Paul beaucoup de personnes étaient inquiètes à cause des bouches à feu qui étaient sur la Bastille. Je soutins qu’il y avait des Suisses qui avaient renforcé la garnison, et qu’il fallait prendre des mesures à ce sujet. Il fut arrêté que Thuriot de la Rozière irait aux renseignements près du gouverneur et qu’il en rendrait un compte exact. Il s’acquitta de cette mission importante suivi de beaucoup de citoyens qui l’accompagnèrent à la Bastille, mais lui seul y entra.
À ce moment, on fit courir le bruit qu’il y avait quarante mille fusils aux Invalides et, comme je n’étais point armé, je partis avec un de mes amis et je fus aux Invalides. Après bien des peines, je parvins à avoir un fusil : ils étaient dans des caves, sous le dôme. Il y eut plusieurs personnes qui périrent là : il n’y eut que la force que j’avais qui me retira de cette foule, où j’avoue que je manquai d’être étouffé, mais j’y eus un fusil et je revins dans mon quartier.
On me fit prendre en route une cocarde verte, et, quand je fus arrivé dans mon quartier, on criait : À bas la cocarde verte ! Je fis tout ce que les autres voulaient ; je suivais le torrent sans pouvoir en apprécier rien : toutes ces particularités-là étaient hors de ma portée.
Il était midi quand j’arrivai au quartier Saint-Paul. Il ne me manquait plus que des cartouches. Un de mes amis avait plus de deux cents livres de poudre. On fit acheter des balles de calibre et nous fîmes des cartouches.
Nous étions ainsi occupés à huit personnes quand on vint nous dire que l’on assassinait nos frères à la Bastille : nous y fûmes tous les huit. En passant dans la grand’rue Saint-Antoine, un coup de canon à mitraille fut tiré de la Bastille et tua un facteur de la petite poste, près de l’église dite anciennement « les Jésuites ». Je quittai la chaussée, je mis en file les hommes qui étaient avec moi, et nous marchâmes à la Bastille le long des maisons.
J’observe qu’à ce moment aucun individu n’était en marche et même que toutes les boutiques et toutes les entrées quelconques étaient fermées ; en conséquence aucune retraite n’était assurée. Mais ce qui me choqua le plus ce fut une compagnie de gardes-françaises qui était en bataille dans le cul-de-sac Guéménée. Je m’adressai aux sergents, car il n’y avait aucun officier, et je leur dis : Messieurs, on assassine nos frères à la Bastille et vous ne pouvez leur porter aucun secours, étant placés dans cet endroit. J’ajoutai qu’il leur fallait venir avec nous. Ils me répondirent que c’était leur poste. Je leur dis que leur poste, pour des soldats, était où il y avait du danger et non derrière les maisons. Je ne pus obtenir d’eux d’autre réponse que celle-ci : ils resteraient là jusqu’à nouvel ordre. Je fis alors observer au sergent qui commandait cette compagnie qu’il y resterait longtemps, puisque le peuple était debout, et que par conséquent il n’y avait point de chef. Malgré ce langage, les gardes-françaises ne voulurent pas nous suivre.
Nous entrâmes à la Bastille par la grille qui donne dans la grand’rue.
En y entrant tous les huit, nous montâmes dans la salle d’armes qui avait été déjà saccagée par le peuple, et tout y avait été pris. C’était dans cette salle que l’on avait pris tous ces vieux drapeaux des anciennes guerres ; il y avait aussi des haches, des vieux sabres et quelques vieux fusils : on prit tout ce qui s’y trouvait.
Au-dessous de cette salle d’armes était la caserne des Invalides que ceux-ci dès la veille avaient abandonnée pour se réfugier dans la Bastille même.
Ce fait me fut confirmé quelque temps après par les Invalides mêmes qui ne périrent pas dans l’affaire. Plusieurs d’entre eux convinrent avec moi, en présence de témoins, que, sur les onze heures et demie, ils avaient fait feu sur le peuple et que l’officier suisse avait dit devant eux, ainsi qu’en présence des officiers de l’état-major de Delaunay, gouverneur, qu’ils étaient assez forts pour défendre la place jusqu’à l’arrivée des renforts qu’on avait promis.
Delaunay vint quelques instants après le premier coup de feu qui dura une bonne heure et tint ce propos devant la garnison : « Si les Invalides ne font pas leur devoir, je vous ordonne, Suisses, de fusiller vous-mêmes les Invalides. » Beaucoup d’entre eux le firent, car c’était eux qui gardaient les tours. Les Suisses étaient placés devant le pont-levis, dans chacune de ses tours, à la hauteur d’homme ; ils faisaient un feu de file et ils ont tué tous ceux qui se présentaient vis-à-vis le pont.
Les citoyens armés se retranchaient de toutes parts, derrière les maisons, sur les toits, d’autres derrière les cheminées.
Enfin, sur les deux heures et demie le feu cessa, et ce fut dans ce moment qu’un citoyen nommé Tournay, compagnon charron, mais ancien militaire du ci-devant Régiment-Dauphin, résolut d’abattre le premier pont-levis. Il monta sur les épaules de plusieurs de ses concitoyens et, parvenu à se saisir d’une des chaînes, il grimpa jusqu’à la bascule ; là, il essuya une décharge de plus de cent coups de fusils ; aucun ne le blessa ; on lui donna une forte pioche ; il la jeta par terre et se laissa couler ; à force de coups de pioche, il parvint à briser les verrous et serrures qui retenaient le pont-levis. Le pont s’abattit et personne ne périt dans cette action, malgré le feu continuel que la garnison faisait et qui n’a cessé qu’une demi-heure après. Le premier pont-levis gagné, le citoyen Tournay a eu huit trous de balles, tant dans son tablier que dans son chapeau, ainsi que dans sa veste.
Sur les trois heures vinrent deux compagnies de gardes-françaises du quartier de l’Hôtel-de-Ville, avec beaucoup de citoyens à leur tête ; ils entrèrent par les cours de l’arsenal, le long du quai. Ils se mirent en deux lignes et je vis avec plaisir les sergents eux-mêmes faire commencer le feu de file. Ils défilaient à mesure dessous la porte Rouge et venaient se placer dans la salle d’armes. Deux pièces de canon les suivirent ; alors tous les citoyens se mirent à les manœuvrer. Les enfants apportaient les boulets ; les femmes apportaient la poudre sur des petites voitures à bras. Toutes ces choses de première nécessité furent apportées aux militaires, comme je viens de le dire, par les femmes et les enfants.
Ce fut à ce moment que l’on aperçut sur le haut des tours un mouchoir blanc en forme de drapeau au bout d’une baïonnette et agité par un invalide.
Je fus un instant prêt à croire que le fort se rendait, mais point du tout, c’était une trahison de plus car, au moment où le peuple fut pour s’avancer vers le pont-levis, alors une décharge terrible partit du haut des tours et des créneaux où étaient les Suisses, qui balaya tout ce qui était sur l’avancée du pont. On fit jouer le canon, ce qui les effraya. Celui qui se signala et qui fut le plus aisé à reconnaître fut un nommé Élie, alors officier recruteur au régiment ci-devant « la Reine » en uniforme, son épée à la main, il encourageait tous les citoyens en affrontant avec courage le feu des ennemis.
Le peuple se présenta vis-à-vis le pont-levis avec une pièce de canon ; à cet instant, au travers d’une planche, on vit paraître un papier roulé ; alors on fit chercher une planche afin de traverser le fossé dont le pont était resté levé jusqu’alors ; cette planche n’était pas bien assujettie du côté du pont, le rebord n’était pas assez large, et le premier qui fut pour chercher le papier tomba dans le fossé et fut tué en tombant… mais un second y marcha, et il eut le papier qui était la capitulation. On la remit entre les mains du nommé Élie, qui en donna lecture au peuple et qui la mit à la pointe de son épée. Elle était bien conçue.
Il y eut quelque agitation à ce propos ; j’étais un de ceux qui ne voulaient point de capitulation parce qu’on venait de nous trahir et que beaucoup de nos frères avaient été tués : malgré le drapeau déjà amené, la décharge que nous venions d’essuyer était une trahison. On disait qu’il fallait tout passer au fil de l’épée et bien se tenir sur ses gardes… Cependant, après un quart d’heure, le pont-levis s’abaissa. Je dis à plusieurs de mes concitoyens, avant de passer, qu’il fallait mettre les verrous du pont, afin que nous ne nous trouvions pas enfermés ; ce qui fut exécuté.
Nous entrâmes en foule dans l’intérieur : j’ai remarqué les Invalides d’un côté et les Petits-Suisses de l’autre : tous avaient l’habit retourné et leurs armes à terre. Je ne vis rien de ce qui se passa dans le dedans au sujet du gouverneur, parce que je montai sur-le-champ en haut des tours.
En montant, j’entrai dans une chambre où il y avait un prisonnier ; les verrous n’étaient que fermés, il ne fallait point de clef ; je tirai le verrou et j’ouvris la porte : je vis un jeune homme d’environ trente ans, grand, bien fait, mais tout pâle. Je lui dis : Allons, mon ami, rassurez-vous, nous vous délivrons, ne craignez rien, mes camarades vont vous accompagner. Il me répondit qu’il avait une malle… Deux de mes amis s’en chargèrent et le conduisirent dehors.
Je montai en haut des tours.
J’y trouvai déjà trois citoyens : un boulanger, les bras retroussés et en bonnet de coton, que j’ai connu après. (Il s’appelait Morin.) Ce boulanger retournait les bouches à feu avec deux de ses frères, malgré le feu continuel qui venait de toutes parts. Plusieurs Petits-Suisses étaient sur le haut des tours, le havre-sac au dos ; ils se mirent à genoux et demandèrent grâce ; on en prit deux que l’on jeta du haut des tours en bas.
Le feu roulait toujours. On ne voyait pas au dehors que le peuple était le maître. Une fumée épaisse, occasionnée par une voiture de fumier à laquelle on avait mis le feu, montait jusqu’en haut des tours. Plusieurs grenadiers des gardes-françaises nous rejoignirent ; alors je dis à l’un d’eux : Mettez votre bonnet au bout de votre baïonnette et montez sur cette pièce de canon, je suis sûr que les coups de fusil cesseront. En effet le feu cessa dès cet instant, et des cris de joie se firent entendre de toutes parts.
On avait eu soin de monter en haut des tours des munitions de toute espèce et surtout beaucoup de morceaux de fer à mitraille, des tas de pavés à chaque coin des tours et au moins deux cents livres de chandelles en paquets… Plusieurs invalides avaient été tués sur la position.
Je voulus redescendre : c’était presque impossible car tout le monde entrait. Plusieurs individus furent étouffés et moi je fus tellement pressé que j’en restai malade pendant plus de quinze jours. J’eus beaucoup de peine à me traîner jusqu’à la rue de Charenton où demeurait ma sœur qui y était établie depuis quinze ans. En arrivant je me mis au lit, avec défense à mes parents de dire à personne que j’avais été à la Bastille.
Beaucoup de citoyens se sont fait gloire d’avoir tous les premiers arrêté Delaunay, mais le premier qui lui mit la main dessus fut un nommé Cholat, marchand de vins rue des Noyers, homme pur et qui a beaucoup marqué depuis dans la Révolution.
La prise de la Bastille dans cette journée est en trois actes, c’est-à-dire qu’il y a eu trois coups de feu : le premier à onze heures, le second à une heure et demie et le dernier qui finit à quatre heures. J’ai vu les deux derniers, et puis attester qu’il n’y avait pas plus de six cents hommes à chacune des deux scènes : cependant il y a eu huit cent soixante-trois vainqueurs de la Bastille de reconnus. Tout Paris voulut y avoir été, surtout quand l’Assemblée constituante accorda par décret des marques distinctives à chaque combattant.
J’ai vu l’intrigue dans les assemblées qui ont été convoquées pour reconnaître les vrais vainqueurs. Des hommes en habit de velours, d’autres avec de belles épaulettes, se présentaient pour être reçus ; d’autres personnages distribuaient de l’argent avec profusion, enfin toutes les ruses ont été employées, et malgré la sévérité que l’on mettait aux formalités, beaucoup ont été reçus qui n’étaient pas même à Paris, et j’en connais, surtout de ces hommes riches, mais je puis attester qu’il n’y avait où tombaient les coups de fusil que les pauvres sans-culottes de la classe du seul peuple.
Santerre voulut être reçu et s’y employa par tous les moyens qui étaient en son pouvoir. Il disait qu’il avait prêté ses chevaux pour amener les voitures de fumier qui y étaient. Je lui fis cette pointe : Eh bien, il faut recevoir les chevaux de Santerre puisqu’ils y ont été réellement, mais non pas sa personne, parce qu’aucun de nous ne l’a vu. Il ne fut pas reçu dans cette séance, mais le lendemain – je n’y étais pas – il fut reçu à la grande majorité, ainsi que plusieurs autres.
On a cru que tous ceux qui avaient été chanter dans les rues étaient seuls les vainqueurs de la Bastille, tels que les Hullin, Élie, Maillard, Legris, Humbert, Armé, Dubois… Eh bien, voici les faits que je tiens d’eux-mêmes : ils ont voulu m’emmener avec eux, c’était chez un auteur appelé le cousin Jacques à qui ils ont dit tout ce qui leur plaisait ; l’auteur en fit son profit et louangea leur courage en cette journée à jamais mémorable.
Élie, Humbert, Tournay et plusieurs autres méritent d’être remarqués, mais non Hullin, Maillard, qui se sont cachés, et Legris, qui n’était pas là et qui, par son intrigue, fut reconnu « vainqueur ». Dubois, que l’on promena dans les rues avec une couronne civique, était saoul ce jour-là ; mais, comme l’on conduisait l’État-Major de la Bastille à l’hôtel-de-ville, on arracha la croix de Saint-Louis que portait un de ces officiers des Invalides, pour la donner à Dubois qui était garde-française, et beaucoup de personnes crurent que c’était lui qui, le premier, avait arrêté le gouverneur. Le fait a été contrôlé et s’est trouvé faux : lui-même l’a démenti.
CHAPITRE XII
Au service de la Commune. – Motions d’ordre. – Hullin commandant provisoire. – Le renvoi des ouvriers de Montmartre. – Cinquante sous par jour. – Les intrigants. – Je proteste. – Mon altercation avec Hullin. – Ces messieurs. – Projets d’organisation.
Quelque temps après le 14 juillet, il y avait beaucoup d’ouvriers à Montmartre…
Plusieurs réels vainqueurs de la Bastille furent demander du service à la Commune de Paris, car les chargés de l’administration de police et des travaux publics avaient besoin d’une force armée pour les accompagner, afin d’acquitter le salaire des ouvriers de Montmartre et de faire cesser le travail… Les ouvriers étaient au nombre de trente mille.
La veille de cette expédition, je vis venir à moi le citoyen Tournay dont j’ai parlé précédemment, et duquel j’étais connu pour avoir été à la Bastille ; il me dit : « Je suis chargé par plusieurs camarades qui ont été au siège de la Bastille de choisir des braves pour une expédition à Montmartre ; on se rassemblera ce soir même à la Ville, où l’on nous donnera les ordres nécessaires. » Je n’avais point d’ouvrage ; je lui dis que je m’y trouverais et, en effet, j’y fus vers les sept heures du soir. La discussion était déjà entamée à ce sujet. Là, je vis les nommés Hullin, Maillard, Richard, Dupin, etc., qui parlaient avec chaleur au commissaire de la Commune. L’abbé Fauchet ne voulait point que l’on employât de la force armée, mais Lagrey en voulait.
Malgré que Hullin et Maillard insistassent pour avoir cette expédition à faire, je voyais qu’on ne voulait pas de nous. Je pris la parole : Mais, il semble que l’on force les commissaires à nous employer ! Si les commissaires nommés pour l’expédition se sentent assez de force pour se passer de nous, laissons-les délibérer paisiblement sur cet objet, n’ayons pas l’air de les influencer. Je demande que chacun de nous se retire. – Cependant, après maintes discussions, il fut arrêté que trente hommes armés accompagneraient les commissaires et que l’État-Major délivrerait à chaque individu un laisser-passer pour pouvoir sortir de Paris avec ses armes.
Entre nous autres, le rendez-vous était convenu à sept heures du matin, à l’entrée du faubourg Montmartre et nous nous y trouvâmes au nombre de trente, armés. À l’exception de deux ou trois, le reste d’entre nous avait servi dans la ligne.
Je fis la motion de nommer un commandant provisoire ; elle fut appuyée et nous nommâmes Hullin : il avait un beau physique, et je ne le connaissais pas alors. On verra par la suite que j’appris à le connaître.
Nous partîmes, tambour battant, et nous arrivâmes à Montmartre. Les commissaires de la Commune y étaient déjà arrivés et nous attendaient pour commencer les opérations. Le poste fut établi à l’Abbaye.
Un d’entre nous, appelé Dupont, qui était garçon, avait demandé une pièce de canon au district Saint-Germain-l’Auxerrois ; et ce qu’il y avait de plus drôle, c’est que cette pièce de canon n’avait pas d’affût : on l’avait amenée sur une charrette.
Le renvoi des ouvriers commença. Ils se présentèrent tous à la fois. On leur donnait à chacun cinquante sols ou vingt-quatre, je ne me souviens pas au juste, et un passeport pour se retirer dans telle commune qu’ils désireraient.
La garde fut forcée ; il fallut employer beaucoup de prudence ; les esprits s’échauffaient de part et d’autre. On fut obligé de fermer les portes et Hullin commença à haranguer la foule des ouvriers ; après lui, Maillard qui s’était déjà donné le grade de porte-drapeau, leur parla avec courage.
Cependant les commissaires les firent rentrer dans l’ordre. Ils avaient déjà fait la motion de nous désarmer, et ils étaient assez forts pour cela, puisqu’ils étaient trente mille contre trente ; mais les portes étant fermées, on ne les laissa plus entrer que par vingt à la fois.
On sait tous les vols qui se faisaient dans cette administration : j’ai connu des chefs à qui leur journée, tous frais faits, rapportait deux cents livres ; le fait me fut avoué par eux-mêmes.
La première journée fut un peu orageuse, cependant il n’y eut aucun coup de feu, pas même une voie de fait. Cette expédition dura près de quinze jours ; on nous nourrissait et l’on nous payait à raison de cinquante sols par jour. Plusieurs ouvriers du faubourg Antoine apprirent cela et se présentèrent comme étant vainqueurs de la Bastille ; ils furent admis avec nous. Nous étions plus de cent déjà sur une liste et dès cette époque on voulait faire deux compagnies. Les Hullin, Maillard, Richard, Dupin et autres s’étaient distribués les grades ; on accaparait déjà les suffrages. Je m’en aperçus, et un jour que nous allions pour souper à la dernière table (il y en avait deux alors et la première était toujours mieux servie que l’autre, parce que c’était la table où allaient tous ceux qui se croyaient les officiers, et l’on servait à la dernière table ce que les autres n’avaient pas voulu), je fis un train terrible, et je renvoyai les restes de ces messieurs. L’aubergiste fut chercher Hullin comme commandant.
Hullin entra avec un air impertinent et commençant à nous mépriser tous par ses propos d’arrogance. Je lui parlai d’un ton ferme et je lui dis qu’aucun de nous ici n’était fait pour manger ses restes. Il sortit et je fis servir un autre souper.
Au milieu du repas, les soi-disant officiers vinrent pour m’en imposer et voulurent me faire chasser de ce service. Après plusieurs propos de part et d’autre, on me présenta l’épée, je l’acceptai et l’on fut pour se battre. Je ne connaissais que le nommé Tournay ; je le priai de venir avec moi, et je leur dis : Allons nous battre tout de suite. Comme il était tard, la partie fut remise au lendemain matin. Plusieurs parlaient déjà de pistolets ; on avait monté les esprits contre moi, et je devais être tué ce jour-là. Dans la nuit, on interrogea Tournay sur mon compte ; on lui demanda qui j’étais et quelle était ma science. Tournay leur dit que j’étais brave et que je savais très bien tirer les armes. Cela leur fit apparemment peur et l’on ne se battit point. Au contraire, on lia connaissance avec moi et je fus recherché pour assister dans les conseils que ces messieurs tenaient pour l’organisation d’un corps.
La quinzaine finie et tout étant tranquille, nous reçûmes ordre de venir occuper le poste de la Bastille. Je fus chargé d’y établir les postes nécessaires et de le garder avec cinquante hommes, tandis que Hullin et consorts tâcheraient d’obtenir l’ordre de notre organisation auprès de La Fayette. Le nommé Lagrey, dont j’ai déjà parlé, était alors commissaire général des guerres et prenait intérêt à ce que nous fussions formés ; il nous passait en revue souvent et voulait nous former un bataillon.
Pendant ce temps la journée du 5 octobre arriva.
CHAPITRE XIII
Le 5 octobre. Pour avoir du pain. – Il fallut marcher. – Le Boulanger la Boulangère et le petit Mitron. – Escarmouche avec les gardes-du-corps. – Les officiers de la Bouche-du-Roi. L’arrivée de Lafayette. – Le Roi au balcon avec sa famille. – Les gardes du corps se dégradent. – Comment Lafayette fut forcé d’aller à Versailles. – Sans commentaires.
Le matin du 5 octobre 1789, beaucoup d’ouvriers vinrent attaquer notre poste. Nous allâmes fermer la grille où était notre sentinelle d’avancée et nous la plaçâmes au dedans. Le peuple augmentait à chaque minute et plusieurs avec des haches voulaient jeter la grille par terre. Ils voulaient entrer en disant que des armes étaient cachées. À la vérité, il nous était arrivé cent fusils que j’avais eu soin de faire cacher, afin d’en armer ceux qui entreraient dans le corps qui était à la veille de se former.
Je leur fis entendre raison, et j’obtins d’eux qu’ils nommeraient une députation pour venir visiter notre caserne. Huit d’entre eux furent nommés et ils ne trouvèrent rien. Cette visite faite, ils s’en furent.
Alors je fus à la Ville, voir si l’on n’avait pas quelque ordre à me donner. Je vis tout l’État-Major qui avait sans doute perdu la tête, car Lajard, à qui je m’adressai, me dit qu’il fallait que je prisse les mesures que je trouverais les plus convenables. Je ne fus pas content de cette réponse et je lui dis devant l’État-Major que ce n’étaient pas là des ordres ; ce à quoi il répliqua : « Faites pour le mieux ! » À ce moment la place était couverte de bataillons ; il pouvait être neuf heures du matin.
Je me rendis au district de l’Arsenal : je les trouvai rassemblés. Je leur tins les mêmes propos ; et que le peuple voulait aller à Versailles pour avoir du pain. Le président de cette section me répondit comme ceux de l’État-Major. En m’en allant, je leur dis : Il ne s’agit pas de délibérer et je m’étonne de ce que vous n’êtes pas sous les armes comme vos concitoyens. Je viens de la Ville, et tous les districts se rassemblent. – Ils levèrent la séance et se formèrent par bataillons.
Je revins à mon poste où je trouvai dix mille hommes au moins rassemblés et qui disaient : « Il faut qu’ils viennent à Versailles et qu’ils marchent en tête. » Hullin était alors rentré et parlait au peuple. Il avait beaucoup d’organe et se faisait très bien comprendre, mais tout ce qu’il pouvait leur dire ne les faisait point changer d’avis : il fallut marcher.
Hullin leur demanda une demi-heure pour préparer et rassembler ses camarades, ce qui lui fut accordé.
Je fus envoyé pour chercher des cartouches et des pierres à fusil. Pendant ce temps-là, beaucoup de vainqueurs de la Bastille s’étaient joints à nous et on leur distribua des armes.
La demi-heure était passée et au delà ; le peuple se présenta en foule devant notre corps de garde et il fallut aller par la grand’rue Antoine jusqu’à la Grève. Nous laissâmes cependant un poste de dix hommes à la Bastille. Nous les avions pris dans les plus vieux ; il y avait parmi eux quatre blessés.
Nous arrivâmes, avec notre vieux drapeau de la Bastille, sur la Grève, par l’arcade Saint-Jean, et aussitôt un cri unanime s’éleva : « À Versailles ! à Versailles ! » En passant et faisant le tour de la place, la troupe de ligne nous demandait : « Où allez-vous ? » et nous leur répondions : « À Versailles, chercher le Boulanger, la Boulangère et le petit Mitron, – car c’était le mot de cette journée-là.
J’observe que le nommé Maillard était déjà parti à la tête de douze mille femmes. Il était en habit noir.
Nous suivîmes notre chemin tout le long du quai, afin de conserver le devant, et nous nous aperçûmes sur le quai de la Ferraille qu’aucun district ne nous suivait. – À la vérité, nous étions tous jaloux de tenir la tête de l’armée. – Nous fîmes halte, au coin du Louvre, et l’on vint nous dire que l’armée était en marche. Aussitôt, par le flanc droit ! et nous marchâmes jusqu’à la place alors Louis-XV. Nous avions beau regarder, aucun bataillon n’avançait. Nous restâmes plus d’une heure dans cette position. Il survint ensuite une foule considérable qui nous dit que l’armée gagnait la rue Saint-Honoré.
Nous allâmes jusqu’au Point du Jour.
Arrivé là, Hullin dit au peuple qui nous avait suivi qu’il ne voulait point marcher en brigand, qu’il ne marcherait à Versailles qu’avec deux ou trois districts.
À ces paroles, les hommes nous traitèrent de lâches et, comme dans ce pays il y a beaucoup d’échalas en terre pour étendre le linge des blanchisseuses, nombreuses dans le canton, en moins d’un quart d’heure tous ces échalas en étaient arrachés. Ils étaient au moins quatre mille hommes et autant de femmes, qui vinrent sur nous. Quatre d’entre eux s’avancèrent, au nom de tous, et nous dirent fort impertinemment : « Il faut que vous nous donniez vos armes ainsi que vos munitions, ou bien que vous marchiez sur Versailles. Si vous ne voulez pas, nous allons vous pendre quatre à ces arbres au milieu du chemin. » J’avoue qu’aucun de nous n’avait envie de se laisser accrocher.
Nous nous rangeâmes en bataille et nous tenions toute la chaussée, car nous étions cent vingt-cinq hommes armés. Hullin nous dit : « Voyez ce que vous voulez faire. » Nous répondîmes, tous ensemble : « À Versailles ! à Versailles ! » Aussitôt des cris de « bravo » se firent entendre et de grands claquements de mains. Mais, chemin faisant, une grosse pluie dissipa tout le monde. Chacun entrait dans les cabarets, dans toutes les maisons, pour se mettre à l’abri du mauvais temps, et la moitié de notre troupe nous quitta pour prendre quelque nourriture, car aucun de nous n’avait vu un morceau de pain de toute la journée.
Aucune troupe n’arrivait de Paris, ce qui nous décida d’avancer jusqu’au pont de Sèvres, pour occuper ce poste qui devenait important en la circonstance.
À notre arrivée à Sèvres, nous trouvâmes le poste occupé par la garde nationale de cet endroit et de plusieurs autres communes environnantes :
Ils crièrent sur nous ; nous leur répondîmes : « Avant-garde nationale parisienne ! » Toutes les femmes qui avaient passé avant nous avaient annoncé ainsi. Nous parlâmes au commandant ; nous lui dîmes qu’il fallait qu’il vînt avec nous à Versailles ; il nous répondit qu’il attendait le corps de l’armée et il nous déclara qu’il ne marcherait que quand il aurait vu passer le général Lafayette.
Nous continuâmes notre route jusqu’à l’avenue de Paris. Nous n’étions plus que soixante-quatre hommes armés, tous militaires partagés en deux pelotons. Nous entendîmes venir des voitures ; nous enlevâmes les mouchoirs qui protégeaient nos platines et nous amorçâmes de frais. Les voitures s’arrêtèrent devant nous et les individus qui les conduisaient nous dirent qu’il n’y avait pas de danger, que les dragons et toute l’infanterie étaient pour nous, mais qu’il fallait nous méfier des gardes du corps, qu’eux seuls avaient fait feu sur le peuple et que plusieurs femmes avaient été tuées. Il était alors sept heures du soir, 5 octobre.
Un peu plus loin, nous découvrîmes une compagnie de dragons ; nous leur criâmes : Qui vive ? Ils nous répondirent : Dragons ! – Quels dragons ? – Dragons de la Nation, – Hé bien ! puisque vous êtes des dragons de la Nation, marchez devant nous.
Nous les fîmes marcher devant avec deux pièces de canon montées sur deux affûts de siège que nous avions et qui avaient été traînées par les femmes depuis Paris jusqu’au-dessus de Sèvres. Nous fûmes peu après dans l’obligation d’abandonner ces canons à la seconde rencontre que nous fîmes d’un nouveau corps de dragons, et cela pour deux raisons : la première était que nous n’avions personne pour les traîner, et l’autre parce qu’une roue venait de se rompre ; par le mauvais temps il y avait impossibilité de se servir de cette artillerie.
L’escadron de dragons était rangé en bataille sur la gauche en venant de Paris. Nous leur criâmes : Qui vive ? Ils nous répondirent : Dragons de la Nation. Je m’approchai du commandant et lui demandai quelle était l’opinion de la garnison. Il me répondit que la troupe était pour le Tiers-État, mais que les gardes du corps étaient contre et que des voies de fait avaient été exercées dans la matinée contre le peuple de Paris, et que plusieurs personnes avaient été tuées.
Nous les quittâmes et nous avançâmes sur le chemin en face de la Grille. Quand nous fûmes à la hauteur des États-Généraux, nous aperçûmes une patrouille de huit ou dix gardes du corps.
Nous étions en bataille ; nous leur criâmes deux fois : Qui vive ? Sans nous répondre, ils nous tirèrent dessus ; deux coups de fusil passèrent dans nos rangs, sans blesser personne. Alors Hullin commandant : feu de file ! Le feu de file fut exécuté au même instant. Nous en étions à notre troisième coup de fusil chacun, quand Hullin commanda le doublement. Plusieurs des nôtres quittèrent leur rang pour aller voir ce qui avait été tué et ils manquèrent bien de périr par leur imprudence, car le feu n’avait pas encore cessé ; mais déjà ils revenaient avec des banderoles et des sabres de gardes du corps ; nous avons compté sept hommes morts sur la place. Nous les laissâmes derrière nous.
Toujours en bataille, nous avons continué notre marche. Le bruit du feu de file que nous avions fait avait mis en fuite tous les gardes du corps qui étaient rangés en bataille devant la grille du château. Ils nous abandonnèrent le poste.
Nous fîmes sur la queue un autre feu de file en arrivant en place et nous leur tuâmes deux hommes et trois chevaux qui restèrent sur le carreau. Nous nous emparâmes des pièces de canon et nous y plaçâmes des sentinelles. Je fus chargé de les placer et je remplis cette mission avec plaisir : je donnai les consignes nécessaires selon la circonstance.
J’observe que les Petits-Suisses étaient rentrés dans le château et y étaient sous leurs armes.
J’avais placé vingt sentinelles et un poste de quatre hommes à l’avancée, afin de reconnaître tout ce qui arriverait par la route de Paris, et nous avions résolu de ne pas quitter ce poste avant que l’armée parisienne fût arrivée. Nous avons tenu parole.
J’observe encore que tous les postes avaient été abandonnés, même par la garde nationale de Versailles, et que la troupe de ligne, qui était le régiment de Flandres, se promenait en veste et en bonnet de police.
Une heure après, on fit mettre toutes les armes en bataille faisant face à nous. Nous étions aux casernes des gardes-françaises. Le commandant de la force armée, qui était M. de Destany, vint nous demander ce que nous étions et ce que nous voulions. Je saisis aussitôt la bride de son cheval, et Hullin lui dit que nous demandions le renvoi des gardes du corps parce qu’ils avaient fait feu sur le peuple, et que l’armée parisienne arrivait pour demander du pain. Je lâchai la bride de son cheval pour aller parler à un insolent qui était sans doute un de ses aides de camp et je dis à Hullin : Retenez-le, il doit nous répondre de la garnison. Mais au même instant il piqua des deux et s’enfuit au galop avec ses deux aides de camp. Je tirai deux coups de fusil dans sa direction, mais je ne pus l’atteindre.
Après cette conférence, les officiers de la Bouche-du-Roi vinrent avec des casseroles pleines de viandes de toutes espèces, des brocs de vin et du pain chaud qui sortait du four. Ils nous dirent que c’était de la part du Roi.
Réflexion faite, je dis à mes camarades : Ne mangez pas de cette viande qui est peut-être empoisonnée. J’en fis manger aux porteurs devant nous, avec défense de rien cracher : ils burent aussi de leur vin et je les fis garder à vue tout le temps du repas. – Ces gens étaient de bonne foi, car aucun de nous ne fut incommodé ; et deux heures après je leur dis : La méfiance est la mère de la sûreté… Quant actuellement, vous pouvez vous retirer.
Ils nous questionnaient sur les intentions de l’armée parisienne et sur notre nombre ; je leur répondis que nous étions quatre mille, en bataille dans les avenues de Paris, et prêts à marcher au premier coup de fusil ; que l’autre avant-garde était composée de cinq mille hommes en bataille, avec huit pièces de canon, sur l’autre route. Mais, à la vérité, nous étions, en comptant sentinelles et poste d’avancée, tout au plus cent vingt-cinq personnes, et encore parce qu’il s’était joint à nous plusieurs bons citoyens qui étaient arrivés dans la journée.
Sur les dix heures du soir, on nous rapporta que tous les gardes du corps étaient retirés dans l’Orangerie et qu’il fallait y aller. Je dis à Hullin : Ne donnons pas dans ce piège ; nous ne sommes point venus ici pour faire la guerre, mais pour demander du pain ; nous occupons un poste important, ne le quittons point.
Plusieurs officiers de Versailles nous dirent que tout était calme et qu’il ne fallait pas rester à l’injure du temps, que nous pouvions rentrer dans les casernes. Hullin leur répondit qu’il ne rentrerait qu’après avoir remis le poste à l’armée parisienne. J’oubliais de mentionner que le général Gouvion, chef de l’état-major de Lafayette, nous avait envoyé un de ses aides de camp, qui nous rejoignit bien au-dessus de Sèvres et nous transmit de la part du général Gouvion qu’il ne fallait point entrer dans Versailles, qu’il y aurait imprudence, surtout ne connaissant pas l’esprit de la garnison ; et j’avoue que nous courions un grand risque, car si les dragons avaient fait un quart de conversion et que les gardes du corps eussent marché sur nous, nous étions pris entre deux feux et taillés en pièces. Mais de tout cela rien n’arriva, et nous n’avons perdu, de toute cette journée, aucun de nos camarades.
L’avant-garde arriva à onze heures et demie du soir : c’était Gouvion qui la commandait ; nous lui remîmes le poste et il fut instruit de toute notre journée. La garde nationale parisienne, c’est-à-dire le corps de l’armée, arriva à une heure et demie, par conséquent dans la nuit du 5 au 6, et ils se mirent en bataille vis-à-vis la grille du château, le tout par divisions. Lafayette, à son arrivée, alla chez le roi ; une heure après tout rentra dans l’ordre et la troupe fut se loger où elle put.
Le matin 6, la garde nationale parisienne était si outrée contre les gardes du corps qu’on leur faisait la chasse comme à de véritables lièvres, et beaucoup furent sacrifiés. Lafayette prit leur défense et harangua les bataillons en leur faveur. Il monta chez le roi avec plusieurs gardes du corps qu’il avait protégés de sa personne. Les femmes n’avaient pas quitté l’escalier du château et demandaient à grands cris le renvoi des gardes du corps et « le Roi à Paris » !
Lafayette descendit, venant de chez le Roi ; il s’arrêta devant notre troupe et nous ordonna de sortir en dehors de la grille. Les femmes s’y opposèrent et répondirent à Lafayette que nous étions leur soutien, que nous les avions protégées et que nous ne sortirions pas. Les bataillons de la foule entrèrent et un cri unanime se fit entendre : on réclamait le Roi…
Le Roi vint au balcon avec sa famille. Sa femme tenait le Dauphin d’alors dans ses bras. Elle avait un chapeau et elle pleurait, sans doute à cause des gardes du corps tués sous ses yeux, car il y en avait deux qu’elle pouvait très bien remarquer et qui étaient à sa portée.
On demanda le renvoi des gardes du corps. Aussitôt beaucoup de ceux-là, qui étaient dans les anti-chambres, parurent sur le balcon et se dégradèrent, c’est-à-dire qu’ils jetèrent leurs chapeaux, banderoles, ceinturons et sabres au peuple : c’était à qui en aurait. Plusieurs gardes furent tués qui s’étaient cachés dans des maisons.
Lafayette fit tout ce qui était en son pouvoir pour que le Roi restât à Versailles, mais le peuple ne voulait rien entendre et criait : « À Paris, le Boulanger, la Boulangère et le Petit Mitron ! » Ils ont entendu eux-mêmes ce propos. Enfin, il fut décidé que le Roi viendrait à Paris au milieu de la garde nationale parisienne.
Le peuple remporta donc la victoire de cette journée malgré tout ce que purent faire Lafayette et les partisans de la royauté. Lafayette, on n’en peut douter, ne voulait pas aller à Versailles : il y fut forcé. Un grenadier lui avait tracé sur la place de Grève deux routes, à savoir, celle de la lanterne et celle de Versailles. Dans ces conditions, il préféra la dernière.
Je laisse à l’historien la démonstration de cette journée, et je ne me permettrai aucune réflexion. Je couche seulement sur le papier ce que j’ai vu.
Le Roi arriva à Paris au milieu de la garde nationale ; plusieurs gardes du corps désarmés le suivaient. Il s’en fut loger au château des Tuileries.
J’oubliais un fait : c’est que, sur les deux heures du matin, les députés des États généraux revenaient de chez le Roi et repassaient dans nos rangs ; plusieurs n’avaient plus de cocarde ; je demandai à l’abbé Maury ce qu’était devenue la sienne. « Nous ne pouvons plus les avoir, puisque nous les avons données à vos femmes de Paris, ce matin… » Voilà ses expressions.
Cette journée finie, nous rentrâmes dans notre poste à la Bastille.
CHAPITRE XIV
La révolte des paysans à Vernon. – Le général ne venait pas. – Aucune résistance. – Chicane au sujet de la solde. – Ma grande colère. – Nouvelles incorporations dans les Vainqueurs de la Bastille. – Deux pas-grand’chose.
Quelque temps après, nous reçûmes l’ordre de fournir un détachement de douze hommes pour Vernon. Je fus nommé pour le commander. Il fallait partir sur-le-champ afin de rétablir le bon ordre dans ce pays où des troubles avaient été causés par le manque de subsistances. Le peuple de cet endroit avait fait périr deux accapareurs et voulait détruire les autres.
La troupe de ligne fit ce chemin en poste, avec les voitures du bureau de Versailles qu’ils prirent au Pont-Royal. Pour notre détachement, il fut obligé d’aller à pied et nous arrivâmes aussitôt que la troupe qui avait été en voiture.
À une lieue de Vernon le général envoya l’ordre de s’arrêter, disant qu’il ne voulait pas entrer dans Vernon pendant le jour. Il avait fait halte à une lieue en deçà.
La troupe de ligne, qui était composée en majorité de gardes-françaises, se joignit à nous. Ils nous demandèrent si nous voulions les suivre ; je leur dis que notre intention était de nous battre ensemble et que si le général ne venait pas, il fallait marcher avec prudence. L’officier commandant des grenadiers me dit : « Formez un peloton et voilà dix-huit grenadiers que je vous donne pour votre avant-garde. »
Je me mis en marche et la colonne nous suivit à un quart de lieue de distance. On voulut nous effrayer ; en route plusieurs femmes nous dirent que tous les bourgeois étaient sous les armes et qu’ils étaient résolus à la résistance. Nous continuâmes notre route et nous vîmes de loin qu’il n’y avait aucun préparatif.
Le général nous rejoignit alors et jura qu’il saurait bien punir les désorganisateurs. Je lui répondis qu’il n’en existait pas parmi nous, mais que son devoir n’était pas de rester en arrière. Il me fixa et dit qu’il me reconnaîtrait. Le détachement suivait ; on nous fit former par pelotons ; nous entrâmes dans Vernon tambour battant. Les citoyens de ce pays vinrent nous reconnaître, et ce fut au milieu des bravos que nous entrâmes.
Il n’y eut pas un coup de fusil tiré dans cette expédition.
Nous nous emparâmes de tous les postes, de l’Hôtel-de-Ville et des autorités constituées ; plusieurs personnes furent arrêtées. Le lendemain, on nous fit prendre les armes et former en bataillon carré. On avait battu la caisse afin que tous les gens de l’endroit se trouvassent au rendez-vous, en armes. Le général avait à leur parler il devait les passer en revue. Ils vinrent tous, et quand ils furent enveloppés par la troupe, on les conduisit à l’Hôtel-de-Ville où on leur fit déposer les armes.
Il s’éleva une chicane entre la troupe de ligne et la garde nationale parisienne au sujet de la solde : la troupe de ligne n’avait que trente sols de paye, et nous autres trois livres ; plusieurs grenadiers vinrent nous trouver, et ils nous dirent qu’ils allaient tous déserter si on ne les payait pas comme nous ; ils faisaient remarquer qu’ils marchaient devant, les premiers au feu, et que cependant ils ne voulaient pas recevoir une paye plus forte que la nôtre, mais la même. Je trouvai leur raison fondée sur l’égalité, et je leur dis : N’allons pas tous ensemble chez le général ; nommez quatre des vôtres et nous irons le trouver. Nous y fûmes et, après bien des propos de part et d’autre, nous eûmes ce que nous demandions. Ce fut aux dépens de la ville que la troupe fut soldée. Plusieurs excursions se firent et, au bout de onze jours seulement, notre détachement reçut ordre de partir. Nous revînmes à Paris, toujours au poste de la Bastille.
Cette rentrée fut remarquable pour moi, et les propos qui se tinrent ce jour-là m’ont causé bien des disgrâces.
En arrivant avec le détachement, c’était l’heure du dîner ; tout le monde était à table, c’est-à-dire cinquante hommes soldés par la Nation à raison de cinquante sols par jour ; aucune sentinelle n’était placée ; le poste était à l’abandon. Je fus d’une colère terrible : Comment, la Nation vous paye et vous n’avez pas le cœur de faire une heure de faction… c’est indigne ! surtout pour des anciens militaires… Soyez persuadés que si vous dépendiez de moi vous feriez votre service d’une autre manière. Alors je pris mon fusil, et je fus me mettre en faction pour leur donner l’exemple, et j’y restai une heure, après avoir fait huit lieues ce jour-là. On verra par la suite que ces paroles me furent reprochées bien des fois.
Vers ce temps, on introduisit dans le corps des Vainqueurs de la Bastille des hommes de toute espèce et surtout des hommes de taille. Hullin qui n’était que provisoire, était jaloux de former un beau corps, ce qui fit qu’une rivalité s’établit entre nous et les ci-devant gardes-françaises.
Deux coquins se glissèrent dans nos rangs ; ils firent des libelles de toute espèce pour les deux partis : tantôt les gardes-françaises y étaient insultés, tantôt c’était notre tour, et nous ne pouvions savoir d’où cela venait. Il s’en suivit des disputes fortes ; plusieurs hommes furent blessés et même il y eut deux vrais vainqueurs de la Bastille qui furent assassinés, sans que nous ayons pu savoir par qui ils l’avaient été. Les deux coquins en question s’appelaient l’un l’Araignée, l’autre Étienne, tous deux connus pour des pas-grand’chose dans la Révolution. Étienne surtout avait vendu sa plume à Lafayette : je le lui ai fait avouer moi-même ; – un jour il me confessa qu’il se foutait de tout, qu’il écrirait pour celui qui le paierait le mieux – Nous chassâmes de notre sein ces deux coquins-là.
CHAPITRE XV
À l’école militaire. – La friponnerie de Hullin. Je désirais l’épaulette. – La justice de Lafayette. – Je m’entête. – Propos soldatesques. – Les scènes continuent. – J’abandonne cette clique. – Un guet-apens. – Agent de Favras ! – Ma querelle avec Tournay.
On nous fit partir de la Bastille pour l’École Militaire, afin de nous y organiser en compagnie de cent cinquante hommes. Ce fut dans cette occasion que le nommé Hullin vola d’une belle façon : il touchait la paye de la compagnie au complet et nous n’étions au plus que soixante hommes ; la chose était bien facile à prouver puisqu’il n’y avait que trente lits à la caserne. Je fus un des premiers à m’en apercevoir et à le dire, ce qui m’attira toute la compagnie contre moi.
Les fournitures arrivaient de loin en loin, et à mesure que nous avions des lits, il entrait des hommes, ce qui diminuait chaque jour la paye de Hullin.
Au bout de trois mois, j’avais tout fait pour ce corps : j’en avais chassé les mauvais sujets et j’instruisais sur les manœuvres, en tout j’avais pris partout nos intérêts, j’avais même exposé plusieurs fois ma vie pour des disputes de corps ; eh bien, à la nomination, je n’eus aucun suffrage. Nous étions onze officiers provisoires et, à la formation du corps, il n’en fallait que sept, encore devait-on réserver deux places vacantes à la volonté de Lafayette : ce fut deux gardes-françaises qu’il nous envoya. J’étais loin d’être content de tout cela. J’avoue que je désirais avoir une épaulette : j’en voyais tant qui ne les avaient pas gagnées.
Devant l’injustice qui m’était faite, je fus trouver Lafayette et je lui dis qu’il était bien étonnant que celui qui avait trempé la soupe et fait le bien d’un corps s’en vît chasser. Il me répondit que je n’avais qu’à me trouver à la caserne, qu’il allait y recevoir les officiers, et qu’avant il me rendrait la justice qui m’était due – mais il n’y vint pas. Ce fut M. de Bailly, alors maire de Paris, qui arriva et ce fut à lui que j’adressai ma réclamation. Il la trouva si juste qu’il ne voulut pas recevoir le corps des officiers sans en avoir parlé à la Commune et au général. J’eus la seule satisfaction d’empêcher ainsi leur nomination trois fois.
Les officiers et les sous-officiers de ce corps étaient comme des lions contre moi ; ce qui faisait que je n’allais plus souvent à I’École Militaire. Un jour que j’y étais, les officiers me tombèrent dessus et Hullin voulait me mettre en état d’arrestation jusqu’après leur nomination ; il assembla toute la compagnie et leur dit mille horreurs de moi : ce fut dans ce moment que je crus voir mon dernier jour ; je me mis tellement en colère que je le traitai de grand gueux, grand coquin, et je lui disais : Comment feras-tu pour inspirer de l’âme aux soldats, toi qui n’en as pas ? – et mille autres propos soldatesques bien plus durs. Jamais je ne pus parvenir à le faire battre. Ses soldats en furent tellement indignés qu’ils le quittèrent, et l’un d’eux lui dit : « Arrangez-vous ensemble, vous êtes deux officiers provisoires. »
Ces candidats, voyant qu’ils ne pouvaient arriver à leur nomination, employèrent une scélératesse :
J’avais une chambre à la caserne et la clef dans ma poche ; comme je n’y couchais plus depuis toutes ces aventures, ils enfoncèrent la porte en présence, soi-disant, de quatre personnes et, comme j’avais dans une armoire plusieurs habillements, ils glissèrent dans une de mes poches de veste un écrit qui était le tableau de la compagnie où chacun était peint selon ses qualités et sans embarras. C’était bien la vérité ; j’avais même eu l’idée, plusieurs fois, d’écrire quelque chose comme ça, mais il est non moins vrai que je ne l’avais pas fait. Ils me l’imputèrent, de manière que tous ceux qui s’y reconnaissaient vinrent me demander raison de cet écrit. On avait eu la perfidie de ne faire figurer dans cette charge que les plus turbulents et les plus forts escrimeurs. Ils formèrent une députation qui vint me trouver au faubourg Saint-Antoine en demandant à me parler.
Je ne pouvais m’imaginer pourquoi ils venaient. Enfin ils me dirent qu’ils venaient me demander raison des horreurs que j’avais écrites contre eux, et ils me racontèrent l’histoire du papier qui avait été trouvé dans ma poche. Je leur soutins qu’il n’était pas de moi et que c’était une perfidie de plus de la part des officiers qui, ne voulant pas se battre eux-mêmes parce qu’ils n’en avaient pas le cœur, les excitaient, eux, contre moi.
Ils étaient venus sept dans le dessein de me faire battre ; je leur dis : Écoutez, je ne refuse pas le combat avec vous, mais j’exige avant tout que vous soyez porteurs de « cet écrit » ; alors j’écrirai moi-même devant vous ; si c’est la même écriture, je ne pourrai la renier, et vous serez convaincus que c’est bien moi le coupable. Remettons la partie à demain ; demandez ce soir l’écrit ; mais je parie un louis avec vous que vous ne l’apporterez pas. Ce que j’avais prévu se réalisa, car deux d’entre eux vinrent me voir le lendemain et me dirent que l’on n’avait pas voulu leur remettre l’écrit ; et tout en resta là.
Trois jours après je rencontrai un caporal de l’École Militaire, qui était aussi très bien peint dans cet écrit ; il me fit une scène sur le quai Pelletier et voulut à toute force me faire battre ; – c’était un protégé de Gouvion ; – cependant, après quelques explications, il fut convaincu que je n’étais pas l’auteur du papier.
Leur idée était de me faire tuer.
Ils m’ont envoyé mes effets, qui étaient à la caserne, avec mon décompte, en me retenant deux gardes de simples volontaires, qu’ils avaient fait monter pour moi.
J’abandonnai cette clique infernale d’officiers.
J’entrai aussitôt dans le bataillon de ma section[5] et j’arrivai assez à propos pour y obtenir le grade de sergent que j’ai tenu jusqu’au Dix-Août.
J’avais rassemblé des preuves de toutes les friponneries de Hullin ; je voulais le dénoncer à Lafayette ; mais Hullin lui était vendu, puisqu’il mangeait tous les jours chez ce général : toutes mes plaintes de ce côté furent donc inutiles. Je pris le parti d’aller trouver Gouvion qui, disait-on, aimait le soldat. Je lui présentai un mémoire où toutes les coquineries de Hullin étaient bien gravées en lettres ineffaçables. – Je finissais mon mémoire en demandant à passer en conseil de guerre comme militaire. – Gouvion, qui protégeait Hullin, ne me reçut pas mieux que Lafayette et je ne pus obtenir justice. Il me remit mon mémoire et j’eus la satisfaction de lui dire que, puisqu’il n’y avait aucune porte ouverte pour moi et que ce coquin était soutenu, je me ferais justice moi-même, mais non pas en assassin. Il me dit : « Eh bien, comment ferez-vous ? » –J’arracherai les épaulettes de Hullin, je les envelopperai dans du papier et je les enverrai à son protecteur Lafayette avec ces mots signés de moi : Voilà l’ouvrage de Rossignol. – Il se mit à rire et je m’en fus.
Je pris le parti de porter mes griefs contre Hullin devant la Commune et je le fis. J’obtins un arrêté du Conseil général portant qu’il serait nommé six commissaires à l’effet de vérifier les comptes que je dénonçais et d’en soumettre le rapport au Conseil général pour statuer ce qui appartiendrait. Les commissaires furent nommés ; je ne me souviens du nom que de deux : l’un s’appelait Boquillon et l’autre Cousin ; le premier était ci-devant avocat et l’autre attaché à l’administration des subsistances de la Commune et professeur de la Sorbonne. Je déposai entre leurs mains mes pièces de conviction contre Hullin. On fit venir tous les « vainqueurs » et on leur demanda quelles réclamations ils avaient à faire valoir.
Plusieurs témoins, qui avaient été payés depuis la dénonciation, ne pouvaient réclamer, mais, comme j’étais présent à l’interrogatoire, je leur demandai à quelle époque ils avaient été soldés : il fallait bien dire la vérité… alors la parole me fut interdite ; on ne voulait pas que je prouve à Hullin qu’il était un coquin. Plusieurs commissaires m’avaient dit, malgré toutes les preuves établissant sans aucun doute abus dans les comptes, qu’ils voyaient bien ce qui en était, mais que je ne gagnerais pas. Hullin fit tant qu’il mit de son côté les deux orateurs, qui étaient Cousin et Boquillon. Ils firent à la Commune leur rapport à son avantage. Cependant il fut statué que tous les blessés au siège de la Bastille toucheraient leur paye depuis le moment où la compagnie avait été formée et seraient exemptés du service militaire. Je ne pus obtenir que cela, mais ce fut beaucoup pour ces braves gens.
Je demandai la parole au Conseil pour prouver combien le rapport était astucieux et je commençai à démontrer au Conseil la perfidie de Boquillon et Cousin. Je fus hué et ne pus continuer ; enfin je fus obligé de me retirer. Tous les officiers m’attendaient aux abords de la salle : les uns disaient qu’il fallait me couper en morceaux, d’autres qu’il fallait me pendre.
Le nommé Chapuis, alors sergent-major, s’offrait pour être l’exécuteur à défaut de bourreau. – Ce Chapuis est un de ceux à qui j’ai donné du pain dans la Révolution et, par la suite, dans le temps de mon généralat, je le fis adjudant-général… Il en sera parlé plusieurs fois. – J’avais heureusement avec moi une douzaine d’amis. Je vis l’instant où cela allait faire une boucherie. La réserve monta et le commandant me plaça sous sa protection : je ne fus sauvé de leurs mains que par la force armée qui vint à propos à mon secours. Je ne connaissais pas cet officier commandant, mais c’était un brave homme puisqu’il empêcha le meurtre.
Quelque temps après, mes ennemis portèrent contre moi au Comité des recherches de la Ville une dénonciation me visant comme agent payé par Favras pour faire la contre-révolution. Cette dénonciation spécifiait que, dans le temps où l’on faisait le procès de Favras au Châtelet, j’avais voulu emmener avec moi la troupe de l’École Militaire pour faire pendre Favras par le peuple, afin de voler tous les effets du greffe et de les partager avec la troupe. – Je n’ai jamais connu Favras, et l’on voit que leur dénonciation était bien incohérente, car si j’avais été son agent, comme ils disaient, j’aurais fait tout mon possible pour le sauver et non pour le faire pendre. Cette méchanceté était signée par sept officiers. Le Comité siégeait quand ils portèrent leur pli à la Ville. Plusieurs personnes me connaissaient et leur dirent :
« Portez cette dénonciation-là ailleurs, car nous avons la liste de tous ceux que Favras a pu employer et, certes, on n’y voit pas le nom de Rossignol. » Ils la portèrent au Comité des recherches de l’Assemblée Constituante, qui leur fit la même réponse. J’appris par un de mes amis qu’ils cherchaient à me perdre par tous les moyens. Quant à Favras, je ne l’ai vu qu’une seule fois : le jour qu’il fut mené au supplice. Il était dans la charrette avec son confesseur ; je dis à plusieurs de mes amis sur la Grève : D’où vient qu’on n’a pas planté deux potences pour pendre ces deux coquins-là ? – J’avais reconnu Bossu, curé de Saint-Paul, qui l’exhortait à la mort, et je connaissais celui-là pour un aristocrate prononcé.
J’étais si aigri contre ces sortes d’officiers-là que j’avais résolu de les battre tous les sept. Un jour que j’étais avec plusieurs de mes amis chez le citoyen Cholat, le nommé Tournay y vint costumé en officier de l’ancien régime ; je lui dis : Tes camarades ont été me dénoncer à tous les Comités ; n’ayant rien obtenu, ils ont porté plainte contre moi au général Lafayette et au major Gouvion ; dis-leur que je sais mépriser leurs perfidies. – Il me tint quelques propos équivoques auxquels je répondis nettement ; il prit à témoin ceux qui étaient avec nous et, le lendemain, après avoir consulté les officiers du corps, ils furent quatre ensemble porter plainte chez un commissaire. On fit assigner les témoins ; ils répondirent qu’ils n’avaient rien à dire, ni pour ni contre, qu’à leurs yeux il s’agissait d’une dispute militaire et que, en conséquence, ils n’avaient rien à déposer, et surtout devant un tribunal tel que le Châtelet. L’affaire n’eut pas de suite. J’en connus les détails par ceux qui avaient été assignés contre moi.
Quatre ou cinq jours après, j’étais chez un de mes amis ; le même officier nommé Tournay vint à passer. Plusieurs de ses amis qui étaient les miens l’invitèrent à venir prendre un verre de vin avec eux ; on m’appela aussi. J’entre chez le marchand de vin ; on m’offre un coup à boire ; je le refuse en disant : Je ne bois pas en toute sorte de société.
Ce propos choqua d’abord l’officier et ce n’était pas sans raison, puisque j’avais parlé pour lui. Nous nous prîmes de querelle de part et d’autre, de manière que je lui donnai un soufflet et un coup de pied au cul, et j’ajoutai : Puisqu’il vous faut des coups pour vous faire tirer l’épée, à présent vous ne pouvez, comme officier, souffrir cette insulte sans en tirer vengeance.
Il voulut tirer l’épée sur moi ; j’avais en main une petite canne à dague avec laquelle j’allais me défendre, quand on nous sépara. Je m’en fus chez ma sœur où je présumais qu’il viendrait me chercher le soir même, ou du moins le lendemain matin ; pour lui il s’en fut à l’École Militaire et rendit compte aux officiers de l’insulte qu’il venait d’essuyer. Dans la Compagnie il y avait sept officiers et Tournay était le premier lieutenant, de manière que les autres officiers le poussèrent à se battre ; ils décidèrent le combat : deux d’entre eux viendraient me chercher, pendant que Tournay irait au Bois de Boulogne avec ses autres camarades.
Le capitaine Hullin était spectateur, de même qu’un nommé Chéfontaine, capitaine des chasseurs soldé caserne de la rue de Babylone : ce fut ce dernier qui vînt chez moi avec un autre. Ne m’ayant pas trouvé, ils laissèrent une lettre qui était le cartel pour quatre heures, et le troisième jour après l’insulte. Ce billet était conçu en ces termes :
Monsieur, après l’insulte que vous m’avez faite, vous voudrez bien vous trouver avec une paire de pistolets et deux témoins au Bois de Boulogne, entre quatre et cinq : je vous y attends.
Signé : TOURNAY.
(Un cahier manque à la suite [6])
TROISIÈME PARTIE
DÉPART DE PARIS DU CITOYEN ROSSIGNOL POUR LA VENDÉE, SOUS LE MINISTRE DE BEURNONVILLE, EN QUALITÉ DE CAPITAINE DE GENDARMERIE DE LA TRENTE-CINQUIÈME DIVISION ET VAINQUEUR DE LA BASTILLE. (Indication du manuscrit.)
CHAPITRE XVI
Détails sur la 35e division de gendarmerie. – Aux Ponts-de-Cé. – Je commande ma division. – Le combat de la Jumellière. – Au secours de Berruyer. – Nous donnons encore une fois. – Le père avec les Brigands et le fils avec nous. – L’affaire de Chemillé. – Position périlleuse – Le retraite. – Mes observations sont mal reçues – Les subsistances. – Femmes fanatisées. – En cantonnement à Angers.
Alors la division[7] était composée de huit cents hommes : deux compagnies de gardes-françaises y avaient été amalgamées avant notre départ de Paris [8] Un schisme en résulta, parce que ces deux compagnies étaient disciplinées et ne comptaient que des hommes riches en taille, tous anciens serviteurs. Le moindre avait huit ans de service dans la ligne. Ils ne pouvaient pas croire que des bossus et des bancals, car il y en avait plusieurs dans nos rangs, fussent capables de soutenir et la fatigue et le feu avec un courage pareil au leur. Cependant ceux-là l’ont prouvé en donnant l’exemple en plus de vingt occasions. Les gardes-françaises eux-mêmes, qui les ont vus, et les représentants du peuple peuvent attester l’intrépidité de ces pauvres bougres. C’était un honneur pour moi de les commander et je puis attester qu’ils ont remporté l’estime de l’armée. C’était à qui les aurait quand on les eût vus à l’œuvre ; mais j’avoue que certains généraux ne s’en souciaient pas beaucoup. Rien ne les arrêtait ; le danger n’était pour rien quand j’étais à leur tête ; je ne leur connaissais que deux défauts : de bien boire et de bien se battre. Les six autres compagnies de la division, en dehors des deux qu’on nous adjoignit, avaient été formées après le Dix-Août ; elles n’étaient composées que d’ouvriers qui avaient fait la Révolution, gens de tout âge et de toute grandeur. Un dépôt fut laissé à Paris, où l’on versa les hommes incapables de faire campagne et qui avaient été blessés, tant au siège de la Bastille que dans plusieurs engagements, et notamment dans la journée du 10 août.
L’Assemblée Constituante nous avait décerné [9] un brevet, une couronne murale, un habillement complet et un armement ; plusieurs décrets rendus en notre faveur reconnaissaient en nous les premiers défenseurs de la patrie, vainqueurs de la Bastille, etc… Voyez les décrets.
Nous arrivâmes aux Ponts-de-Cé, près d’Angers. Il n’y avait point de chef. – L’ordre que nous reçûmes du ministre Beurnonville était précis : il fallait dans les vingt-quatre heures être en route ; et nous ne pûmes nous organiser à Paris. – Aux Ponts-de-Cé, le général Berruyer[10], qui avait la direction de la colonne, nous autorisa à nommer un commandant en pied et un autre en second : j’eus les suffrages de mes concitoyens pour le premier grade, et le nommé Noël, capitaine d’une des deux compagnies de gardes-françaises, fut reconnu lieutenant-colonel. – C’était un homme très instruit dans l’art militaire, et qui malheureusement fut tué à mes côtés à la première action que nous eûmes avec les Brigands, au moment où je lui donnais l’ordre de se porter sur la gauche pour tourner le pays. – Élu chef de notre division, je fus reçu à la tête de la troupe par le général divisionnaire Duhoux [11].
Le lendemain de cette formalité, l’ordre nous vint de marcher sur deux colonnes, moitié de ma division avec le général Berruyer et l’autre moitié avec le général Duhoux, pour attaquer le pays appelé Saint-Pierre-de-Chemillé. (C’est à Chemillé que Noël fut tué. » Berruyer marcha en droite ligne. Duhoux marcha sur la Jumelière : j’étais de sa colonne et je marchais à côté de lui.
Il m’envoya reconnaître les positions, ce que je fis, accompagné d’un détachement de cavalerie et de deux compagnies de ma gendarmerie. Je pris une position avantageuse et je vins lui rendre compte de mon travail. Il le vérifia lui-même, fit avancer l’artillerie et la plaça sur les hauteurs. Il me donna l’ordre de placer l’infanterie en bataille ; je la fis déployer. Alors commença l’attaque. J’avais établi une réserve de huit cents hommes sur un point dominant pour protéger la retraite, si nous étions forcés, ou pour se porter, au besoin, soit à l’aile droite, soit à l’aile gauche. Après une trentaine de coups de canon, nos tirailleurs, qui n’étaient composés que de la gendarmerie à pied, débusquèrent les avant-postes, et les positions de l’ennemi furent enlevées par ma gendarmerie. Duhoux fit sonner la charge et chassa l’ennemi [12] : nous leur tuâmes près de cent hommes ; nous n’eûmes que deux des nôtres tués et un de mes gendarmes qui eut le nez coupé d’un coup de feu. Le brave homme se fit panser et continua à se battre. Je lui disais : « Montez dans ce chariot et faites-vous conduire à l’hôpital. » Il ne voulut pas se retirer, et, tout défiguré, il répétait : « Cela ne sera rien, je peux marcher, je veux vous suivre. »
Nous entendîmes le canon ronfler avec force sur notre gauche : c’était l’attaque de Saint-Pierre-de-Chemillé par Berruyer. Duhoux me dit : « Fais battre la générale et allons rejoindre la colonne de Berruyer ; – il n’y a que deux lieues. » J’approuvai cette mesure, vu que les Brigands s’étaient rabattus sur Saint-Pierre. Nous ne restâmes qu’une heure dans la Jumellière pour faire rafraîchir les troupes et nous arrivâmes, vers les cinq heures du soir, à Saint-Pierre-de-Chemillé.
Nous y trouvâmes la colonne de Berruyer qui se reployait sans ordre. Les deux généraux se consultèrent. Duhoux me demanda si ma gendarmerie voulait donner encore une fois. Je lui répondis qu’elle ne demandait pas mieux. Aussitôt il me dit de faire déployer ma gendarmerie. Je fis avancer mes deux pièces d’artillerie en face des batteries ennemies, et j’ordonnai de leur tirer dessus à toute volée, ce que les canonniers firent avec tant d’adresse qu’ils démontèrent la batterie adverse. Ce fut dans cette action que le général Duhoux reçut un coup de feu à la jambe, dont il ne fut guéri qu’au bout d’un an.
Je pris deux compagnies avec moi et je me portai sur l’aile gauche, pour tourner le village où l’ennemi occupait une position très avantageuse. Ayant tourné l’église de Saint-Pierre, nous débusquâmes sur l’angle du mur d’une manufacture de mouchoirs appartenant à un richard du pays dont j’ai oublié le nom. Je me souviens seulement que son fils faisait la guerre avec nous contre lui, et je puis affirmer qu’il s’est conduit très patriotiquement. Ce jeune homme me disait que si les Brigands l’attrapaient ils le couperaient par morceaux. Par des renseignements recueillis dans le pays et de la bouche de ses parents propres, j’ai su que le père de ce soldat avait débauché plus de quatre cents hommes, tous ouvriers qu’il occupait, et qu’il les avait entraînés du côté des Brigands – mais son fils marchait avec nous.
Je reviens à l’attaque : comme nous dépassions le coin du mur, je vis les Brigands rangés par pelotons pour soutenir trois pièces de canon qui crachaient un feu continuel sur trente hommes que j’avais fait passer du côté du grand chemin, en leur recommandant de se mettre à l’abri derrière de très gros chênes et en file, afin de protéger mon attaque. Je savais que ma gendarmerie ne devait pas tarder à venir par ma droite et, en effet, je vis bientôt arriver vis-à-vis de moi deux cents hommes qui ouvrirent un feu terrible sur les Brigands ; ceux-ci allaient donc être pris par tous les coins. À ce moment, je me retourne et je vois derrière moi un bataillon indécis. Allons, mes amis, leur dis-je, secondez-moi et, dans trois minutes, nous allons les prendre tous avec leurs canons. Les soldats qui marchaient en tête de ce bataillon crièrent : « Allons-y ! commande-nous, car nos officiers nous ont quittés… nous vous suivons ! » Je fis avancer le premier peloton qui fit un assez beau feu de file, mais le reste du bataillon prit la fuite sur la riposte de l’ennemi : ce bataillon n’avait pas encore vu le feu. Je restai en tête du peloton et, un pistolet à la main, j’avançai jusque sur celui qui chargeait la pièce de canon qu’ils appelaient leur Marie-Jeanne et le tuai. Je me retourne et me vois abandonné : je fus obligé de battre en retraite. Ils m’avaient tué douze hommes derrière moi et parmi ceux-là un brave officier de ma gendarmerie qui m’avait suivi et qui comptait vingt et un ans de service, un très brave homme : il s’appelait Niquet. Les autres avaient pris la fuite.
L’ennemi se trouvant enfoncé à droite et acculé au centre, voyant qu’il n’avait pas d’autre retraite me poursuivit ; sa colonne fut maîtresse du terrain et fit beaucoup de prisonniers ; trois pièces de canon furent prises et enclouées ; pour moi, forcé de me reployer, faisant tous mes efforts pour rallier la troupe, il ne m’a pas été possible de rassembler un peloton de dix hommes. On fit battre la retraite. La nuit était venue.
J’observe qu’avant la seconde attaque le général Berruyer ordonna de mettre le feu au village et qu’il y eut au moins quinze maisons en flammes. Nous nous déployâmes sur les grandes et petites tailles.
La bravoure qu’avaient montrée les hommes petits et marqués au B. les réconcilia avec les gardes-françaises ; ils vécurent depuis en bonne intelligence et j’en ai eu de toutes parts des louanges.[13]
Autre observation : dans le même temps, Leîgonnyer, général, attaquait Cholet ; il fut battu à plate couture et ses canons pris par l’ennemi. Pendant la route de notre retraite je dis au général Berruyer que l’on entendait le canon ronfler sur la gauche : Il me semble, général, que nous devrions marcher de ce côté-là, afin de pouvoir porter secours à cette colonne. – Je n’ai pas d’ordre à recevoir de vous. Voilà la réponse qu’il me fit, et je ne dis plus rien. Trois jours après, l’ennemi ayant porté toutes ses forces sur Cholet et Mortagne, Berruyer nous fit marcher sur Saint-Pierre-de-Chemillé et nous y fit cantonner : nous y restâmes pendant huit jours.
Il y avait beaucoup de blé, les greniers en regorgeaient. Je parcourus toutes les maisons de l’endroit avec le citoyen dont j’ai parlé qui avait son père du côté des Brigands : j’étais logé chez lui et je puis dire que j’y fus bien reçu, ainsi que huit des officiers du corps que je commandais. Le citoyen Tallot, alors adjudant-général et depuis représentant du peuple, était avec nous.
Je fis rendre à mon citoyen plus de cent mille livres d’effets volés tant dans la maison de son père que dans sa manufacture. Cet homme m’a offert de l’or que j’ai refusé ; il me voulut faire cadeau de quelques pièces de beaux mouchoirs : j’ai tout refusé. La veille de notre départ, il mit dans mon porte-manteau une douzaine de superbes mouchoirs ; je m’en aperçus, je les ôtai moi-même et les lui rendis, en disant que je n’avais fait que mon métier en lui faisant restituer ce qui lui appartenait.
Je dis au général Berruyer que, si nous étions pour quitter le pays, il fallait avoir soin de n’y laisser aucunes subsistances, et qu’il fallait les faire refluer sur les derrières. Je fis part de la même observation au général Menou qui, lui, la trouva fort juste – mais rien ne fut exécuté.
Nous partîmes le lendemain, laissant dans le pays pour plus de six mois de subsistances, tant en blé qu’en avoine, etc. J’avoue la peine que cela me faisait : Comment ! disais-je, on veut détruire les Brigands et on leur donne les moyens de subsister !… Enfin, cela m’outrait au point que je le dis au représentant du peuple qui était avec nous.
Quelque temps après nous marchâmes sur Jallais où il y avait un superbe château. L’ennemi l’ayant abandonné sitôt qu’il apprit notre marche, nous y passâmes la nuit. Berruyer fut logé dans le château même avec tout son état-major [14]. Le respect aux propriétés fut observé. Je remarquai que dans cet endroit il ne restait plus qu’un seul homme, encore était-il malade.
Berruyer avait fait enfermer toute l’artillerie dans un parc qui pouvait être attaqué avec succès par plusieurs points différents qui dominaient. Aucune garde d’avant-poste n’avait été ordonnée. Le général connaissait sans doute la marche des Brigands… Tout ce que je puis assurer, c’est qu’avec deux mille hommes j’aurais voulu prendre toute la colonne.
Ce fut dans cet endroit que cinquante femmes environ vinrent dans la maison que j’occupais et que nous avions trouvée vide en arrivant : il n’y avait personne dans le pays que ces femmes ; elles vinrent avec chacune deux enfants sur les bras et nous dirent : « Messieurs les Bleus, on nous a dit que vous veniez pour manger nos enfants, nous vous les apportons, mangez-les. » Je leur demandai où étaient les hommes du pays. Elles me répondirent qu’ils étaient avec leurs bons pasteurs et qu’ils se battaient pour Notre-Seigneur Jésus-Christ. – Mais vos maris se feront tuer… – Ils ressusciteront au bout de trois jours. – Vous voyez bien que l’on vous trompe, car, une fois mort, on ne ressuscite pas. – Eh bien ! si nos maris ne reviennent pas, ils iront dans le ciel… Monsieur le curé, qui est avec eux, leur a donné l’absolution, et à nous aussi.
On voit par ce détail combien ce peuple était fanatisé.
On nous fit rentrer le lendemain à Angers et nous restâmes en cantonnement.
À une lieue des Ponts-de-Cé, le curé chez qui je fus logé avait contenu toute sa paroisse, et il n’y eut de cette paroisse que trois hommes avec les Brigands.
L’ennemi de son côté faisait des levées dans ce pays et ramassait tous les gens des campagnes. J’eus ordre de faire plusieurs sorties dessus ; je le fis et quelquefois je leur prenais dix, quinze, trente hommes, que je conduisais ou faisais conduire aux Ponts-de-Cé, au quartier général. Plusieurs de ces rusés paysans avaient des petites cordes, dans leurs poches et, quand ils se voyaient pris, ils s’attachaient entre eux, par le bras, comme un convoi de prisonniers, et nous disaient que les Brigands les faisaient marcher de force : j’en ai reconnu qui ont été pris trois fois.
CHAPITRE XVII
À Saint-Lambert. – Les paysans déménageaient. – Une alerte. – Berruyer avait l’oreille dure. – Nos camarades en détresse. – Quand j’étais à Montreuil. – Pour être attaqué. – Nous entrons à Thouars. – L’occasion seule me commandait. – J’étais content du général Salomon. – Le baiser de Quétineau. – Là reposaient les braves Marseillais.
Nous reçûmes l’ordre de partir pour Saint-Lambert[15]. Ma division était toujours d’avant-garde et toujours au bivouac.
Le général Berruyer avait envoyé à Chalonnes, distancé de deux lieues de Saint-Lambert, un bataillon de huit cents hommes, le troisième jour que nous y fûmes. Le matin nous vîmes nombre de femmes qui se sauvaient avec leurs enfants sur les bras ; les hommes avec des voitures conduisaient les meubles qu’ils avaient pu sauver, car de ce côté il n’y avait que quelques communes patriotes, et, comme je commandais, je leur fis donner des voitures jusqu’à Angers pour eux et leurs enfants.
Dans l’après-dîner, mes avant-postes furent attaqués, une de mes vedettes fut tuée. Je fis battre la générale, je fis monter à cheval les soixante hommes de cavalerie qui étaient sous mon commandement et nous partîmes à la découverte. Le quartier général était à une lieue et demie de distance. Par précaution, j’avais donné l’ordre, en mon absence, de tenir les mèches allumées et la troupe en bataille, ordre de doubler les avant-postes, ordre à deux compagnies de couvrir par deux patrouilles toutes mes sentinelles.
Je rencontrai un peloton de leurs tirailleurs : je les chargeai et les mis en déroute. Ils étaient une centaine dont plusieurs furent tués ; les autres se retirèrent dans les genêts ; nous ne pûmes point les rejoindre, et après avoir battit une lieue de pays, je revins.
Sur les neuf heures du soir on vint m’avertir que le canon ronflait ; j’en informai le général par une ordonnance ; il me fit répondre que cela n’était pas vrai.
Sur les dix heures, il vint à Saint-Lambert deux ou trois officiers municipaux qui me dirent : « Les Brigands attaquent Chalonnes… nous avons été obligés de nous sauver par les jardins. » L’un d’eux était nu-pieds.
Je les fis conduire à cheval chez le général : le général les fit arrêter.
Au bout d’une demi-heure, un autre individu arrivait à mon avant-poste et, conduit devant moi, me disait que si je ne voulais pas être attaqué, il fallait couper un pont distance d’une lieue, que si le pont n’était pas coupé, je serais attaqué vers une heure du matin. Il faisait un temps superbe. Ma gendarmerie commençait à murmurer et me disait qu’elle ne voulait pas se laisser égorger dans un fond : telle était la position.
J’envoyai sur-le-champ une ordonnance au général, avec mes réflexions par écrit, et la permission que je lui demandais de marcher sur Chalonnes ou bien d’aller jusqu’au pont.
Il me fit réponse par l’ordonnance, mais verbalement, que j’avais peur et qu’il allait venir lui-même.
Sur les minuit, il vint en effet à Saint-Lambert, me fit monter à cheval et me dit de le suivre : je le suivis et le conduisis à mes avant-postes qui lui dirent : « Général, depuis deux heures un feu continuel se fait entendre sur notre droite. » En même temps deux coups de canon se firent entendre.
– Voici deux coups de canon, lui dis-je.
– Ce sont des portes que l’on ferme, me répondit-il.
Cela me mit en colère : – Il y a quelque différence entre la fermeture d’une porte et un coup de canon ; écoutez, prêtez l’oreille, et vous en reconnaîtrez vous-même la différence…
Il se courba dessus l’oreille de son cheval et bientôt il fut convaincu que ce n’était pas un bruit de porte. Je lui demandai si les troupes qu’il avait placées à Chalonnes avaient du canon ; il me dit que non.
– En conséquence, c’est l’ennemi qui attaque. Si vous le voulez, il fait beau temps, je vais marcher dessus, au moins je pourrai protéger la retraite.
– C’est inutile, il y a là-bas un bon bataillon de huit cents hommes. Il me dit encore : « Dans une heure d’ici vous ferez allumer de grands feux et vous ferez battre la générale ; vous vous reploierez sur les hauteurs de Beaulieu… » Je fus obligé d’exécuter l’ordre.
Arrivé à cette hauteur je pris position, et vers une heure et demie du matin, je vis revenir des soldats harassés de fatigue ; je les questionnai et j’appris d’eux que les trois quarts de leurs bataillons avaient été hachés par les Brigands, et que depuis neuf heures du soir ils se battaient. N’ayant plus de munitions, ils avaient été obligés d’abandonner la position. Ils disaient que si des secours leur étaient survenus, ils auraient battu l’ennemi. J’avais avec moi quelques bouteilles de vin et chaque brave camarade qui passait, je le faisais rafraîchir – et ce fut cette nuit-là que j’écrivis aux Jacobins pour dénoncer Berruyer.
Nous nous reployâmes sur les Ponts-de-Cé, vers les quatre heures du matin. Nous y restâmes pendant plus de huit jours. De là nous reçûmes l’ordre de partir pour Saumur où nous restâmes pendant quinze jours. On m’envoya ensuite un ordre pour prendre position sur Montreuil : ce que j’exécutai[16].
Les Brigands ne sont jamais venus m’attaquer dans cette position, mais, pendant les trois semaines que j’y restai avec quelque cavalerie qui ne se montait qu’à soixante hommes, ils étaient à Thouars, distancés de quatre lieues de moi. Une autre colonne de Brigands attaqua les Buttes d’Érigné qui font face aux Ponts-de-Cé.
Du temps que j’étais à Montreuil, j’allais tous les deux jours les visiter avec ma cavalerie. Les officiers de ma gendarmerie qui étaient montés me servaient d’avant-garde et, toutes les fois, nous nous en revenions avec quelques chevaux des Brigands dont les hommes avaient été tués. J’avais toujours soin de n’attaquer que leurs patrouilles qui allaient piller dans les campagnes.
Un jour entre autres j’avais rassemblé le plus d’hommes qu’il m’avait été possible, et ayant appris que l’adversaire avait abandonné la ville de Thouars, je voulais avec cent hommes l’attirer à une attaque sur Montreuil, parce que j’y avais une superbe position ; avec deux mille fantassins de bonnes troupes bien retranchés, je ne les craignais pas.
J’étais donc parti le matin avec ma cavalerie : c’était un dimanche, et pour reconnaître l’ennemi j’envoyai des patrouilles en avant, de tous les côtés, afin d’éviter les surprises. Mes patrouilles vinrent me dire que les Brigands n’étaient plus dans la ville. J’y entrai donc, non sans avoir répandu le bruit que le général arrivait avec six mille hommes. Tout le monde était à la messe : je fus vis-à-vis l’église me mettre en bataille. Je mis pied à terre et j’entrai dans l’église. Un homme habillé tout en noir vint poliment à moi et me dit qu’il était le maire. Je lui demandai où étaient les hommes du pays. Il me répondit que plusieurs étaient à la messe, d’autres chez eux et que beaucoup étaient partis avec les Brigands. Je lui demandai où étaient les autorités constituées. Il me dit qu’il n’en existait plus, que les Brigands avaient emporté tous les papiers et tué plusieurs patriotes connus. Je lui demandai si nous avions des blessés à l’hôpital. Il me dit qu’il n’y connaissait que des Brigands blessés. Je donnai cependant l’ordre à un officier de ma gendarmerie de se transporter à l’hôpital et d’en faire sortir tous les républicains. Il n’y en avait plus qu’un seul, qui avait le bras tout fracassé. Je le fis mettre sur un cheval et conduire à Saumur, à l’hôpital.
J’entrai en conférence avec plusieurs citoyens et je leur dis qu’il fallait constituer des autorités. – Au même instant, quatre hussards que j’avais envoyés à la découverte arrivèrent au grand galop ; le brigadier me dit que l’ennemi marchait dessus nous. Je fis sonner le boute-selle et deux minutes après je partais avec toute ma troupe en reconnaissance. Je les vis : ils étaient loin de moi à portée de canon et j’aperçus un gros de cavalerie sur la gauche, qui me tournait. En raison de notre petit nombre, je ne voulus pas exposer la troupe. N’ayant aucun ordre par écrit, l’occasion seule me commandait de battre en retraite sur la grand’route : nous sortîmes au trot de la ville de Thouars.
Je m’acculai derrière un moulin, et j’observai leur mouvement. Ils entrèrent dans Thouars au nombre de deux mille au moins. Un de leurs avant-postes était venu dans la plaine à la découverte ; aussitôt je dis : Allons, mes amis, il faut charger ces gueux-là ; – ce que nous fîmes. Nous leur tuâmes trente hommes, et nous avons emmené huit chevaux. Il était temps que nous abandonnions le reste, car pour trop avoir, nous aurions tout perdu : plus de huit cents cavaliers sortaient de la ville au grand galop ; mais nous avions sur eux l’avance d’une bonne portée de canon. Je fis retraite. – Le capitaine de gendarmerie que j’avais laissé à Montreuil pour commander en mon absence avait envoyé au-devant de nous, et à deux lieues, deux cents hommes d’infanterie. Ils nous rejoignirent à l’entrée du bois. Je fus content de cet ordre et la cavalerie ennemie s’en aperçut, car elle n’avait pas gagné de terrain sur moi et du moment que je vis la manœuvre, je donnai ordre de suivre tout droit : il n’y eut que quatre des leurs qui vinrent se faire tuer par l’infanterie ; tout le reste retourna sur ses pas. Je restai une bonne heure dans cette position, après quoi j’ordonnai la retraite.
Je perdis dans cette journée un hussard très brave qui fut tué d’un coup de carabine qu’il reçut au front. Il fallut le laisser sur le champ de bataille ; son cheval fut ramené. – Nous passâmes la nuit en campagne et j’ordonnai même d’allumer des feux dans des endroits où il n’y avait personne : je m’attendais bien à être attaqué au moins le lendemain, mais je n’eus pas cette satisfaction par l’avantage que la position offrait.
Quelques jours après, le général Salomon vint à Montreuil ; je lui fis voir tous les retranchements que j’avais fait faire : il fut content de mon zèle et m’invita à venir chez lui. Il me prévint que l’ennemi devait dans la nuit même évacuer Thouars et qu’il fallait prendre position.
Je lui demandai s’il avait des troupes avec lui. Il me dit qu’il venait de Saumur et que le général lui avait promis cinq mille hommes, et que la 35e division formerait son avant-garde. Je lui dis : Si vos hommes sont de bonnes troupes, nous pouvons réussir. Le lendemain arriva la petite armée et le surlendemain nous nous mîmes en route. Dans la journée je pris position d’avant-garde à Vrine et j’y fis construire une batterie. Nous restâmes pendant huit jours sans faire aucun mouvement. Le général avait rétabli dans la ville de Thouars les autorités constituées ; il fit même des sorties très vives sur les Brigands, surtout deux remarquables et bien avantageuses à la République. J’étais très content de lui : outre qu’il leur tua beaucoup d’hommes, il avait encore soin de ramener avec lui beaucoup de subsistances, surtout des bœufs en quantité. Nous eûmes dans ces deux sorties douze républicains de tués, entre autres le père d’un petit tambour qui était de ma gendarmerie et dont la Convention fit mention honorable.
Cet enfant battait la charge ; son père, en tirailleur devant lui, fut tué ; il l’embrassa, lui prit son portefeuille et ses pistolets de poche et continua à battre la charge comme auparavant, jusqu’à ce que l’ennemi fût en pleine déroute.
Comme je n’avais pas fait de sortie – le général m’ordonnait de rester – j’avais soin de me trouver sur le passage de la troupe et je leur faisais boire à tous une larme d’eau-de-vie, car ces sorties étaient des marches de douze et quinze heures.
J’allais tous les jours de Vrine, où j’étais cantonné, à Thouars. Je demandai de quelle manière et comment l’ennemi l’avait pris. Tous ceux à qui j’en ai parlé m’ont assuré que la ville avait été livrée par le général Quétineau, qui était au pays [17]. Plusieurs m’assurèrent qu’ils l’avaient vu embrasser La Rochejacquelein, général des Brigands, sous les murs. Le fait m’a été très bien confirmé.
C’était dans cette bataille que nous avions perdu les braves Marseillais du 10 août : ils furent égorgés à Vrine, au poste même que j’occupais ; un de mes avant-postes était l’endroit où les Brigands les dépouillèrent et les ont enterrés. J’observe que Quétineau était de Montreuil et avait des propriétés à côté de Thouars. On m’a assuré qu’il avait trouvé des protecteurs dans les membres de la Convention nationale, tels que le représentant Carra, etc.
CHAPITRE XVIII
Les malheurs de Leîgonnyer. – Nous levons le camp. – Entre Thouars et Montreuil. – Bataille de nuit. – Un feu terrible. – Nos pertes et celles de l’ennemi. – Nous aurions passé.
Le général Leîgonnyer commandait à Doué et avait essuyé plusieurs échecs, entre autres une déroute complète [18]. Ce jour-là même, le général Salomon, à Thouars, reçut l’ordre à quatre heures du soir de se reployer sur Saumur avec tous ses bagages [19].
Il fit battre la générale, mit toutes les voitures en réquisition, fit charger les voitures et mit en marche toute la troupe. – J’observe qu’ayant l’ordre d’évacuer ma position, je fis abattre la batterie que j’avais élevée, afin qu’elle ne servît pas contre nous.
À moitié chemin de Thouars à Montreuil – la distance entre ces deux endroits est de quatre lieues – nous apprîmes que Montreuil était occupé par une avant-garde ennemie qu’on disait forte de six cents hommes. Le général me dit : « Toi qui as été si longtemps dans ce canton, tu dois connaître la position. » Je lui répondis que quand il y aurait le double de Brigands qu’on ne disait, cela ne nous empêcherait pas de passer, et que je connaissais toutes les ressources de l’endroit. À une demi-lieue de Montreuil la brume tombait. Je dis au général qu’il fallait envoyer des éclaireurs afin de fouiller tous les alentours. Il y marcha lui-même à la tête de la cavalerie.
Un quart d’heure après, les Brigands nous attaquaient par un feu terrible : aucun coup de canon ni de fusil ne partait des hauteurs voisines ; ils venaient tous du bas de la montagne. Je vis bien que nous avions été trompés et qu’il n’était pas possible que six cents hommes fissent un feu si soutenu. La colonne avait avec elle six pièces de quatre : je les fis placer deux sur le grand chemin, deux sur la droite, les deux autres sur la gauche ; sur-le-champ j’envoyai au général un officier de ma gendarmerie pour lui dire de se retirer : ce qu’il fit. Je déployai aussitôt deux bataillons à qui j’ordonnai le feu de file ; ma gendarmerie occupait la droite ; en même temps, les batteries donnèrent. Les boulets de l’ennemi passaient par-dessus nos têtes ; le feu de nos six pièces était si bien servi que l’on aurait fait lecture d’une lettre. J’étais au milieu des pièces.
Un de mes braves canonniers fut frappé d’un boulet qui lui emporta la cuisse : il mourut sur le champ de bataille en criant : Vive la République ! Plusieurs dragons furent tués par une autre décharge. Le général vint à moi et me dit : « Mon ami Rossignol, on nous a trahis, je suis déshonoré ! » Il pleurait. Je lui dis : Rassurez-vous, il y a une grande plaine sur la droite, voyez si, avec votre cavalerie, il n’y a pas moyen de passer. – Il y fut, mais revint bientôt en disant que l’ennemi nous tournait de ce côté : je fis conduire deux pièces de canon avec ordre de ne charger qu’à mitraille. Ces deux pièces leur tuèrent beaucoup de cavalerie, car elle était placée dans un ravin ; on la distinguait très bien. Les Brigands nous chargèrent à corps perdu. Le feu de nos pièces avait cessé un quart d’heure par manque de gargousses à boulets. Alors je fis charger toutes les pièces à mitraille et l’on fit feu presque à coup portant ; on les voyait tomber par pelotons, mais le malheur voulut qu’une de nos pièces fût démontée par un boulet.
L’infanterie et l’artillerie firent des merveilles cette nuit-là ; le feu cessa vers les onze heures et demie du soir. Le général ordonna la retraite et m’ordonna de la protéger le mieux possible. Je fis battre mes canonniers à la prolonge : ainsi ils empêchèrent de fondre sur nous l’ennemi qui nous poursuivit pendant une bonne demi-lieue. Près d’un bois fort épais, je fis faire un superbe feu de file par ma gendarmerie qui les empêcha d’avancer.
Les charretiers, qui étaient du pays, avaient coupé tous les traits des chevaux et s’étaient sauvés, laissant sur le grand chemin toutes les voitures chargées.
Nous avons perdu à cette bataille cent deux hommes sur cinq mille environ que nous étions, tout compris. L’ennemi, comme je l’ai su par des personnes de Montreuil qui me l’ont assuré, nous avait opposé au moins quarante mille hommes ; les bourgeois de l’endroit en enterrèrent à leur dire plus de quatre mille et s’il n’avait pas fait nuit, nous aurions sans doute passé… Le fait est qu’on ne se bat pas si bien la nuit que le jour.
L’ennemi prit Saumur le lendemain, et il est certain qu’il n’y serait pas entré si nous avions pu passer, car notre colonne était ce qu’on appelle de bonne troupe [20].
CHAPITRE XIX
La retraite au hasard. – À la recherche des canons. – Qui vive ? – Le général prit le devant. – Je commandais la colonne. – Les officiers se rassemblèrent. – Nous jurons de marcher en masse – Devant le Conseil de Niort. – Biron un fouet à la main. – Ripostes à Bourdon (de l’Oise). – Je leur tiens tête.
Nous arrivâmes à Thouars à quatre heures du matin. Les soldats étaient si fatigués qu’ils se couchèrent par terre. Le général n’entra point dans la ville : il voulait se reployer sur Niort. Je fis tous mes efforts pour entraîner la troupe, mais il y avait deux chemins et nous n’avions aucun guide : les uns prenaient à gauche ; pour moi, avec deux cents hommes de gendarmerie et une seule pièce de canon, je suivis la même route que le général ; le tout au hasard, et nous le trouvâmes avec sa cavalerie qui nous attendait. Il me demanda des nouvelles de son artillerie ; je lui dis que les canons n’étaient pas derrière moi. Une demi-heure après, on vint nous dire qu’ils avaient pris l’autre chemin et qu’ils ne pouvaient être éloignés de nous que d’une demi-lieue. Le général commanda à des ordonnances de les aller chercher ; mais aucun ne voulut y aller. J’y fus avec le guide qui venait d’arriver et le général me promit de m’attendre. Je traversai la plaine et j aperçus l’artillerie. Il ne faisait pas encore jour. Les canonniers me crièrent dessus : « Qui vive ? » Je leur répondis : Républicain ! – mais ils ripostèrent par une décharge de trois ou quatre coups de fusil. Mon guide piqua des deux et foutit le camp comme si le diable de ses pères courait après lui. J’étais bien embarrassé. Je fis retraite hors de la portée des coups de fusil, et comme j’entendais la troupe en marche qui continuait de suivre la grande route, je criai : Qui vive ! à mon tour. Tous s’arrêtèrent. Je recommençai une seconde fois ; ils me répondirent. Je leur dis : Le général le Rat est par ici (c’était le sobriquet que la colonne avait donné au général Salomon) ; vous n’êtes pas dans la bonne route. – Un d’entre eux reconnut ma voix ; je m’approchai et je leur fis traverser la plaine. Nous rejoignîmes le général à la pointe du jour : il fut très charmé d’avoir son artillerie avec lui, moins une pièce qui avait été enclouée par le lieutenant des canonniers de la 35e division de gendarmerie et qui resta sur le champ de bataille près Montreuil.
Nous prîmes le chemin de Niort par Fontenay et Saint-Maixent. Arrivé dans ce dernier endroit, le général prit le devant et fut à Niort auprès du général en chef Biron. Il y eut là, le lendemain, un conseil de guerre, auquel notre général assista, mais dont je ne puis rendre compte.
En nous quittant à Saint-Maixent, le général Salomon m’avait confié le commandement de la colonne. À la halte, tous les officiers s’assemblèrent en tête de la colonne : je ne savais pourquoi et je leur en fis la demande. Un d’eux, qui était colonel de la légion Rosenthal, me dit qu’il fallait faire appeler un officier de chaque corps avec un sous-officier et le plus ancien soldat afin de prononcer un serment et de réclamer à Niort auprès du général en chef l’ordre de ne point nous diviser, et, autant qu’il serait possible, de nous battre ensemble. Je fus de cet avis, connaissant cette brave petite brigade, et je dis que si l’on voulait nous présenterions, en arrivant, un officier de chaque corps chez le général Biron. Les mêmes firent aussi la motion de ne plus marcher par petites portions, disant que si nous étions souvent battus, c’est que l’on nous envoyait toujours quatre contre quarante. Je fus de cet avis et nous jurâmes de ne plus marcher qu’en masse sur ces coquins-là ; – mais ce serment ne fut pas tenu. Une députation choisie parmi nous devait donc porter notre vœu au général en chef, dès que nous serions arrivés à Niort ; chacun fit son observation et je pris aussi la parole : Mes amis, nos réclamations sont fondées. Plusieurs échecs que nous venons d’essuyer nous prouvent plus que jamais le besoin de grouper nos forces. Ce sont toujours les mêmes en garnison et toujours les mêmes au feu. Je certifierai cette vérité.
Notre députation devait se réunir encore le lendemain matin. Je me suis trouvé au rendez-vous avec quatre personnes. L’heure était passée ; personne plus n’arrivait : on avait eu soin de nous éloigner à une bonne lieue les uns des autres. Cependant nous partîmes seuls et nous allâmes chez le général Biron.
On nous dit qu’il était au conseil avec les représentants du peuple. Le conseil se tenait chez un parent de Goupilleau. Je demandai le général Salomon ; il vint nous parler, et, après quelques instants, on nous annonça que je pouvais entrer seul. J’entrai donc et je dis : Citoyens, mes camarades sont à la porte… Je demande pour eux la permission d’entrer puisqu’ils sont envoyés comme moi. – Bourdon de l’Oise me dit qu’ils n’entreraient pas, mais que je pouvais m’expliquer. Je m’expliquai :
– Les officiers m’ont chargé de vous dire, au nom des braves camarades qu’ils commandent, que nous avons juré de nous battre ensemble et résolu de ne plus marcher en détail. Les Brigands donnent en masse, il nous faut faire de même. On nous envoie toujours quatre contre quarante… Le sang républicain est trop cher pour en faire si bon marché.
Biron était debout dans le Conseil, un fouet à la main : il tira sa clef de sa poche et la jeta sur le bureau en disant qu’il n’y avait qu’un lâche pour tenir de pareils propos, qu’il allait prendre un fusil et me montrer ce que c’était qu’un brave. Je lui dis : Vous pouvez être aussi brave que moi, mais pour davantage je vous en défie.
Depuis ce moment je fus en horreur aux amis et aux flatteurs de Biron [21].
Bourdon de l’Oise me tint ce propos : il faut qu’un militaire qui a reçu un ordre l’exécute. – Oui, quand il y a possibilité. – Si l’on vous commandait de marcher devant une batterie de canons, vous devriez le faire. – J’irais. Mais si je trouvais moyen par quelque position ou par rue de prendre la batterie sans m’exposer devant les bouches à feu, ce serait à moi d’aviser pour m’en tirer le mieux possible.
On me dit que je pouvais sortir et que je ne devais pas souffrir que mes hommes prêtassent de tels serments. Alors, en m’en allant je dis : Je l’ai juré moi-même ! Ainsi nous sommes tous coupables. – Et je m’en fus.
Je rendis compte à mes camarades des résultats de l’audience. Ils ne furent pas des plus contents.
J’observe que l’on a divisé cette colonne. Cependant nous fîmes un coup de feu ensemble au Bureau contre les Brigands, et ce fut le dernier, puisque Biron nous divisa.
CHAPITRE XX
Une belle sortie. – Quelques traits. – Dans le château que je fouillais. – De quoi rafraîchir la troupe. – Chalbos fait vider les sacs. – Biron me donne une leçon. – « Il n’y était pas. »
J’arrive à l’affaire du Bureau.
Ordre fut donné de battre la générale à quatre heures et rendez-vous donné à chaque bataillon.
Nous y étions tous. Les grenadiers de la Convention marchaient en tête de notre colonne avec la 35e division. Toute la nuit jusqu’au lendemain, nous marchâmes. Le représentant Goupilleau de Montaigu y était, le général Chalbos commandait, le général Salomon marchait à la tête de la cavalerie. Les avant-postes ennemis furent surpris ; ils ne nous attendaient pas si matin ; cependant j’appris que vers les huit heures du soir l’ennemi s’était retiré, ne laissant en position que deux mille hommes. Ils ripostèrent ; mais devant notre déploiement d’infanterie, ils nous abandonnèrent la place : tous furent tués. Beaucoup s’étaient réfugiés dans l’église sous de la paille : on y trouvait des fusils, des piques, sur quoi ils étaient couchés. On ne fit pas plus de vingt prisonniers. – Je vis une femme qui avait un pistolet à la main, qu’elle tira sur un républicain : elle fut tuée. On trouva dans ses poches des paquets de cartouches. J’ai vu un jeune brigand en faction à la porte d’un château que le général Chalbos envoya fouiller par la compagnie des grenadiers et plusieurs soldats de notre gendarmerie ; ce jeune gars, âgé tout au plus de dix-sept ans, nous cria dessus : « Qui vive ? » – Sur la réponse « Républicain », il tira son coup de fusil… et rechargeait son arme, comme on le saisit. On l’amena au général, qui ne voulut pas qu’il fût tué.
Dans le château que je fouillais, tous les appartements furent visités : les draps des lits étaient encore chauds. Il y en avait sept, tous lits de maître. Trois femmes étaient levées et en négligé : le représentant du peuple observa qu’il fallait respecter les propriétés et les personnes.
Je m’en revins avec ma troupe et j’allai chercher de quoi la rafraîchir.
Les Brigands étaient bien approvisionnés : on trouva des chambres pleines de pain, des celliers garnis de vins de toutes qualités, des porcs en grande quantité. Je fis charger deux voitures de cochons que l’on saigna, et l’on emmena une voiture de pain.
En route, pour retourner à Niort, après une heure de marche, le général Chalbos fit vider tous les sacs, que la troupe avait garnis de butin, et dit que le premier qui serait trouvé avec du butin serait fusillé sur-le-champ. La route était couverte de toutes sortes d’effets. Il y eut un hussard qui tua un brigand et qui lui prit cent cinquante louis en or qu’il portait dans une ceinture. Nous rentrâmes à Niort dans nos cantonnements.
La troupe était si fatiguée qu’elle ne pouvait plus marcher. On voyait des soldats couchés sur la route ; il y avait impossibilité de marcher en ordre. Biron vint au-devant de la colonne, à deux lieues de Niort. Il cria après tous les chefs de bataillon et après le général Salomon, à qui il dit mille injures. Pour moi, il me fit descendre de cheval : « Est-ce ainsi, monsieur, que l’on conduit une troupe ? » – Le ton fait la musique, général… je n’y peux rien ; je ne peux pas leur donner des jambes. – J’aurai soin de vous, me dit-il ; et il a tenu parole. Après bien des injures, il ajouta : « Rassemblez votre troupe à ce village et n’en partez qu’en bon ordre. » Je fis faire halte à ma gendarmerie, et après qu’il fut passé je continuai ma route.
À Niort, sur les sept heures du soir, la troupe était sous les armes et tout le monde criait : Vive la Nation ! Vive le général Biron ! – Il n’y était pas…, cria-t-on dans certain peloton. Biron fut si en colère qu’il courut au bataillon d’où la protestation était partie, et dit que le premier qui crierait serait fusillé sur l’heure. On ne dit plus rien.
Les grenadiers conduisirent les prisonniers en prison et les soldats rentrèrent dans leurs cantonnements.
CHAPITRE XXI
On veut perdre les braves gens. – Dans une auberge de Saint-Maixent. – Westermann comme individu. – Chez le commandant de place. – Un coupe-gorge. – Mon logeur effrayé. – On vient m’arrêter – Cent grenadiers pour moi – Un vainqueur de la Bastille au cachot. – J’écris à ma division. – Le capitaine Drouilly. – À Niort sous bonne escorte. – Mauvaise procédure. – En liberté.
Au bout de quelque temps, je reçus ordre de partir pour Tours avec ma division ; cet ordre était signé Biron et envoyé par le chef de l’État-Major nommé Nouvion. Je partis dès les trois heures du matin avec ma troupe et j’arrivai à dix heures à Saint-Maixent.
À moitié chemin, je rencontrai le général Westermann qui allait à Niort ; j’ai su le même jour par des volontaires que Biron et lui avaient parlé ensemble sur le chemin pendant une bonne heure. Le général Salomon, qui m’avait accompagné jusqu’à Saint-Maixent, me dit : « Méfie-toi ! on veut perdre et sacrifier les braves gens. »
Je le quittai pour faire loger ceux de mes gendarmes qui encore attendaient, deux heures après que nous étions arrivés. Je fus moi-même à la municipalité et m’inquiétai de leurs billets de logement. Plusieurs de mes amis étaient à Saint-Maixent qui me prièrent à dîner avec eux : j’y fus avec quatre officiers du corps.
Nous entrâmes dans cette auberge ; plusieurs personnes y buvaient à des tables ; l’un de nous demanda quelle était la garnison qui résidait et l’on nous répondit que c’était la légion de Westermann, dite du Nord, avec quelques bataillons de volontaires.
Plusieurs personnes vantèrent les exploits de Westermann. Je leur dis que je le connaissais pour très brave, mais qu’il n’était pas trop honnête homme. Ce propos les choqua ; de part et d’autre des sottises furent dites ; je fis remarquer que ceux qui soutenaient Westermann avaient bien raison, s’ils ne le connaissaient que comme militaire, mais que plusieurs d’entre nous le connaissaient comme individu et avaient même fait avec lui la journée du 10 août. Une chose certaine, c’est que Westermann avait essuyé un procès criminel sous l’inculpation d’avoir volé des couverts d’argent et qu’il ne s’était pas disculpé. La dispute s’échauffait : je leur dis des paroles dures et de nous laisser tranquilles. Après quelques instants, ils sortirent à quatre et furent porter plainte à l’officier qui commandait la place.
Vers les quatre heures après-midi, on vint nous chercher de la part de cet officier. Il avait quelque chose à nous communiquer, disait-on, car les Brigands étaient en marche sur nous. Je le crus naïvement : je pris mon sabre et je fus chez le commandant. J’y trouvai plus de trente officiers et aussi les quatre hommes de l’auberge qui dirent en me voyant : « Voilà le coquin qui a tenu les propos que nous vous avons rapportés, commandant. » Je ripostai : Je n’ai rien dit concernant votre corps. – Mais vous avez traité le général de voleur d’argenterie. – Oui, leur répondis-je, mais c’est à lui à m’attaquer et non à vous ; portez-lui vos plaintes et devant lui je soutiendrai tous les propos que j’ai avancés. Les voilà trois ou quatre biribis que je reconnus, qui voulurent tomber sur moi. Je mis la main sur la garde de mon sabre et dis au commandant que je n’étais pas venu chez lui pour être assassiné et qu’il répondrait de moi. Il empêcha que l’on se portât sur moi à aucune voie de fait, et il me dit : « Le général est parti à Niort ; comme supérieur, je vous ordonne les arrêts dans votre logement jusqu’à son retour. » Je lui dis que j’allais m’y rendre. En sortant, les disputeurs me dirent mille injures : l’un, qu’il me couperait bien un bras, un autre que ce serait un plaisir pour lui de me brûler la cervelle. Je me rendis pourtant à mon logement sain et sauf. Plusieurs officiers de la gendarmerie vinrent me voir à mon logement ; je priai un capitaine de rester avec moi afin qu’il pût rendre compte à la gendarmerie de cette affaire [22].
Je devais partir le lendemain matin à trois heures vu qu’il faisait extrêmement chaud. Voyant qu’à dix heures du soir on ne venait pas, je demandai de la lumière pour me coucher. Le maître de la maison où j’étais logé me dit qu’il allait m’en donner, mais qu’il ne voulait pas qu’elle restât allumée parce que je pourrais mettre le feu à sa maison. Je lui dis que j’étais un honnête homme et qu’if fallait qu’il fût bien prévenu contre moi pour me parler comme il le faisait. Il me tint plusieurs propos contre-révolutionnaires ; je lui dis des paroles dures et ne voulus pas de sa lumière. J’étais logé sur les derrières de la maison. Vers onze heures du soir, deux officiers vinrent dans ma chambre, le sabre à la main, et demandèrent le nommé Rossignol. – C’est moi. – Levez-vous et venez parler au général. – Où sont vos ordres ? – Les voilà.
L’ordre était conçu à peu près en ces termes :
Le commandant de la cavalerie de la Légion du Nord se transportera au logement du commandant de la 35e division de gendarmerie, se saisira de ses armes et le conduira au quartier du général.
WESTERMANN.
Je remis mon sabre et mes deux pistolets et je descendis. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vis à ma porte cent grenadiers, baïonnette au canon. Ils se partagèrent en deux pelotons qui se refermèrent sur moi ; deux officiers me serraient de près, un de chaque côté, le sabre nu à la main. Je leur dis : Il ne me manque plus que la chaîne au cou et un bonnet pour avoir l’air d’un galérien.
Je fus ainsi conduit jusque sur la porte du général ; le commandement du détachement monta alors chez Westermann avec mes armes ; je voulais l’accompagner, mais il s’y refusa. Un quart d’heure après l’officier revint et commanda « À la prison ! » Je lui dis qu’il m’avait fait lever pour parler au général et que son ordre était formel. – « Le général ne veut point vous parler… et marchez ! » – Il fallut marcher.
À la prison, arrivé dans une cour, le concierge vint, il était bien onze heures et demie, et le commandant lui dit : « Il faut mettre ce coquin-là au cachot. Je protestai devant le détachement qu’une loi le défendait, et que depuis que j’avais aidé à renverser la Bastille il ne devait plus exister de cachots ; j’ajoutai qu’on me tuerait plutôt que de m’y faire entrer. Le concierge se chargea de moi et me traita avec assez d’humanité.
Sur les deux heures du matin, on vint sonner et je dis au capitaine qui m’avait suivi : je te parie que l’on vient me chercher pour me tuer. Bravement il me répondit : « Nous mourrons ensemble. » Le nom de cet homme était Drouilly, capitaine des canonniers de la 35e division, courageux et instruit.
On monta dans ma chambre. Nous étions couchés par terre sur un matelas. Le concierge me dit : « C’est la cavalerie qui vient vous chercher. » Je descendis et je connus qu’on avait ordre de me transférer à Niort et de me conduire auprès du général en chef Biron. Je demandai l’ordre ; il me fut présenté.
Les soldats de l’escorte avaient des cordes pour m’attacher et je leur demandai pourquoi. Ils me répondirent que le général Westermann leur avait recommandé cette précaution. Je leur dis que je ne voulais pas fuir et qu’ils ne m’attacheraient pas, mais qu’ils pouvaient tripler l’escorte si bon leur semblait. Ils renoncèrent à leurs cordes.
Je demandai une feuille de papier et j’écrivis une lettre à ma division, dans laquelle je lui recommandais l’obéissance et l’invitais à rester calme ; j’y donnai le pouvoir en mon absence au premier capitaine commandant ; le capitaine Drouilly se chargea de cette lettre.
Je n’avais point d’argent : ce brave officier me donna son portefeuille, dans lequel je pris six cents livres dont je lui fis un billet payable sur mes appointements auprès du quartier-maître de la division. Je voulais avoir un cheval avec mon domestique et mon porte-manteau, mais ce fut impossible.
Je partis pour Niort.
J’ai appris que vers les trois heures la légion du Nord était sous les armes ; ma gendarmerie se rassemblait pour partir et tous les gendarmes demandaient après moi, et ne voulaient pas partir sans m’avoir à leur tête. Les deux divisions se seraient battues l’une contre l’autre, si l’on n’avait lu la lettre que j’avais écrite, qui les calma. Après bien des contestations, ils se mirent en route. Il y eut deux coups de pistolet tirés par deux volontaires de la légion de Westermann, qui ne blessèrent personne. Ce détail me fut rapporté lorsque j’eus rejoint ma division.
Quant à moi, j’arrivai à Niort à cinq heures du matin, bien escorté de huit cavaliers et un officier de gendarmerie, le tout à cheval. En arrivant on me mena chez le général Biron. Il n’était pas visible. L’officier entra dans sa chambre et j’entendis qu’on disait : « Menez-le chez le chef de l’État-Major. » On me conduisit chez Nouvion qui ordonna de me mettre dans la tour, mais le concierge ne voulut pas me recevoir. Reconduit chez Nouvion, qui était dans son sommeil : « Mettez-le à la prison de la ville… » Je voulais lui parler, il ne voulut pas m’entendre. Me voilà en prison sans savoir pourquoi.
Après deux fois vingt-quatre heures, j’écrivis une lettre au général Biron. Il me fit réponse que ce n’était pas par son ordre que j’avais été arrêté, que les autorités civiles instruisaient un procès contre moi, et que cela ne le regardait en rien. De suite j’écrivis à l’accusateur public qui répondît ne pas me connaître et m’assura qu’aucune plainte contre moi ne lui était parvenue. Alors, seconde lettre à Biron, et cette fois pas de réponse.
Au bout de quatre jours, je fus interrogé sur un repas que plusieurs bataillons avaient donné au général Salomon et auquel j’avais été invité ; mais dans l’interrogatoire que l’on me fit subir, on s’était trompé de nom pour le pays, de manière que je pus répondre justement que je n’avais jamais été dans cet endroit. On me fit encore beaucoup de questions et à toutes je répondais que cela ne me concernait pas… et que d’abord je n’avais jamais été dans le cantonnement dont on me parlait. La procédure ainsi engagée ne pouvait pas continuer ; il fallut attendre d’autres pièces à ma charge qui venaient de chez le juge de paix, et l’interrogatoire fut remis au lendemain. J’étais porteur de toutes les lettres de Biron et de l’accusateur public, ainsi que des doubles de celles que je leur avais écrites.
En prison, le général Salomon m’envoyait de sa table à dîner, et j’avais un grenadier de la Convention qui venait me voir et qui se chargeait de mes commissions.
J’écrivis au ministre Bouchotte et je lui exposai les manœuvres arbitraires auxquelles on se livrait pour me perdre ; cette lettre parvint à temps [23] ; mais ce qui me retira de cette affaire, c’est que, le premier jour de mon départ de Saint-Maixent, les officiers étant assemblés prirent un arrêté au nom du corps, portant que deux officiers partiraient à franc étrier et se rendraient à Tours. Admis au Conseil et s’acquittant de leur mission, disant comment j’avais été enlevé dans la nuit et le mouvement qu’on avait excité entre les deux divisions, ils témoignaient en outre du désir que la gendarmerie avait de me ravoir, etc…
Les représentants Richard, Choudieu, Merlin de Thionville, Reubell, prirent un arrêté sur-le-champ pour me faire mettre en liberté. Je possède cette pièce [24]. Un courrier extraordinaire partit aussitôt pour Niort et, sur les onze heures du matin, je fus remis en liberté.
Le même jour, une lettre du ministre de la Guerre me rappelait à Paris pour y rendre compte de ma conduite.
Bourdon de l’Oise et Goupilleau de Fontenay, que je rencontrai dans la rue comme j’allais à la poste aux chevaux, me dirent : « Comment, tu n’es pas encore parti ?… Si Biron te voyait, il te ferait arrêter [25]. » – Est-ce que vous n’êtes pas les représentants du peuple ? leur dis-je, il ne peut rien faire contre moi, tant que vous serez ici. – « Pars toujours, me répondirent-ils. » À la poste, je commandai deux chevaux, mais pour les avoir je fus obligé d’aller au département chercher un ordre qui me fut délivré après bien des contestations : il me fallut montrer l’arrêté des représentants. Après cela je fus encore obligé d’emprunter une voiture ; ce fut le citoyen Lalirey, commissaire-ordonnateur de l’armée de l’Ouest, division des Sables, qui me prêta un cabriolet.
Je passai par Tours, où je vis les représentants du peuple, que j’informai exactement de ce qui s’était passé, et, sans tarder, je partis pour Paris avec la lettre du ministre.
CHAPITRE XXII
Au Comité de salut public. – Je retourne à l’armée. – Nous rencontrons Biron au relai. – Je commande à Saumur. – Les travaux de défense. – Les bourgeois de la ville en bonnet de nuit. –. Général de division. – Un courrier extraordinaire. – Il fallut accepter. – Me voilà général en chef.
À Paris, je me présentai chez le ministre de la Guerre avec l’intention de lui faire part de mes observations sur la guerre de Vendée. Il me dit de venir le soir au Comité de salut public : c’était la première fois que je lui parlais. À mon départ pour l’armée de l’Ouest, j’avais vu Beurnonville, ministre de la Guerre, mais je ne connaissais pas son remplaçant, ni directement ni indirectement.
Le lendemain de mon arrivée, c’était le jour de l’assassinat de Marat, j’allai au Comité de salut public que je trouvai rassemblé. Pache, maire de Paris, et le ministre Bouchotte y étaient. Je fus présent à toutes les mesures prises jusqu’à une heure du matin, et ne me retirai qu’après avoir communiqué toutes mes réflexions. Le lendemain, j’instruisis mes concitoyens sur les manières de la guerre de Vendée ; ensuite je retournai chez le ministre pour lui demander de quoi faire mon voyage, car j’avais l’intention de retourner à l’armée : un bon de 2.400 livres me fut délivré. Je partis le troisième jour après mon arrivée, emmenant avec moi deux officiers qui étaient venus à Paris solliciter ma mise en liberté auprès du Comité de salut public.
Nous arrivâmes à Tours.
L’armée avait essuyé une déroute complète à Vihiers et s’était retirée en mauvais ordre, une partie sur Tours, une autre partie sur Chinon. Ce fut à cette bataille que le général Menou fut blessé. Le bruit se répandit que les Brigands étaient rentrés à Saumur. Alors c’était La Barolière qui commandait en chef, car Biron avait été destitué. (J’avais rencontré ce dernier en chaise de poste au-dessus d’Étampes. Nous n’étions pas assez amis pour nous parler, mais les deux officiers qui m’accompagnaient lui lancèrent quelques sarcasmes piquants en changeant de chevaux à la poste.)
Je voulus savoir par moi-même si l’ennemi était à Saumur, comme on le disait ; j’abandonnai donc à Tours mes deux camarades, en leur recommandant de faire tous leurs efforts pour rassembler notre division ; je pris mon domestique avec moi et m’assurai de bons chevaux de selle, et nous galopâmes à franc étrier jusqu’à Saumur [26].
J’appris au faubourg que l’ennemi n’était pas encore dans la ville, mais qu’il allait y entrer. En ville, le premier citoyen que j’accostai fut le maire de Saumur ; je le connaissais, mais lui ne me reconnaissait pas, car je portais un déguisement ; je lui dis mon nom et nous liâmes conversation. Je lui demandai où était l’ennemi ; il me répondit que les Brigands étaient à Doué. Il était bien fâché que la troupe ne se fût pas arrêtée à Saumur. Après plusieurs renseignements, je sus de lui qu’il y avait à Saumur un membre du département de Paris que je connaissais ; c’était le capitaine Momoro. Je fus le trouver et l’invitai à se transporter à Tours ou à Chinon, afin de faire marcher les troupes sur Saumur et d’approcher l’ennemi. Il me dit que c’était son intention, mais que, restant seul, il ne pouvait quitter la ville. Alors je fus trouver à la poste mon domestique et je repris mon costume militaire, car j’avais reçu un ordre des représentants du peuple, qui me nommait au grade d’adjudant général. Il était donc de mon devoir de rassembler le plus possible de forces et de commander Saumur. En cette qualité, j’écrivis sur l’instant une lettre au général La Barolière. Comme je finissais cette lettre, on vint m’annoncer que Ronsin avec sa suite venait d’arriver. Je n’avais jamais vu Ronsin, mais j’avais beaucoup entendu parler de lui. Il y avait avec lui le citoyen Parein, que je connaissais pour un homme éclairé, vrai républicain attaché par principe à la Révolution et vainqueur de la Bastille [27]. Je fus le voir : il me dit que j’étais nommé général de brigade et que le citoyen Ronsin, adjoint au ministre de la Guerre, avait ma lettre de service, puis il me présenta à Ronsin qui m’accueillit très patriotiquement et me dit qu’il fallait que je vinsse avec lui à Chinon, pour me faire reconnaître général par les représentants du peuple et le général La Barolière. Nous prîmes une chaise de poste et partîmes de suite.
En arrivant nous fûmes chez les représentants à qui nous communiquâmes nos idées sur l’avantage qu il y avait à faire marcher des troupes sur Saumur ; de là, nous fûmes chez le général à qui je fis voir mon brevet : il me donna de suite le commandement de Saumur et mit à ma disposition les troupes que je lui demandais pour composer ma brigade. J’eus soin de lui demander ma gendarmerie et les ordres furent expédiés en conséquence.
Nous ne partîmes à Chinon qu’après avoir engagé les représentants du peuple à venir à Saumur : ils furent de cet avis et vinrent y établir quelques jours après leur quartier général.
À Saumur, je distribuai les forces dont je disposais sur les points capables d’être soutenus ; je désignai le poste de chaque bataillon ; je fis entrer dans le château une bonne garnison ; je fis monter des canons, réparer les fortifications sur la ligne de défense, creuser des retranchements, et je conservai un point de retraite assuré par une batterie de deux pièces de huit soutenue par ma gendarmerie ; une autre batterie fut montée dans le faubourg, vis-à-vis la rivière, en position de battre le quai par où les Brigands avaient tourné Saumur ; un bataillon campa sur la rive droite pour garder les endroits qui étaient guéables. Je fis encore miner un pont de pierre avec une mèche gardée par des sentinelles de distance en distance. Les Brigands informés ne vinrent plus attaquer Saumur. J’avais fait abattre un bois sur la droite, par où l’ennemi risquait de venir : citoyens et citoyennes pouvaient aller y chercher du bois pour leur consommation.
Une fois l’ennemi marcha de nuit sur Saumur. Il était à Doué. Je fis battre la générale à deux heures du matin et ma troupe se rassembla sur la place d’Armes en bataillon carré. J’envoyai un escadron avec ordre de ne point revenir sans avoir reconnu la marche de l’ennemi et sans avoir fait le coup de feu. Après avoir expédié les ordres nécessaires, je me rendis sur la place d’Armes, et au centre du bataillon, je vis les bourgeois de la ville en robe de chambre et bonnet de nuit. Un d’entre eux disait aux soldats que toute résistance était inutile, car nous n’étions pas en état d’empêcher les Brigands de prendre la ville, et il déconcertait par un pareil langage les troupes républicaines ; je le fis arrêter et conduire en prison ; puis je dis aux autres citoyens, devant leur refus de défendre leurs foyers et puisqu’ils tendaient eux-mêmes les bras à l’ennemi, que j’allais me retirer dans le faubourg et battre la ville à boulets rouges, quand les Brigands y seraient entrés. Beaucoup de citoyens voyant ma résolution vinrent se ranger sous le drapeau républicain. Je les mis à droite et à gauche le long de la rive, en seconde ligne. Je sortis alors avec quatre bataillons et j’arrivai assez à temps pour soutenir mon escadron aux prises avec l’avant-garde des Brigands. Je déployai mes troupes et le feu fut si bien soutenu, pendant une bonne heure, que nous avions sur eux un avantage marqué ; cependant j’ordonnai la retraite jusqu’au pont afin de les attirer dans le piège que je leur avais tendu, mais ils étaient si bien avertis qu’ils ne vinrent pas s’y frotter. Abandonnant l’attaque sur Saumur, ils portèrent leurs forces sur les buttes d’Érigne, vis-à-vis les Ponts-de-Cé.
Ce fut quelques jours après que je fus nommé général divisionnaire et, en huit jours de temps, promu, par la Convention nationale au grade de général en chef de l’armée de l’Ouest [28].
Ce courrier extraordinaire arriva vers les deux heures du matin. Le paquet était adressé à Ronsin qui me manda aussitôt : j’y fus. Il me remit les lettres à mon adresse, mon brevet de général en chef et le décret de la Convention nationale portant cette nomination : j’avoue franchement que cela me surprit beaucoup, et je dis moi-même à tous ceux qui étaient présents que je ne pouvais accepter, vu que je n’avais pas les moyens requis pour remplir ce grade, que c’était impossible, et que je remerciais, et qu’il y avait bien d’autres hommes plus éclairés que moi, et que je ne connaissais rien aux affaires de cabinet. On me donna deux jours pour faire mes réflexions. Je fus trouver les représentants Richard et Choudieu à qui je tins le même langage. On s’assembla dans cette journée. Au milieu de tous les républicains, je démontrai mon peu de valeur pour cette fonction. Malgré toutes mes observations, je fus engagé par les représentants du peuple, par tous les généraux, par les commissaires du pouvoir exécutif du département et de la Commune de Paris à accepter la proposition qui m’était faite au nom de la République française. Tous voulaient m’aider de leurs conseils ; ils disaient qu’il y aurait toujours un représentant du peuple avec moi, qu’aucun patriote ne m’abandonnerait et que ce serait agir en mauvais citoyen que de refuser le service du pays. Toutes ces belles paroles, leur disais-je, avec la bonne volonté que j’ai ne me donnent pas le talent que je voudrais avoir ; j’ai des intentions, mais peu de lumières… Et voilà à peu près le discours que je leur tins pendant deux jours. Enfin il a fallu me résoudre à accepter ce grade important, et je l’ai fait. J’observe qu’à ce moment toute la classe des nobles était rappelée des armées et suspendue de ses fonctions.
Me voilà général en chef. Je ne pouvais concevoir par qui et comment cela m’était venu [29].
CHAPITRE XXIII
Les représentants à Saumur. – Mon différend avec Philippeaux. – En tournée d’inspection. – Scène violente à Chantonnay. – Ils croyaient me donner un brevet de jeanfoutre. – Sur le grand chemin. À coups d’arrêtés. – « La grande destitution du général Rossignol. » – À la Convention. – Je suis acclamé.
C’était du temps que l’armée de Mayence arrivait dans la Vendée [30]. Les représentants du peuple à l’armée de Brest se rendirent à Saumur. J’écrivis une circulaire à tous les généraux, les convoquant en conseil de guerre. Le représentant Philippeaux vint le premier à Saumur et me demanda si l’on pouvait passer à Nantes un bataillon de bonnes troupes. Je lui dis que, sans délai, le bataillon qu’il jugeait nécessaire était à sa disposition. Deux jours après, il m’en demanda deux autres et je lui fis observer que ce serait dégarnir beaucoup la ligne qui était établie. – Vous voulez laisser prendre Nantes, me dit-il. – J’insistai pour lui démontrer qu’avec peu de troupes de ligne et les citoyens de Nantes il avait pu résister fortement à l’attaque faite par les Brigands, et les avait battus, que cette ville avait été depuis renforcée de trois bataillons, et que celui qui était en route faisait quatre… Après bien des propos inutiles, il s’en fut en colère, et sans tarder il fit paraître une brochure contre moi qui ne tendait qu’à jeter un louche terrible sur ma conduite. Je fis part de mes inquiétudes aux représentants Richard, Choudieu et Bourbotte, qui prouvèrent à Philippeaux combien sa diatribe était inconséquente. Un soir je rencontrai celui-ci et je lui montrai son imprimé : notre entretien fut chaud. Je lui dis : Laissez arriver l’armée de Mayence, je vous promets de vous faire passer les forces que vous jugerez à propos, mais pour le présent ce serait dégarnir une ligne pour en garnir une autre, ce serait par conséquent une opération militaire critiquable avec raison [31].
Je partis pour faire ma tournée du côté des Sables, Niort, Fontenay-le-Peuple, etc. [32]. J’étais accompagné du représentant Bourbotte. Je visitai toutes les colonnes qui étaient sous mes ordres ; je parlai à tous les généraux le langage républicain, en leur disant qu’il fallait que toute vengeance personnelle cessât, qu’il ne fallait voir que l’intérêt général.
J’observe qu’avant de quitter Niort Goupilleau de Montaigu vint me demander si j’avais le dessein de faire exécuter les décrets du 1er août concernant la Vendée. Je lui dis qu’en ce moment les décrets avaient force de lois et que mon intention était de les mettre à exécution. Son collègue Bourbotte lui demanda s’il voulait dîner avec nous : il refusa. J’ai su qu’il était parti le jour même à franc étrier pour la Châtaigneraie [33] où étaient Goupilleau de Fontenay et Bourdon de l’Oise. J’ignore leur conversation, mais il sera facile d’en juger.
Le lendemain, sur le midi, j’arrivai à la Châtaigneraie, accompagné de Bourbotte, de Moulin, actuellement général en chef, de Hazard, qui a été par la suite chef de l’état-major de l’armée des côtes de Brest, de Momoro et du nommé Grammont, qui a été depuis chef de l’armée révolutionnaire à Paris.
À deux lieues de distance, j’avais envoyé une ordonnance aux représentants Bourdon de l’Oise et Goupilleau de Fontenay, les avertissant de mon arrivée, ainsi que le général Tuncq. Nous étions à la Châtaigneraie peu après l’ordonnance. J’entrai dans la chambre des représentants, et ce fut à ce moment que j’entendis Bourdon de l’Oise crier par la fenêtre : « Que l’on me fusille cette ordonnance-là ! » mais d’abord je ne crus pas qu’il était question de l’homme que j’avais envoyé en avant. Le général Tuncq sortait de la chambre et comme je lui disais que je venais communiquer avec lui sur la position de l’armée, il me répondit qu’il allait remonter. Je souhaitai le bonjour aux représentants et mis mon sabre sur le lit. Goupilleau de Fontenay me demanda ce que je venais faire. Je lui répondis que mon grade me permettait de parcourir toutes les colonnes qui se trouvaient sous mon commandement, et que je venais me concerter avec eux sur les moyens de mettre à exécution les décrets du 1er août. Aussitôt Goupilleau de Fontenay tira un papier de sa poche [34], c’était ma destitution, et me dit : Lisez, vous n’êtes plus rien ! je lus et je lui dis : Puisque je ne suis plus rien, je n’ai plus rien à faire ici. Je repris mon sabre et sortis en les saluant de ces mots : Vous croyez m’avoir donné un brevet de jeanfoutre, ce sera un brevet d’honneur de plus… et je descendis les escaliers.
Je rencontrai le général Tuncq sur la porte et je lui dis : Je présume qu’on va faire fusiller le hussard d’ordonnance qui m’annonçait… ce n’est point sa faute : il n’a fait qu’exécuter mes ordres. Et je l’invitai à ne point se charger de cette barbarie. Tuncq me répondit que, sur ma réclamation, le hussard ne serait pas fusillé [35]. J’ignore ce qui s’est passé, mais j’atteste que j’ai entendu Bourdon de l’Oise donner, par deux fois, l’ordre d’exécution, au moment où j’entrais dans la chambre.
Je laissai le citoyen Bourbotte avec ses collègues ; pour moi, je partis sur-le-champ.
J’arrivai à deux lieues de Fontenay-le-Peuple, vers les deux heures du matin, en plein pays insurgé et sans ordonnance. Je ne fus cependant pas attaqué. Tous, nous avions résolu de vendre cher notre vie et de nous tuer plutôt que de tomber aux mains des Brigands. À la halte, arrive le citoyen Bourbotte qui me conte toute la scène de la Châtaigneraie entre lui et ses collègues – voyez à ce sujet son rapport la Convention nationale. – Goupilleau et Bourdon avaient dépêché un adjudant-général à nos trousses pour nous faire arrêter : il ne nous rejoignit que passé Fontenay.
Les autorités, sur ses instances, envoyèrent à l’auberge de relai un ordre à l’effet de ne point laisser sortir notre voiture. Le porteur du billet n’en savait pas davantage, et ce fut à moi-même qu’il s’adressa. Je vis à la lecture que l’on voulait nous faire arrêter ; et sans sourciller je répondis à l’estafette : Allez dire aux autorités que cela suffit. Bourbotte aussitôt prévenu, nous partîmes, en gens avisés, sans les attendre… et je crois que nous avons bien fait.
Quand nous passâmes à Saint-Maixent, l’ordre y était parvenu de faire rétrograder les chevaux de luxe appartenant à Biron qui avaient été réquisitionnés par nous, après une estimation légale. Bourbotte prit sur lui de les faire aller jusqu’à Tours, où étaient ses collègues. Il prit son arrêté sur le grand chemin [36] et le remit entre les mains de l’officier qui courait après nous ; celui-ci se trouva fort perplexe, sans savoir à quel ordre donner la préférence : il se décida cependant pour celui de Bourbotte, et les chevaux nous menèrent grand train jusqu’à Tours.
Bourbotte alla trouver ses collègues et leur conta ce qui s’était passé à la Châtaigneraie. Ils décidèrent que Bourbotte et moi nous nous rendrions sur-le-champ au Comité de salut public pour l’instruire de la conduite de Goupilleau de Fontenay et de Bourbon de l’Oise. Ceux-ci, sans perdre de temps, avaient envoyé ma destitution, par courrier extraordinaire, à la Convention nationale ; leur courrier avait trois heures d’avance sur nous, et quand nous arrivâmes, le soir, à Paris, on criait déjà dans les rues : « La grande destitution du général Rossignol – sa trahison ! » J’avoue que cela me fit beaucoup de peine.
Bourbotte me dit : « Va chez toi et sur les dix heures du soir trouve-toi au Comité de salut public. » Je m’y rendis à neuf heures : Bourbotte y était déjà. Je me fis annoncer et, après m’avoir entendu, le Comité décida que je repartirais sur-le-champ à mon poste. Je demandai à faire une réclamation ; on me donna la parole et je dis : Voilà le journal du soir où il est écrit que j’ai trahi mon pays. La France entière le sait aujourd’hui… Je désire que la France sache demain que j’en suis incapable. En conséquence, je demandai à aller moi-même à la barre de la Convention nationale. Tous les membres du Comité approuvèrent ma réflexion et il fut décidé que, séance tenante, je ferais parvenir une lettre au président. Le lendemain j’écrivais au président et ma lettre fut lue. Bourbotte monta à la tribune et dit toutes les vexations qu’il avait éprouvées de la part de ses collègues ainsi que ma destitution [37]. À l’unanimité un décret fut rendu qui me réintégrait dans mes fonctions et qui portait que je me rendrais à l’armée sur-le-champ. Un autre décret rappelait Bourdon de l’Oise et Goupilleau de Fontenay. Le congé accordé à Goupilleau de Montaigu était rapporté.
Alors je parus à la barre de la Convention : Vous venez de rendre justice à un vrai patriote… je ne vous dirai pas de belles phrases parce que je ne sais pas en faire… mais je jure de faire tous mes efforts pour en finir avec la horde des Brigands. Oui, je suis patriote et si je savais qu’un de mes cheveux ne le fût pas je me brûlerais la cervelle. – C’était quelque chose comme ça ; je ne me rappelle plus bien.
La réponse du président me fut un beau certificat. Il me dit que la Convention nationale savait apprécier le mérite des vrais défenseurs de la Patrie : « Vous êtes un des vainqueurs de la Bastille… retournez à votre poste… combattez les Brigands avec courage… La Convention vous invite aux honneurs de la séance. » J’entendis les acclamations de la Convention et les applaudissements des tribunes.
Le lendemain je partais pour l’armée.
CHAPITRE XXIV
Le conseil de Saumur. – Manœuvres et stratagèmes. – Un plan impossible – Avant toute question personnelle. – Les sentiments de l’armée de Mayence. – J’abandonne mon suffrage. – La marche tournante est décidée. – Philippeaux et les fournisseurs militaires. – Nos plans respectifs.
J’arrivai à Saumur où était le quartier général. – Santerre avait été nommé pour me remplacer provisoirement. L’armée de Mayence arrivait de jour en jour. – Tous les chefs des colonnes étaient au Conseil, onze représentants y délibéraient, et le citoyen Reubell présidait. On agita la question de savoir de quel côté marcherait l’armée de Mayence : ou du côté de Nantes ou directement de Saumur à Cholet… où étaient les Brigands en grand nombre. Ce fut une grande discussion. Tous ceux qui avaient fait la guerre de la Vendée tenaient pour que l’armée de Mayence allât directement de Saumur à Cholet, pour la simple raison que l’ennemi était à Cholet, distant de dix lieues, et que, de l’autre côté, il fallait faire cinquante lieues pour joindre Nantes inutilement ; de là, pour atteindre les Brigands, il fallait encore exiger de l’armée fatiguée une marche de vingt lieues en pays coupé [38].
J’observe que, le matin précédant le Conseil, une revue de ce qui était arrivé de l’armée de Mayence avait été passée par les représentants du peuple. Le général Canclaux y avait pris part avec Dubayet et Merlin de Thionville. Le bruit avait couru dans les rangs que ce serait le général Canclaux qui commanderait en chef, de manière que l’on criait : Vive le général Canclaux ! dans plusieurs bataillons.
Averti de ce petit stratagème, je n’en dis rien à personne et je me laissai le loisir d’en référer en temps et lieu. J’avais soumis au Conseil un projet d’attaque en masse : Canclaux en soumit un autre et, après bien des discussions, on fit un résumé des deux projets à être adopté.
On revint sur la question de savoir de quel côté se porterait l’armée de Mayence pour attaquer. Cette question étant mise aux voix, sur vingt-deux votants, onze furent pour la marche directe de Saumur à Cholet, l’autre moitié pencha pour Nantes.
Les généraux, à l’exception de Canclaux, étaient pour le chemin le plus court ; les représentants, au contraire, votèrent pour Nantes, à l’exception de Richard, Choudieu, Bourbotte. Le général Menou fit part au Conseil de ses réflexions et prouva la carte à la main combien ce dernier projet était mauvais. Santerre dit tout haut, en plein Conseil, qu’il n’y avait que des hommes n’aimant pas leur pays qui pouvaient présenter un tel plan d’attaque et que Dumouriez ne l’eût pas mieux rédigé. À ce moment, Philippeaux prit des notes. Les esprits s’échauffaient de part et d’autre, et, voyant combien les propos étaient personnels, je pris la parole : Il y a ici des ambitions, eh bien, je désire qu’elles cessent à l’instant ; je crois que notre seule ambition doit être de faire triompher les armées de la République. – Et directement je dis à Canclaux : Il ne faut pas de rivalité entre nous, nous devons être d’accord et en parfaite union. – Je proposai même au Conseil que le général Canclaux commandât en chef dès cet instant, et je dis que, s’il le fallait pour le bien du pays, je désirais servir sous ses ordres en qualité de général que je ne tenais point à mon grade [39] et peu m’importait que l’armée triomphât sous mes ordres plutôt que sous les ordres du général Canclaux ; il fallait, avant toute question personnelle, faire marcher l’armée par le chemin le plus court… et c’était par Saumur. – L’ennemi, je l’ai dit, n’était qu’à dix lieues de nous. – Canclaux ne voulut point accepter l’offre que je lui faisais ; le Conseil se leva jusqu’au lendemain après le pointage des voix divisées par moitié, et nous allâmes souper à onze heures du soir.
Cette nuit-là [40], je m’informai des sentiments de l’armée de Mayence et j’appris que leur homme était Canclaux. Quelques mots avaient été lancés à propos de moi ; on avait dit que le rossignol ne chantait qu’au printemps. Les officiers qui avaient déjà servi sous mes ordres répondirent que je savais me battre en tous temps. Il y eut à ce sujet des disputes et des rixes ; plusieurs personnes furent blessées et portées à l’hôpital. Ces faits m’ayant été confirmés par renseignements précis, je me consultai sur la conduite à tenir avec plusieurs personnes de confiance ; aucune ne voulut me dire sa façon de penser ; c’était, à leur avis, une affaire très délicate. Je passai la nuit à faire mes réflexions et, le lendemain, j’allai trouver les représentants du peuple. Je leur communiquai les disputes et les schismes qui existaient entre les deux armées et je dis que, pour éviter toute contestation, je m’étais résolu à abandonner mon suffrage au conseil de guerre. J’expliquai pourquoi : On a parcouru les rangs de l’armée de Mayence qui est acquise au général Canclaux ; avec toute la bonne volonté que vous me connaissez, il me sera impossible de gagner la confiance de cette armée ; en conséquence, je ne pourrai pas faire le bien de mon pays, car lorsqu’un général n’a pas la confiance du soldat avec les meilleures intentions il lui est impossible, d’arriver à rien. Les représentants ne me donnèrent aucun conseil et, à l’ouverture de la séance, j’abandonnai mon suffrage. J’avais compté sur leurs sentiments : ce fut une faute, car il fut décidé que l’armée marcherait par Nantes. Il m’a fallu faire ce sacrifice.
On fit entrer au Conseil les commissaires ordonnateurs, afin de prendre les mesures nécessaires à assurer la subsistance. D’abord Philippeaux assura qu’on ne manquerait de rien, que tout était prévu et préparé. Il y avait à Nantes, disait-il, de tout en abondance, vivres et munitions, et, pour appuyer ses paroles, il fit paraître au Conseil un riche négociant de Nantes, un millionnaire, qui s’était chargé de la fourniture des armées. Le fait est qu’après avoir entendu tant de belles paroles, je fus obligé de fournir toutes les subsistances. On peut consulter à ce sujet le rapport à la Convention de Richard et de Choudieu.
Aubert Dubayet dit en plein Conseil que si on ne lui délivrait pas trois cents fusils, il ne marcherait pas. Ce fut Ronsin qui lui fit observer que ce propos était indigne d’un général, qu’il ne fallait pas laisser égorger l’armée républicaine parce qu’on manquait de trois cents fusils et de deux pièces de canon ; pour moi je lui dis : Écoutez, général, vous trouverez tout ce qu’il vous faut à Nantes. Ils ne trouvèrent rien ; je fus obligé de leur faire passer vivres, fusils, canons, souliers, etc. On signa enfin l’arrêté du Conseil de guerre et chacun s’en retourna à son poste. Cet arrêté portait en substance que les colonnes feraient leur jonction et marcheraient ensemble. Les dates étaient indiquées. Le 18 septembre toutes les colonnes (après le mouvement tournant) devaient se trouver réunies devant Cholet.
Le plan que j’avais soumis n’était pas celui-là. Je voulais bien que toutes les colonnes fussent mises en mouvement et se tinssent serrées le plus possible, mais je disais que celle des Sables ferait sa jonction avec celles de Fontenay et Niort commandées par général Chalbos, celle d’Angers avec celle de Nantes en bloquant l’ennemi. À mon avis, l’armée de Mayence devait attaquer les Brigands en marchant droit de Saumur sur Cholet ; elle commençait l’attaque, puisque c’était la meilleure troupe. Suivant cette tactique, les Brigands n’avaient que deux ressources, c’était de nous repousser fortement et de marcher sur la seconde ligne qui aurait été établie, ou bien de rétrograder jusque sur le bord de la mer qui était leur dernier refuge. On a vu que, malgré tous nos efforts, le plan de Canclaux prévalut, et l’exécution en fut tentée [41].
CHAPITRE XXV
La position de l’ennemi. – Des avantages. – Je suis blessé. – Santerre compromet la colonne. – Le silence du général Canclaux. – La retraite sur Nantes. – Mouvement dans l’armée. – Léchelle me remplace. – Les soldats demandaient Canclaux. – Les Brigands passent la Loire. – J’improvise une petite armée. – Toujours sans nouvelles. – Marche et contremarche.
Les colonnes devaient donc se trouver réunies le 18 devant Cholet. Pour cela, il fallait vaincre de nombreux obstacles et l’ennemi, se trouvant placé au centre de nos opérations, bien servi comme il l’était en espions, pouvait facilement se porter sur la colonne qu’il désirait attaquer, ce qu’il fit du reste quelquefois avec avantage. Deux fois, les rebelles voulurent attaquer Doué [42], ils furent battus à plate couture. Ce fut à cette époque que je fus blessé et obligé de quitter le champ de bataille malgré moi. Le 16 septembre, l’armée était à Coron. Santerre commandait la colonne, mais, à la suite d’une mauvaise manœuvre, il fut obligé de se reployer, après avoir perdu plusieurs bouches à feu. Une ordonnance vint m’avertir de cette déroute ; je donnai l’ordre au général Salomon de partir pour Doué et de prendre avec lui quatre bataillons, afin de rallier la troupe, avec ordre de ne point la laisser entrer dans la ville et de camper. Les ordres et les bataillons arrivèrent assez à temps pour empêcher une plus grande déroute. J’avoue que j’en ai pleuré de colère, mais j’étais au lit, extrêmement malade.
J’observe que je ne recevais aucune nouvelle du général Canclaux ; aucune correspondance n’était établie ; je lui envoyais tous les jours un courrier extraordinaire et lui ne me répondait que par la poste ; j’étais trois ou quatre jours sans avoir de ses nouvelles ; je restai donc sur la défensive. Dans la première lettre que je reçus de lui, il me demandait où était l’ennemi, que lui ne pouvait le trouver. Il avait bien raison : l’ennemi ne pouvait être sur lui, puisqu’il était toujours sur nous. Cependant, par la résistance que fit ma colonne, elle força l’ennemi à marcher sur la colonne de Mayence.
Notre armée eut quelques succès à plusieurs reprises, mais cela ne fut pas de longue durée, puisque Canclaux se vit tourner par l’ennemi et contraint de se faire un chemin pour la retraite sur Nantes.
Après cet échec, il y eut un grand mouvement dans l’armée ; toutes les colonnes restèrent sur la défensive pendant quelques jours ; beaucoup de généraux furent rappelés, beaucoup d’autres destitués.
Ce fut à cette époque [43] que je fus remplacé par le général Léchelle, que j’avais placé à La Rochelle dans les circonstances suivantes : j’avais été avisé que ce port très important devait être livré aux ennemis et j’avais reçu l’ordre d’y placer un bon général qui fût en même temps bon républicain ; en conséquence, j’y envoyai le général Léchelle, qui déjoua la conspiration prête à livrer la ville aux forces ennemies.
Canclaux, Santerre, Dubayet, Rey, Mieszkwoski, Menou, Duhoux, etc., se retirèrent de l’armée. J’eus l’ordre de les remplacer par d’autres chefs nommés par le Conseil exécutif et approuvés par le Comité de salut public. Le général Beysser avait été arrêté quelques jours auparavant et ramené à Paris. Je plaçai les nouveaux généraux à chaque tête de colonne et, d’après mes instructions, plusieurs victoires furent remportées par nos armées sur plusieurs points.
Léchelle vint de La Rochelle pour me remplacer. Les représentants du peuple Prieur (de la Côte-d’Or) et Kunt étaient à Saumur et l’attendaient pour se concerter avec lui. J’eus le plaisir de communiquer avec eux ; je leur fis voir la disposition et la marche que tenait chaque colonne. Ils me parurent satisfaits des mesures que j’avais prises. Le général arriva ; je lui exposai l’état des forces qu’il allait commander. Il partit le lendemain pour Nantes avec les représentants Prieur (de la Côte-d’Or) et Kunt. L’armée de Mayence était ressortie de Nantes depuis quelques jours, et ce fut le représentant Carrier qui fit reconnaître Léchelle pour général en chef. Il y eut à ce sujet beaucoup de mécontentement dans l’armée de Mayence. Les soldats demandaient Canclaux et Dubayet ; ils disaient qu’autrement ils n’obéiraient point au général Léchelle. Les représentants du peuple ramenèrent cependant l’ordre, mais ce ne fut pas sans peine. J’arrivai à Nantes et j’allai trouver Canclaux que je remplaçais dans l’armée des côtes de Brest ; il avait reçu sa destitution et il m’attendait. Je pris tous les renseignements qui m’étaient nécessaires et je partis pour Brest.
Les représentants du peuple Jeanbon-Saint-André et Prieur de la Marne étaient dans cette ville ; je me fis connaître à eux et je leur dis que je venais visiter tous les forts ainsi que tous les postes. Je trouvai les travaux de défense en bon état. Au cours de ma tournée dans le département, je fis construire plusieurs batteries sur des points importants. Bientôt un courrier extraordinaire m’apprenait que l’armée de Mayence avait tellement poussé les Brigands qu’ils avaient été forcés de passer la Loire. Ce fut alors que je me dis : Ils ne veulent donc plus me quitter…
Je n’avais dans la circonstance aucune troupe disponible. Je ne pouvais point dégarnir les côtes qui étaient essentielles à garder ; alors je fis rassembler tous les citoyens dans les communes où je passais et les engageais à venir se concentrer à Rennes ; plusieurs communes fournirent ainsi leur contingent de braves à la défense de la patrie. En deux jours, je trouvai dans ces petites communes près de deux mille hommes sur ma réquisition ; je ne pris que les individus en état de porter les armes. À Rennes, je fis rassembler tous les citoyens et, comme les Brigands venaient de remporter une victoire à Laval, je me mis en marche, sans attendre, avec la petite armée que j’avais improvisée. Nous n’étions que deux mille hommes. Le représentant du peuple Pocholle marcha à la tête de sa colonne. Cette marche ne tendait qu’à soutenir notre armée et à lui servir en cas de besoin. J’observe que, dans ce moment, je n’avais près de moi ni généraux, ni même un chef d’état-major.
Depuis quatre jours, j’étais sans nouvelles de l’armée de Mayence ; je ne savais pas même sur quel point s’était portée la retraite. J’avais marché du côté de Craon et, après le troisième jour de marche, j’appris que l’armée s’était dirigée sur Angers et que le général Boucret, avec quatre mille hommes, avait opéré sa retraite sur Rennes. Ainsi je marchais d’un côté et les troupes républicaines se retiraient de l’autre. Je me trouvais au milieu des Brigands et ne m’en suis retiré que par des chemins de traverse, en passant par Vitré.
Le deuxième jour de notre contremarche, j’appris qu’une colonne ennemie forte de vingt mille hommes s’avançait sur nous. L’avertissement nous vint assez à temps pour permettre la retraite. À Vitré, je laissai huit cents hommes pour renforcer la garnison, ce qui pouvait porter le nombre des citoyens armés à douze cents. Trop faibles pour résister en cas d’attaque, ils avaient ordre de ne point tenir et de se reployer sur Rennes, mais leur poste ne fut point attaqué.
CHAPITRE XXVI
À Rennes. – Sous la surveillance du département. – La ville en état de siège. – Foi de républicain ! – Les Brigands se reploient. – Mes brigades franches. – Plusieurs combats avantageux. – Un renfort d’émigrés. – Pour les prendre au piège.
L’ennemi avait changé sa marche et se dirigeait sur Rennes.
De retour dans cette ville, je fis travailler jour et nuit aux retranchements et aux batteries ; mais par la mauvaise position du pays, il y avait impossibilité de tenir longtemps. Je présumais alors que l’ennemi ne marchait sur Rennes que pour avoir des munitions, et, à la vérité, il y en avait. Les membres du département avaient une telle peur qu’ils tendaient presque les bras aux Brigands. Ils m’avaient mis en état d’arrestation et les représentants du peuple étaient sous leur surveillance. Je leur dis que je ne pouvais travailler à la défense de la ville, puisque j’étais en arrestation et que la Convention nationale serait instruite de leurs manœuvres. Un patriote, c’était le directeur de la poste appelé Blain, leur représenta le danger qu’ils couraient en me retenant prisonnier et s’offrit lui-même, avec plusieurs de ses concitoyens, à partir à cheval, afin de reconnaître la marche de l’ennemi. Alors, le département me renvoya à mes fonctions. Dans la nuit même, je fis sortir la cavalerie avec ordre de faire des patrouilles sur tous les chemins à distance de quatre lieues. Le citoyen Blain vint m’avertir que l’ennemi n’était plus qu’à dix lieues. Je fis doubler les travaux, et je puis attester que les citoyens de Rennes s’y sont assez bien prêtés.
Les représentants du peuple Bourbotte, Prieur, de la Marne, Esnuë-Lavallée arrivèrent à Rennes. Je ne voulus pas être sous la surveillance du département et ils déclarèrent la ville en état de siège. Je fis évacuer tout l’arsenal, toutes les subsistances sur la route de Nantes. Les aristocrates criaient que l’on voulait livrer la ville. Je fis mettre tous les flambeaux en réquisition. L’ennemi vint jusqu’à deux lieues. Toutes les positions étaient prises et les troupes bivouaquaient derrière leurs retranchements.
On murmurait toujours dans la ville à propos des subsistances. Les riches de l’endroit s’étaient rassemblés et tâchaient d’égarer la troupe. Alors je fis battre la générale et devant les habitants assemblés sur la place en bataillon, je dis : Je sais qu’il existe dans la ville des hommes pervers ; il y en a parmi vous qui tendent les bras aux Brigands ; mais je vous jure, foi de républicain, que si vous ne soutenez pas la troupe de ligne de tous vos efforts, les Brigands n’entreront dans la ville de Rennes que sur des cendres, car je suis résolu à y mettre le feu. Aussitôt la garde nationale me dit d’une voix unanime : « Général, nous nous battrons jusqu’à la mort et nous périrons sous nos murs. Nous demandons le poste le plus périlleux. » Je leur dis : Mes camarades, soyez persuadés que je ne vous abandonnerai pas et que je mourrai, s’il le faut, au milieu de vous [44]. Alors je marchai à leur tête et leur fixai un poste d’avancée ; je puis dire à leur louange qu’ils s’y sont bien comportés.
Je fis sortir la cavalerie le matin sur plusieurs points : il n’y eut que quelques petites tentatives de la part des Brigands, car, lorsqu’ils apprirent que la ville était vide de munitions et de subsistances, ils se reployèrent sur Laval. J’avais employé des citoyens de Rennes pour savoir la marche de l’ennemi ; ils se sont acquittés de leur mission avec un zèle extraordinaire. J’étais si bien servi par ces braves gens-là que l’ennemi ne faisait pas un pas qui ne me fût aussitôt connu. Aussi les récompensai-je très bien.
J’observe qu’à cette époque l’armée de l’Ouest était à Rennes et que Léchelle était malade, et que c’était moi qui commandais les deux armées réunies.
L’ennemi fit plusieurs marches différentes, toujours poursuivi par nos troupes et presque toujours battu. À Dinan, seulement, ils remportèrent quelque avantage à la suite d’une fausse attaque que le général Tribout commanda sans m’avertir. J’avais reçu un ordre du Comité du salut public qui m’ordonnait de faire couper les ponts derrière les Brigands, afin d’empêcher leur retraite. L’ordre fut exécuté de point en point, ce qui les gênait beaucoup dans leur marche. J’avais formé des brigades de tirailleurs pour faire la guerre de partisans : l’une était commandée par le général Marigny et l’autre par le général Westermann. Ces deux brigades ne cessaient de poursuivre l’ennemi et continuellement l’inquiétaient, tant sur le flanc qu’en tête des colonnes.
Plusieurs combats ont été livrés à cette époque et tous avantageux pour la République. Granville fut attaqué, mais les Brigands y furent mal reçus. Toutes les troupes de ligne et les citoyens se battirent avec un courage vraiment héroïque et l’ennemi fut obligé de se reployer avec une perte considérable.
À cette époque, on trouva sur un brigand, qui avait été tué, une correspondance où la venue d’un renfort d’émigrés était annoncée [45]. En partant de Jersey et de Guernesey avec beaucoup de munitions, ils devaient débarquer à Cancale. Le représentant du peuple Laplanche arrivait alors à la tête de l’armée des côtes de Cherbourg. Nous cherchâmes, d’accord ensemble, à les prendre dans leur propre piège. Je fis partir de Rennes trois mille hommes en poste avec quatre compagnies de canonniers, et le citoyen Laplanche et moi, nous nous rendîmes à Port-Malo pour cette affaire très importante. Je fis embusquer des bataillons, je fis construire des retranchements, je fis tirer par les forts les coups de canon indiqués dans la correspondance ; je fis faire des évolutions militaires à poudre dans le pays ; pendant deux jours de suite le feu fut continué ; et nous avions convenu qu’aussitôt l’ennemi en vue, on ferait amener sur plusieurs points le drapeau blanc, afin de donner à connaître que l’armée royaliste était maîtresse de la contrée.
Le deuxième jour, nous vîmes bien paraître quelques corvettes anglaises venant à la découverte ; nous dévions les laisser approcher et même effectuer leur descente ; nous avions résolu de faire paraître aussi, sur les points élevés où le drapeau blanc serait hissé, beaucoup de laboureurs et de femmes pour mieux les tromper ; mais nous fûmes vendus sans doute par un millionnaire de Saint-Malo, qui était bien en état d’arrestation, mais que ses deux gardiens laissèrent échapper la nuit. Cet individu s’appelait Granclaux-Mêlée. Il était cependant défendu à tout navire et bateau de pêche, et même aux barques, de sortir d’aucun endroit jusqu’à nouvel ordre ; j’avais placé dans chaque navire un républicain pour garde. Cela n’empêcha pas Granclaux-Mêlée d’aller à Guernesey, comme je l’ai appris depuis, et sans doute ce fut lui qui prévint les Anglais de notre feinte. Ils vinrent en reconnaissance et croisèrent, mais le soir ils se retirèrent et notre plan tomba dans l’eau. Je restai encore quatre jours entiers pour voir s’ils n’accompliraient pas leur projet, et puis je fus obligé de refaire marcher les colonnes sur les Brigands.
CHAPITRE XXVII
À Antrain. – Fausse attaque de Westermann. – Terreur panique dans la division de Kléber. – Débandade générale. – Sans brûler une amorce. – Marceau et moi nous ramenons les pièces. – Ma démission refusée. – Général en chef des armées réunies. – Le siège d’Angers. – La fin des Brigands. – L’interrogatoire de Talmont.
L’ennemi restait à Dol ; toutes les colonnes étaient dessus, et c’était un avantage pour nous qu’il y séjournât. Westermann était là avec une colonne de six mille hommes ; Marceau était à la tête de l’avant-garde avec une autre colonne de même force ; j’étais à Antrain avec dix mille hommes placés avantageusement. Les représentants Prieur de la Marne, Turreau et Bourbotte étaient avec moi au bivouac. L’ordre était d’attaquer à la pointe du jour. Le général Westermann devait commencer à trois heures du matin, mais, toujours fougueux, il n’écouta que sa tête et attaqua dès minuit, malgré moi [46]. Il entra dans Dol avec sa cavalerie, tua beaucoup de Brigands, mais… il fut forcé de se reployer. L’ennemi lui tomba tellement dessus qu’il le mit totalement en déroute.
Marceau fut attaqué dès la pointe du jour et fut obligé, après quelques avantages, de se reployer, parce que, sans cela, il aurait été tourné. Je m’aperçus de l’attaque et je fis marquer la première colonne commandée par le général divisionnaire Kléber. Une terreur panique se mit dans cette division qui battait en retraite lorsque j’avançai avec la seconde ligne pour la soutenir. Je fis déployer mes hommes, afin de rallier la première colonne, mais ils prirent la fuite et, malgré tous les efforts des représentants du peuple et des généraux, il ne fut pas possible de leur faire voir l’ennemi. J’avais laissé une colonne de quatre mille hommes à un passage de défilé qui devait nous garder une retraite ; eh bien ! chose inconcevable, elle se mit en déroute aussitôt qu’elle nous aperçut. Ce fut alors que je m’emportai contre les soldats : Vous direz que les représentants et les généraux vous trahissent et vous fuyez sans voir l’ennemi et sans avoir tiré un seul coup de fusil [47]. Je puis attester qu’il n’y eut qu’un bataillon qui protégea la retraite jusqu’à Antrain. Les représentants du peuple et moi, nous fîmes tous nos efforts sur les soldats pour les tenir à ce poste ; malgré tous nos efforts il fut impossible de les arrêter. J’avais fait placer au pont deux pièces de huit avec deux compagnies de grenadiers et un bataillon de bonne troupe. L’ennemi tira plusieurs coups de canon dans Antrain qui ne blessèrent personne ; cependant nos soldats abandonnèrent les pièces et se sauvèrent au premier coup de canon. Je parvins à faire ramener les deux pièces par quelques canonniers qui se trouvèrent dans Antrain. Marceau et moi, nous fûmes les chercher. Je puis attester que dans toute cette affaire nous n’avons pas eu huit hommes de blessés. Nous en perdîmes deux de la colonne du général Marceau qui avait vu l’ennemi. J’établis un cordon de cavalerie pour rallier la troupe à cinq lieues d’Antrain ; il m’avait été impossible de l’établir auparavant. Le soir, toutes les troupes en ordre rentraient dans Rennes.
Je demandai un Conseil de guerre.
Jeanbon était arrivé de Brest à Rennes. Il y avait à ce Conseil six représentants du peuple et tous les généraux de l’armée. Je pris la parole et je leur dis : Il est incroyable que le jour qui devait voir la mort des Brigands soit devenu un jour de victoire pour eux, parce que les ordres que j’avais donnés n’ont point été exécutés. Je m’aperçois qu’il y a rivalité entre quelques généraux et je prie les représentants d’accepter ma démission. Je présume que c’est l’ambition qui domine et sans doute quelques-uns ne veulent pas que ce soit sous mes ordres que l’on remporte une si belle victoire… Eh bien, je ne tiens pas à mon grade, si je suis sûr que, aussitôt que je ne serai plus général en chef, l’armée républicaine triomphera le lendemain des Brigands. »
Les représentants du peuple ne voulurent pas accepter, et l’on fit tomber ma motion [48], en entamant d’autres propositions.
Je fus nommé général en chef des trois armées réunies de Brest, l’Ouest et Cherbourg [49].
Dans la mauvaise journée dont j’ai parlé, l’ennemi n’a pas eu une seule de nos cartouches et pas une pièce de canon, car j’avais eu soin, avant de faire marcher les hommes, de les munir personnellement de munitions et la cavalerie se tenait prête à leur en porter de nouvelles, mais les caissons de cartouches n’étaient qu’à une certaine distance de l’attaque qui devait être faite. Dans le conseil de guerre, qui avait été précédemment tenu à Rennes, j’avais fait arrêter qu’il n’y aurait par division qu’une pièce de huit et un obusier ; c’était une mesure de circonstance très urgente, car souvent les Brigands n’ont eu des munitions de nous que parce que chaque bataillon avait ses deux pièces de campagne, ce qui devenait très nuisible, surtout dans les chemins couverts… et, depuis cet arrêté, les Brigands n’ont plus eu nos munitions.
L’ennemi marcha sur Angers et l’attaqua pendant deux jours. Averti de sa marche, j’avais dépêché deux bataillons pour renforcer la garnison. Ils arrivèrent assez à temps [50]. Je les suivais avec le gros de la colonne. Des troupes de Cherbourg étaient arrivées à Rennes et notre marche en fut retardée d’une demi-journée.
Les ordres étaient donnés pour couper tous les ponts qui pouvaient faciliter le passage et servir la retraite des Brigands, j’avais donné ordre au général Westermann de marcher sur Angers avec toute sa cavalerie. Le général Marigny inquiétait le flanc de l’ennemi avec une brigade de quatre mille hommes et deux cents chevaux. En même temps que cette colonne volante, j’arrivai à Angers deux jours après notre départ. Je fis cette journée-là quinze lieues et j’arrivai au moment où les Brigands levaient le siège. Les colonnes furent obligées de marcher jour et nuit [51]. Le lendemain matin, je donnai ordre au général Westermann de faire une sortie, à huit heures, sur l’ennemi ; il ne la fit qu’à trois heures après-midi. Que l’on voie le rapport de Hentz, représentant du peuple, à ce sujet. Cette sortie fut très avantageuse pour nous, mais elle l’aurait été davantage si Westermann était parti à l’heure indiquée [52].
La garnison et les citoyens et citoyennes d’Angers se sont conduits pendant tout le siège en vrais républicains et républicaines [53]. Les femmes et les enfants portaient des cartouches et des vivres aux braves volontaires et gardes nationales sur les remparts. Plusieurs de ces braves gens y furent tués [54].
J’avais des craintes que l’ennemi ne marchât sur Tours. Je fis sortir une brigade pour garder la levée. L’armée se porta sur plusieurs points différents, mais à distance de secours les uns des autres.
Après toutes les dispositions prises, je reçus ordre de remettre le commandement au général Turreau et, en son absence, au général divisionnaire Marceau. J’avais mission de me porter dans le Morbihan, où le pays était en contre-révolution. Je fis aussitôt marcher des troupes dessus, ce qui fit rentrer les rebelles dans l’ordre.
Tout le monde sait les victoires qui ont été remportées à la Flèche et au Mans le jour de mon départ.
J’avais à ma disposition quelques bonnes troupes que je faisais marcher sur les points que je croyais essentiels [55] et j’avais donné l’ordre de couler à fond tous les bateaux qui étaient sur la rivière, afin qu’aucun bateau ne pût échapper à la poursuite de nos armées républicaines, et, après la bataille du Mans, les ennemis n’ont plus eu aucune consistance et n’ont pu même se rallier : aussi il en a péri beaucoup [56]. Leur armée était en pleine déroute ; plusieurs de leurs chefs furent tués ; d’autres passèrent la Loire et rentrèrent dans la Vendée, tels que Stofllet et quelques autres. Le prince Talmont fut pris en Bretagne [57] et fut emmené à Rennes au quartier général devant le représentant du peuple ; de là, il fut envoyé à la Commission pour être jugé comme chef des rebelles ; il fut condamné. J’ai eu avec lui une conversation très chaude que j’ai fait imprimer avec mes demandes et ses réponses, et il est vrai qu’il me dit en présence de témoins que j’étais le seul avec lequel il n’avait pas eu de correspondance [58].
Les Brigands détruits, je n’avais plus qu’un petit parti de chouannerie à détruire. Ils étaient au nombre de huit cents. Je fis marcher des troupes dessus. Le général Kléber se chargea, par mon ordre, de cette expédition et s’en acquitta fort bien.
Je partis pour visiter les côtes de Bretagne.
CHAPITRE XXVIII
Je prépare une descente sur les îles anglaises. – Ruamps et Billaud-Varennes à Port-Malo. – Leur susceptibilité et leur tyrannie. – Comment ils traitèrent un de mes hommes. – L’embarquement est contremandé. – À la poursuite des chouans. – Ma destitution. – Je me retire à Orléans. – Mon arrestation provisoire à Paris.
J’étais à Lorient, lorsqu’un courrier extraordinaire m’arriva. Je devais sans tarder me rendre à Port-Malo. J’avais avec moi le brave général Dembarrère, divisionnaire et chef du génie. Je me rendis à Rennes et j’emmenai avec moi tout mon état-major. Arrivé à Port-Malo, je me concertai avec Dembarrère pour une expédition qui devait être tenue secrète. Il s’agissait de faire une descente sur les îles de Jersey et Guernesey. Je n’avais que dix-sept jours pour tout délai.
Je n’avais pas quatre mille hommes de disponibles, et il me fallait en trouver trente mille pour l’expédition. Un arrêté du Comité de salut public que j’avais entre les mains m’autorisait à prendre des hommes dans l’armée de l’Ouest et dans celle de Cherbourg. Je fis mon travail en conséquence et de telle manière que toutes mes troupes étaient prêtes, toute l’artillerie embarquée ; il n’y avait plus que les chevaux à mettre dans les bâtiments de transport.
Les représentants du peuple Billaud-Varennes et Ruamps étaient à la tête des divisions pour opérer la descente. Le général Dembarrère, mon chef d’état-major, le citoyen Hazard (les seuls à qui j’avais communiqué le projet) et moi, nous avons travaillé à faire séparément les ordres nécessaires pour chaque général de division, d’après les plans levés sous l’ancien régime et d’après les renseignements que nous eûmes de plusieurs marins questionnés à ce sujet.
Nous avions de si bons renseignements que l’on présumait la descente et la réussite comme certaines. Je ne peux apprécier ce qui a empêché cette descente d’avoir lieu, mais voici un fait que je ne dois pas laisser caché :
Le représentant Ruamps arriva le premier pour cette mission secrète à Port–Malo. J’étais instruit par le Comité de salut public de ne communiquer mes ordres à qui que ce soit, pas même aux représentants en mission. Je ne devais communiquer qu’avec deux représentants porteurs de pareils arrêtés émanés du Comité de salut public. J’appris qu’un représentant du peuple était arrivé dans la nuit incognito. Le lendemain, jour de décadi, il fut en costume au temple de la Raison ; je m’y trouvai avec mon état-major ; je m’approchai de lui et lui demandai son adresse : il me la donna. Je lui demandai à quelle heure je pourrais le voir : il s’engagea pour six heures. Au lieu et à l’heure dite, je vins avec mon chef d’état-major. Après plusieurs propos de politesse, il me demanda si je n’étais pas chargé d’une expédition secrète. Je lui dis que oui. Il me demanda encore quelles mesures j’avais déjà prises à ce sujet. – D’après mes instructions, lui dis-je, je ne peux les communiquer qu’aux porteurs d’un arrêté pareil au mien. Il me répondit qu’il en était chargé par le Comité de salut public, et il me fit voir ses pouvoirs. Aussitôt j’entrai en matière sur cet objet et lui fis part des ordres que j’avais donnés. Il me parut satisfait de mes réponses.
Billaud-Varennes arriva. Le lendemain, je fus lui rendre visite ; il logeait avec son collègue. La première fois il me reçut assez bien il me connaissait comme membre de la commune du Dix-Août. Je leur dis que je viendrais tous les jours leur rendre compte de mes opérations ; mais je tombai malade ; il me fut impossible de mettre un pied devant l’autre ; je fus contraint de garder le lit ; je me mis entre les mains d’un chirurgien qui me guérit radicalement en dix-sept jours de temps. Tous les jours j’avais soin d’envoyer chez eux mon chef d’état-major.
On commença à me chercher querelle, d’abord sur ma maladie, qui n’était autre chose que la suite des fatigues que j’avais éprouvées dans la Vendée, maladie à laquelle pas un des représentants du peuple qui firent la guerre dans ces contrées n’a pu se soustraire.
J’avais placé un général pour commander à Port-Malo : je ne pouvais me mêler du service de la place. Les représentants étant en promenade, la troupe de chaque poste n’était pas sortie pour leur rendre les honneurs dus à la représentation nationale ; ils m’écrivirent une lettre à ce sujet : elle était pleine d’amertume ; j’y répondis comme je le devais. Je fis venir le commandant de place, lui renouvelai sa consigne et le réprimandai ; il me dit que les représentants qui étaient précédemment venus à Port-Malo ne voulaient pas que la troupe se mît sous les armes à leur sujet, et que le Carpentier, qui y était alors, l’avait lui-même défendu ; malgré cette explication, j’exigeai que l’on rendît les honneurs à la représentation nationale et l’ordre fut exécuté de point en point.
Tous les jours je recevais les ordres très sévèrement écrits de mes deux représentants. Cela me semblait bien dur. C’était à l’époque que l’on faisait le procès à Danton, Camille, etc. Ronsin et Vincent avaient été mis en état d’arrestation pendant quelques jours et rendus à la liberté : j’appris ces faits par les papiers publics.
Je commençais à rétablir ma santé et je fus leur rendre ma visite. Ils me reçurent avec un air gouvernant et de hauteur où je vis le dessein qu’ils avaient de m’attaquer.
Un de mes courriers, père de quatre enfants et homme de la Révolution depuis 89, fut arrêté sur leurs instructions, ils lui firent subir un interrogatoire visant un soi-disant propos tenu dans un café, pour savoir s’il avait soutenu que l’embarquement n’aurait pas lieu. Il répondit qu’il ne savait pas ce qu’on lui demanderait et qu’il n’avait rien dit de ces affaires-là qui n’étaient pas de sa portée. Il fut mis au secret et j’en fus averti par un de ses camarades, courrier comme lui.
Je fus de suite chez eux et je réclamai mon courrier. J’attestai son civisme et sa bravoure : des quatre qui m’étaient attachés, c’était celui dans lequel j’avais le plus de confiance ; il m’avait donné des preuves de son intrépidité à faire son devoir, maintes fois ; je leur rappelai les dangers qu’il avait courus, qu’il avait été blessé plusieurs fois par les Brigands en portant des dépêches, et ce fait, entre autres, que, se voyant près de tomber entre les mains des Brigands, il descendit de cheval, se jeta dans un bois, cacha les ordres dont il était porteur (qu’il alla rechercher un mois après) et réussit à leur échapper bien qu’ils eussent tué son cheval. À coup sûr un homme de ce genre ne pouvait être qu’un bon citoyen. Cependant je leur dis que, s’il s’était permis quelque autre crime, j’étais le premier à demander son jugement, mais que je l’en croyais incapable. Ne pouvant obtenir sa liberté, je m’en fus après avoir essuyé toutes sortes de vexations de leur part. Le lendemain de ma réclamation ils firent venir le courrier et ils lui dirent qu’ils savaient bien que c’était moi qui lui avais dit de répandre le bruit que l’embarquement n’aurait pas lieu. Il répondit qu’il ne m’avait pas vu, qu’il arrivait de Paris et qu’il avait remis ses dépêches du chef d’état-major. Il leur soutint qu’il n’avait pas tenu le propos qu’on lui reprochait. Ils le menacèrent de le faire fusiller et lui donnèrent vingt-quatre heures pour se résoudre. On l’emmena. Le lendemain, devant eux, il tint encore le même langage. Enfin, se voyant près d’être fusillé, il se mit à genoux et leur dit : « Vous pouvez me tuer, mais je ne peux pas vous dire ce qui n’est pas. » Il resta à genoux, et pleurant sa femme et ses enfants, il demandait grâce. Ils le renvoyèrent en prison et le lendemain le commandant temporaire de la place recevait l’ordre de le faire transférer au Tribunal révolutionnaire de Paris, avec leur arrêté que j’ai vu. Il fut lié et garrotté tout le long du chemin ; conduit à la prison du Luxembourg, il y resta six mois et manqua bien des fois d’être compris dans les complots des prisons, complots qui n’ont jamais existé. Il sortit un mois après le 10 Thermidor. Avant d’être courrier, il était maréchal des logis de la compagnie des canonniers de la 35e division de gendarmerie et vainqueur de la Bastille. – Ce trait m’annonça quelque menée sourde contre moi. Je fus le lendemain chez eux avec tous les généraux : ils tinrent plusieurs propos, disant que tous les grands conspirateurs n’étaient pas encore frappés, mais qu’ils ne tarderaient pas à être découverts. D’abord je ne pris pas cela pour moi, parce que j’étais sûr de ne pas avoir trahi mon pays. Pendant plusieurs jours j’allai leur rendre compte de mes opérations, mais à contrecœur, car je les voyais tous les deux en véritables despotes : chaque jour c’était de nouvelles vexations ; ils ne me parlaient que de guillotine, et dans leurs propos ils disaient qu’il ne fallait plus de ces hommes à révolution, qu’il fallait les faire périr, qu’ils savaient qu’en ce moment on était à la recherche d’une grande conspiration, que plusieurs étaient déjà en prison, Ronsin, Vincent, Hébert, Momoro, etc., que leur clique ne tarderait pas d’être attrapée. – Je vis bien qu’ils disaient tout cela pour moi. Lassé d’entendre de tels propos, je leur dis que je n’en croyais rien, que ma conduite était irréprochable, que je ne connaissais aucune conspiration, que d’ailleurs je n’écrivais à personne, que j’avais assez d’occupations sans me mêler d’entretenir des correspondances particulières et que je défiais que l’on pût trouver une lettre de moi ailleurs qu’au Comité de salut public et chez le ministre, parce que c’était mon devoir.
Ils me parlaient si souvent de guillotine que cela me dégoûtait… Enfin, chaque jour, ils me tenaient des propos atroces ; ils buvaient à la santé de la République et des membres du Comité de salut public et finissaient par dire : « Tous les coquins ne sont pas encore arrêtés… il y en a encore un qui n’est pas loin d’ici… » – C’était moi qu’ils désignaient, puisque tous les autres avaient le verre à la main. – Tous les autres généraux étaient bien reçus ; plusieurs mangeaient et buvaient avec eux ; il n’y avait que moi qu’ils ne pouvaient souffrir.
Enfin, après huit jours de scènes toujours plus fortes les unes que les autres, je fus les trouver après leur dîner qui ne se faisait qu’à cinq heures du soir. Ils en étaient au dessert, et même ils avaient pris leur café et liqueurs. Sitôt qu’ils me virent entrer, Ruamps dit qu’il fallait redoubler et boire à la santé de sainte Guillotine, qui venait de faire une belle opération : c’était le jour de Danton, etc. Il ajouta que le tour des autres ne serait pas long à venir. Après qu’ils m’eurent vexé, je leur demandai une audience particulière. J’avais eu soin de me défaire de mes armes et même d’ôter mon couteau de ma poche, car je voyais qu’ils étaient sur le point de dire que je venais pour les assassiner. Ils me répondirent que si c’était pour affaire de service, ils voulaient bien m’entendre, mais que, si c’était affaire particulière, je pouvais parler, qu’il n’y avait personne de trop.
Alors je leur dis : Citoyens, depuis votre arrivée, je n’ai cessé d’être vexé par plusieurs propos de votre part, qui tendent à m’attaquer sur mon patriotisme ; vous cherchez à me faire perdre la confiance de l’armée que j’ai su gagner par ma bravoure et mon caractère sociable ; je m’aperçois que j’ai perdu votre confiance, je viens déposer entre vos mains ma démission ; sans doute que des faux rapports auxquels vous avez ajouté foi m’ont rendu coupable à vos yeux ; je suis en ce moment élevé à un grade supérieur et ce grade exige qu’il n’y ait aucun doute sur ma conduite. Cependant je défie mes calomniateurs d’articuler un fait qui puisse attaquer mon civisme et ma probité… et, puisqu’il faut parler franchement, je vous somme de faire paraître devant moi mes calomniateurs.
Ruamps me répondit d’un ton impérieux de n’élever pas tant la voix. À la vérité, j’étais en colère et je lui dis que c’était ma manière de parler. Savez-vous, reprit-il, que j’ai fait fusiller tout l’état-major d’une armée. – Je sais que j’ai été souvent au feu et que je ne crains pas la fusillade… J’ajoutai que, puisque le pouvoir législatif n’était pas d’accord avec le pouvoir exécutif, on ne pouvait faire le bien de son pays, que c’était la seule raison qui me forçait à donner ma démission, et que je les invitais à l’accepter au nom de la patrie. Ils me dirent que ce serait la Convention nationale qui déciderait de mon sort. – Quel qu’il soit, répondis-je, je saurai le supporter avec le courage d’un vrai républicain.
Après bien des propos de part et d’autre, ils ne voulurent point accepter ma démission et m’enjoignirent, au contraire, de continuer mon service. Je leur dis, en terminant, que le temps viendrait où l’on saurait me rendre plus de justice. Ruamps me répondit qu’il le souhaitait. Je sortis.
Dans la nuit de cette même conversation, Billaud partit pour Paris ; Ruamps resta quelques jours après et, le quatrième jour, partit de Port-Malo pour l’armée des Côtes de Cherbourg, avec le général Moulin. Au bout de huit jours, je reçus ordre de cesser tous les apprêts de l’embarquement et de disperser mes troupes sur plusieurs points différents, à savoir : partie sur les côtes de Cherbourg, partie dans le Morbihan et le reste sur les chouans.
Je fis cette besogne en conséquence et donnai les ordres nécessaires pour le départ des troupes de manière que les routes ne fussent point encombrées ni les habitants surchargés. Je me rendis en personne auprès du général Kléber pour détruire cette bande de voleurs connue sous le nom de chouans.
Je fus huit jours consécutifs à leur poursuite. Cependant, à force de les faire serrer par les troupes républicaines, je parvins à leur tuer au moins quatre cents hommes. Après cette expédition, il n’en restait plus que quatre cents à réduire, encore étaient-ils la plupart sans armes.
Je revins à Rennes et ce fut le lendemain, 17 floréal (6 mai 1794), que je reçus ma destitution. Elle ne me surprit pas [59] : je l’attendais de jour en jour, depuis mon affaire de Port-Malo avec Billaud et Ruamps.
Je ne fus pas mis en état d’arrestation, mais mon chef d’état-major, le citoyen Hazard, fut emprisonné à Rennes. Pour moi, comme j’étais libre de me retirer où il me ferait plaisir, je choisis la ville d’Orléans pour résidence. Parti de Rennes avec un cheval de selle qui m’appartenait, j’arrivai à Orléans et j’y restai jusqu’au 13 thermidor, époque à laquelle je me rendis à Paris par la Messagerie. C’était après le décret du 5 du même mois, qui porte, en substance, qu’il est permis à tout fonctionnaire public destitué ou suspendu de ses fonctions de se rendre à Paris pour y produire sa réclamation, en se conformant au « présent décret ».
Je m’y suis conformé, car le 14, jour de mon arrivée à Paris, je fus au Comité de sûreté générale faire ma déclaration qui fut enregistrée, mais le lendemain, 15 thermidor, je fus par un décret mis en état d’arrestation provisoire, et voilà un an que j’y suis provisoirement.
LA DÉPORTATION ET LA MORT DE ROSSIGNOL[60]
Le 3 nivôse au IX, l’explosion de la rue Nicaise eut lieu au moment où le premier Consul passait. Cinq minutes après cette explosion, on cria dans Paris une foule de libelles ou pamphlets dans lesquels on imputait aux républicains, sous le nom banal de jacobins, la scélérate tentative qui venait d’être faite. On fit crier toute la nuit par des hommes à voix de stentor « qu’il fallait égorger ces monstres ».
Les jours suivants, les prisons de Paris furent encombrées de républicains, d’anciens représentants du peuple, de magistrats, de fonctionnaires publics, de généraux et d’officiers de tous grades. On les retint tous au secret le plus complet ; on ne leur permit pas même de tirer aucun secours de leur maison.
Bientôt, sans autre forme de procès, un acte inséré au Bulletin des Lois à la connaissance d’une commission sénatoriale « de la liberté individuelle » intervenait arbitrairement, et l’on répandait à profusion un ARRÊTÉ DES CONSULS par lequel était mis en surveillance, entre nombreux autres, Rossignol, général de l’armée révolutionnaire.
Les prisons de Paris étaient donc pleines de républicains… Il y en avait à la préfecture de police, au Temple, à la Force, à Pélagie en grand nombre.
Bientôt nous fûmes transférés à Bicêtre, mais nous ne devions pas y rester longtemps [61]. On nous fit sortir de Paris au nombre de soixante et onze, en deux convois sous une très faible escorte ; on nous fit traverser la France dans une de ses plus grandes longueurs et passer par tous les départements qu’avaient occupés les Chouans et les Vendéens, dans l’intention que nous fussions égorgés. Des porteurs de cadenettes et de ganses blanches couraient devant nous à cheval pour animer la multitude, et la porter à nous massacrer. Il faut pourtant convenir que, dans plusieurs communes, les magistrats et les citoyens nous firent connaître qu’ils étaient convaincus de notre innocence et que nous emportions leur estime et leurs regrets [62].
Déposés sur la Cayenne, à Nantes, nous y reçûmes des lettres de nos amis et même de l’autorité supérieure qui nous causèrent une vive joie et nous firent concevoir une illusoire espérance ; toutes portaient que le ministre de la Police avait découvert les véritables auteurs du crime du 3 nivôse, qu’il avait fait son rapport au conseil d’État, que notre innocence était reconnue, que nous allions tous rentrer au sein de nos familles. Ces lettres ajoutaient que notre retour devait être prochain, que le gouvernement avait fait défendre à nos parents de nous envoyer aucun secours en argent et vêtements, attendu que ces objets, en se croisant avec nous, pourraient s’égarer et qu’il valait mieux les conserver pour notre arrivée.
Nous ne restâmes pas longtemps à Nantes [63]. On nous fit traverser la ville dans l’obscurité d’une profonde nuit. Nous fîmes nos derniers adieux à notre terre natale.
La frégate (la Chiffonne) fit voile pour le Sud : nous perdîmes bientôt de vue les côtes de Bretagne et les tours de Cordouan, et nous reconnûmes le cap Finistère au delà du golfe de Gascogne.
En route notre bâtiment fut attaqué par les Anglais. Avant le commencement de l’action, le capitaine nous fit enfermer, mais Rossignol trouva le moyen de s’échapper, il monta sur le pont et dit au capitaine : Cette situation est intolérable pour des soldats. Nous sommes tous des Français ici… ne l’oubliez pas, monsieur. »
Le capitaine rendit justice à son sentiment, mais il ne voulut point accepter ses services.
Jusqu’au débarquement nous avons ignoré où nous étions conduits. Notre voyage dura trois mois bien pénibles.
Ce fut le 14 juillet (22 thermidor an IX) que nous descendîmes à terre. Ce jour était l’anniversaire de l’époque mémorable que l’on appelle le triomphe de la liberté ; mais ce triomphe était devenu pour nous celui de la tyrannie et de l’esclavage.
Nous regardions avec une sombre tristesse le navire sur lequel nous avions fait quatre mille cinq cents lieues pour venir végéter, languir et mourir comme des plantes arrachées de leur sol natal, et nos yeux mornes s’égaraient sur l’affreuse perspective de la mer qu’aucune image consolante ne venait adoucir. Il fallut céder au destin et vivre sans avenir.
Cependant quelques-uns d’entre nous avaient encore de l’espoir. Dès le premier jour de notre arrivée, avant le débarquement, Rossignol chercha à relever le caractère de ceux qui étaient moins bien trempés que lui :
« Amis, leur dit-il, ne vous alarmez point, nous reverrons encore le sol de la patrie. Le monstre qui nous a fait jeter sur cette terre ne peut avoir qu’une fin violente. Nouveau Néron, il achèvera sa carrière plus tôt que vous ne l’imaginez ; la France ne restera pas longtemps sous le joug de son oppresseur. Il périra, et la nouvelle de sa mort sera celle de notre délivrance. »
Le capitaine convoqua l’assemblée des notables du pays [64] ; cette assemblée décida que nous serions reçus, et ils s’obligèrent à nous fournir des vivres jusqu’à ce qu’il eût été pris des mesures pour assurer cet objet important. On proposa même de nous distribuer chez les habitants.
Tout allait bien, mais un nommé Malavois, ancien ingénieur des ponts et chaussées, se rendit dès le 13 juillet à l’établissement et reprocha aux habitants l’arrêté juste et bienfaisant qu’ils avaient pris la veille : « Qu’avez-vous fait, leur dit-il. Vous avez violé notre capitulation avec les Anglais [65] en consentant à recevoir ces gens-là, et vous vous exposez à leur juste vengeance. Les hommes que le gouvernement français vous envoie ne sont déportés qu’en apparence, ils sont chargés de l’horrible mission de soulever vos esclaves et de s’emparer de vos propriétés. »
Le commandant nous ayant fait descendre à terre, le 22 messidor, ces habitants vinrent au bord de la mer pour nous examiner : la consternation était peinte sur leurs figures. Le citoyen commandant nous fit un discours analogue à notre position. Le capitaine de la Chiffonne, qui était présent, déclara devant tous les habitants que nous avions tenu sur son bord la conduite la plus louable. Ce témoignage ayant rassuré quelques habitants, les moins fortunés, ils prirent plusieurs d’entre nous chez eux pour enseigner leurs enfants ; mais les plus riches, persuadés par les mensonges de l’ingénieur, non seulement n’en prirent aucun, mais ils refusèrent d’exécuter leur arrêté du 13 juillet et le commandant Quinssy eut beaucoup de peine à nous procurer de quoi ne pas mourir de faim.
Le 17 fructidor suivant, la corvette la Flèche arriva, apportant trente-huit proscrits. À cette arrivée le sieur Malavois et ceux qu’il avait séduits jetèrent de nouveaux cris, mais ce fut inutilement. Ces malheureux, qui étaient depuis plus de sept mois en mer, dont plusieurs étaient très malades, et qui ressemblaient à des squelettes, furent reçus avec bonté par le commandant, quoiqu’il fût embarrassé pour leur procurer des subsistances.
Le sieur Malavois avait déjà cherché à soulever les esprits contre nous à Île-de-France ; il y avait écrit qu’il était obligé de fuir les Seychelles devenues, disait-il, une nouvelle Gomorrhe par l’envoi que le gouvernement français venait d’y faire d’hommes abominables [66]. Ce fut sur cette lettre et quelques autres que l’assemblée coloniale de Île-de-France rendit cette loi terrible par laquelle, après avoir traîné dans la boue le gouvernement français et le ministre de la Marine, elle nous mit tous hors la loi, ordonna que tous ceux de nous qui approcheraient de ses rives seraient à l’instant mis à mort, prononça la même peine contre tout capitaine de guerre ou de commerce qui apporterait un seul de nous aux îles de France et de la Réunion, et déclara toute communication interdite entre ces îles et les Seychelles, tant que nous résiderions dans ces dernières…
Les capitaines anglais Adams, commandant la Sybille qui prit la Chiffonne, Colliers, commandant du Victor, qui coula la Flèche, Alexander, commandant le Brave, nous virent à Mahé ; ils parurent s’intéresser à nous, déplorer notre sort ; ils offrirent à plusieurs de les emmener dans l’Inde, mais nous leur répondîmes tous que, soumis aux ordres de notre gouvernement nous resterions dans l’endroit où il nous avait placés, si mal que nous y fussions. Ils nous offrirent des secours pécuniaires que nous refusâmes ; les plus misérables d’entre nous eussent rougi d’accepter le plus léger bienfait des ennemis de notre patrie.
Tout était calme. Nul de nous n’approchait des habitations de ceux qui ne nous appelaient pas chez eux. Nul habitant ne pouvait se plaindre qu’il lui eût manqué un fétu. Mais un événement bien simple en lui-même survint, qui causa la plus grande joie au féroce Malavois et à ses dupes.
Un de nos compagnons, le citoyen Magnan, s’étant trouvé un dimanche sur l’habitation d’une négresse libre nommée Vola Maelfa, où il était allé voir un autre camarade, le citoyen Laurent Derville, ancien capitaine de cavalerie, qui y était logé, il vit danser les noirs de cette propriétaire, et, comme il était très facétieux de son naturel, à son retour de l’établissement, Magnan contrefit si grotesquement les figures et les pas de la danse nègre qu’il fit naître dans le cœur de ceux qui ne la connaissaient pas le désir de voir cette danse bizarre. De ce nombre était un nommé Serpolet, qui n’avait que peu l’usage du monde, et encore moins celui des colonies.
Dans l’intention d’aller voir danser les noirs, cet homme partit le dimanche suivant pour se rendre chez Vola Maelfa. En son chemin, ne connaissant pas l’habitation, il demanda des indications à un noir qu’il rencontra et qui appartenait au citoyen Leguidec (de Bourbon). Ce noir lui répondit que s’il voulait l’accompagner il le conduirait droit chez Vola Maelfa, parce qu’il allait à un bal que ses noirs donnaient ce jour-là. Serpolet, heureux de cette rencontre, accompagna le noir qui le présenta à ses camarades dès qu’ils furent arrivés. Les noirs, se trouvant honorés d’avoir un blanc parmi eux, lui offrirent sa part de leurs rafraîchissements. Serpolet accepta faute de connaître l’usage des colonies, et il prit part au gala. S’en étant vanté à son retour, nous le réprimandâmes fortement.
Cette affaire semblait éteinte, mais Malavois en ayant été informé fit répandre le bruit que la visite aux noirs de Vola Maelfa était un commencement du grand complot de soulever les noirs, qu’il y avait à ce bal des députés de toutes les habitations, qu’on y avait projeté de profiter du jour de l’an alors prochain et de la liberté qu’avaient les noirs de vaguer ce jour-là, pour égorger les blancs et se rendre maîtres de l’île, que les déportés étaient à la tête du complot puisque l’un d’eux (Serpolet) avait assisté ce bal. Alarmés de ces bruits, les habitants s’assemblèrent, demandèrent que Serpolet fût mis en prison et que dix d’entre nous fussent convoqués pour prononcer sur la peine qu’il méritait. Nous fûmes convoqués quelques jours après avec les habitants par l’organe du commandant. Le résultat de cette séance fut que Serpolet devait être mis en prison le temps que le citoyen Quinssy jugerait convenable, pour le punir d’une incartade involontaire, mais qui n’en était pas moins une faute que la politique devait reprendre. Nous nous séparâmes ensuite, bien convaincus que les habitants devaient être satisfaits. Nous fûmes étrangement surpris lorsque quelques jours après les habitants nous firent appeler par M. Quinssy et nous proposèrent de signer leur procès-verbal à la rédaction duquel nous n’avions pris aucune part, et qui portait en substance que Serpolet serait déporté sur l’Île-aux-Frégates, île déserte et sans culture. Les habitants ajoutèrent à leur délibération de faire partager le sort de Serpolet au noir du citoyen Leguidec qui avait conduit Magnan chez Vola Maelfa, à deux noirs, charpentiers chez cette femme, qui avaient donné le bal, à un nommé Fernando, noir qui y avait dansé.
Le bâtiment d’un citoyen Hodoul étant sur le point de partir pour Île-de-France, on le chargea de transporter à l’Île-aux-Frégates Serpolet et les noirs proscrits.
Dans cette petite traversée, MM. Hodoul et Lacour s’arrogèrent le droit de faire subir des interrogatoires aux cinq transportés et, par menaces et par promesses, ils leur firent dire tout ce qu’ils voulurent et en dressèrent un prétendu procès-verbal, qu’ils se gardèrent bien de communiquer à personne à Mahé, mais qu’ils eurent soin de porter peu de jours après à Île-de-France.
À leur arrivée, ils crièrent tous de concert qu’il n’était plus possible de vivre aux Seychelles depuis que nous y étions, que nous soulevions les noirs contre leurs maîtres, que nous insultions et outragions les femmes et menacions les hommes, que nous nous étions rendus maîtres des armes de la Flèche (qui avait été coulée) et de la Chiffonne (qui avait été prise) et que nous parcourions et dévastions les habitations.
Pendant que tout ceci se tramait à Île-de-France, quelques habitants des Seychelles nous dirent : « Si vous nous en croyez, vous achèterez un navire pour vous reconduire en Europe. Si vous n’avez pas les fonds nécessaires, nous vous les avancerons sur le cautionnement de ceux d’entre vous qui ont de la fortune en France. » Ils exigèrent que les mis en surveillance nommassent des commissaires pour se concerter avec eux. Parmi les commissaires qui furent nommés se trouvait le général Rossignol ; il vivait retiré à Praslin, petite île du nord-ouest de Mahé, sur l’habitation du citoyen Sausse, et venait très rarement à Mahé. On lui écrivit d’y venir pour accélérer l’exécution du projet. Rossignol crut devoir se rendre où on l’appelait, et ces mêmes habitants lui en ont fait un crime.
Après diverses propositions, l’assemblée arrêta que les habitants achèteraient sous le nom du citoyen Van Heck, l’un de nous, un navire que le citoyen Planot achevait de construire et le payeraient six mille piastres ; que nous en fournirions mille comptant et que les habitants fourniraient le surplus à titre d’avance ; que le citoyen Van Heck (propriétaire) souscrirait une lettre de change de la valeur de ce qu’il en coûterait aux habitants ; que le citoyen Emmanuel Gonneau laisserait son habitation et ses noirs en otage et partirait avec nous en Europe, afin d’y toucher le montant de la lettre de change et de ramener le navire qui serait la récompense de ses peines.
L’agent municipal Mondon convoqua une seconde assemblée pour aviser aux moyens de subvenir aux dépenses de l’armement et du départ du navire acheté à Planot. On y arrêta d’établir sur tous les habitants une taxe de trois piastres par tête de noir, laquelle devait être payée avant le 20 mars suivant, le bâtiment devant, disait-on, partir aux premiers jours d’avril.
On invita le commandement, on le somma d’assister à cette assemblée et de donner les commissions et permis nécessaires, mais il refusa l’un et l’autre. Alors le capitaine Saune prit l’engagement de conduire le bâtiment jusqu’à Mozambique seulement, où on pourrait, disait-il, le faire naturaliser portugais, et trouver un capitaine qui se chargerait de le conduire de là en Europe.
Cependant notre ennemi, l’ingénieur Malavois, était toujours à Île-de-France, où il continuait sa campagne de calomnies pour attirer sur nous toutes les vengeances. Dans le même temps, le brick le Bélier apportait la nouvelle de la paix d’Amiens entre la France et l’Angleterre.
L’assemblée coloniale de Île-de-France profita de l’occasion pour envoyer ce navire aux îles Seychelles. Il amenait sur son bord un commissaire envoyé spécialement pour prononcer sur les réclamations des colons relativement aux prétentions des déportés.
Le 12 mars, à quatre heures du soir, on vit paraître un bâtiment de guerre portant pavillon français et flamme. Les manœuvres de ce bâtiment, les différents signaux qu’il faisait et son soin de ne point approcher de la rade jetèrent quelque inquiétude dans les esprits et, la visite de santé étant faite, un habitant (le chirurgien Biarieux) et trois des mis en surveillance se rendirent à son bord : ils furent tous quatre mis aux fers [67].
Ne voyant point reparaître l’officier de santé ni aucun de ceux qui s’étaient rendus à bord, pas même le commandant, et comme ce vaisseau faisait des signaux extraordinaires, mettant des feux à ses vergues et tirant en plein minuit des coups de canon à boulets rouges, l’inquiétude redoubla.
Plusieurs de ceux de nous qui étaient à l’établissement se rendirent chez le commandant, le croyant arrêté pour se concerter avec son épouse sur les moyens de le défendre. Mme Quinssy les remercia et leur dit qu’il n’y avait point d’inquiétude à avoir. Ces paroles rassurèrent tout le monde et tout resta calme. Mais bientôt on apprit que les habitants du canton Letrou, tous affidés du sieur Malavois, avaient pris les armes, qu’ils poursuivaient avec des fusils et des chiens ceux de nous qui logeaient sur les habitations voisines de ce canton, qu’ils les arrêtaient, les attachaient, les amenaient chez l’agent municipal et les entassaient dans une de ses paillotes à la porte et à la fenêtre de laquelle ils avaient placé deux factionnaires, avec ordre de tuer sans miséricorde celui qui tenterait de sortir de cette prison ou charte privée.
Ils voulurent même forcer l’habitant Biarieux, chirurgien, à prendre les armes contre nous, ce qu’il refusa, assurant qu’il ne s’armerait jamais contre des gens paisibles et tranquilles ; aussi fut-il arrêté et incarcéré ; on voulut même le faire déporter pour cela [68].
Le lendemain matin, le citoyen Quinssy vint à terre et nos malheureux compagnons, ravis de le revoir, lui témoignèrent l’inquiétude qu’ils avaient eue sur son sort ; tandis qu’ils lui parlaient, la troupe qui était à bord du Bélier effectuait sa descente sous le commandement du capitaine Dejean et paraissait n’avancer qu’avec précaution. Le général Rossignol alla vers les soldats en disant : « Mes camarades, ne craignez aucune résistance de notre part, nous ne savons qu’obéir et souffrir. »
Il n’existait à Mahé aucun trouble, aucun crime, aucun délit ; pas même la plus légère rixe ; il n’y avait pas de coupables : tous devaient donc s’attendre à rester à Mahé. Aussi lorsque le citoyen Laffitte, commissaire envoyé par le général Magallon, eut dit qu’il fallait aller à bord du Bélier pour y être interrogé, Rossignol et beaucoup d’autres s’empressèrent de s’y rendre. Ils y furent reçus avec la plus horrible dureté, entassés les uns sur les autres dans un entrepont bas et obscur et étendus sur des câbles. Cependant le commissaire Laffitte ne tarda pas à voir de ses propres yeux qu’il n’existait aucun trouble aux Seychelles, qu’aucun délit n’y avait été commis, qu’aucune femme n’y avait été outragée, que toutes les habitations étaient tranquilles, qu’aucun habitant n’avait découché de son lit, que nous n’avions ni armes, ni moyens, ni volonté de nuire, enfin que tout ce que Malavois et ses acolytes avaient débité contre nous à Île-de-France n’était qu’un tissu d’horreurs et de fourberies. Aux termes de la proclamation du général Magallon, sa mission devait donc être finie ; il devait constater par un procès-verbal le véritable état des choses, et aller faire son rapport à son supérieur. C’était du moins ce que nous avions lieu d’espérer ; mais nous fûmes cruellement déçus. Le citoyen Laffitte avait sans doute des ordres secrets contraires à la proclamation du général. Ne pouvant baser l’enlèvement de tout ou partie de nous sur des faits évidemment faux et calomnieux, il imagina de consulter les habitants les uns après les autres sur le compte de ceux qu’ils croyaient le plus dangereux et, sans dresser aucun acte, tenir même aucune note des accusations secrètes, sans nous les communiquer, sans nous entendre, il se contenta de faire des croix en marge des noms de ceux qu’on lui déclarait comme dangereux : singulière manière de faire le procès à des hommes ou plutôt moyen assuré de victimer des innocents sans compromettre leurs délateurs faussaires, en ne laissant pas trace de la calomnie et de la délation.
Les partisans du sieur Malavois demandaient à grands cris que nous fussions tous enlevés et que même le commandant fût conduit à Île-de-France, mais plusieurs habitants réclamèrent. Cependant notre perte totale eût été consommée, si la corvette le Bélier, encombrée de soldats volontaires des colonies, eût pu nous contenir tous. Laffitte se contenta de trente-trois victimes [69].
Quand il fut parvenu à ses fins, il s’embarqua pour conduire ces infortunées et innocentes victimes au lieu de leur immolation. Plusieurs de ces malheureux avaient demandé au commissaire Laffitte, qui s’y refusa, à être entendus. Rossignol aurait montré à Laffitte une demande faite par lui et plusieurs autres, deux mois auparavant, tendant à ce que l’on nous transférât à la Digue ou à la Silhouette, pour ôter tout prétexte aux inquiétudes simulées des habitants sur notre résidence à Mahé et à Praslin.
La manière dont ces malheureux étaient reçus sur le Bélier, lorsqu’ils y arrivaient, révolterait la nature entière. Jamais homme flétri par la justice ne fut reçu sur les galères avec plus de dureté. On affectait de les regarder avec horreur, on les traitait de scélérats, on les poussait avec une horrible brutalité vers l’antre qui devait les receler, et, pour leur annoncer d’une manière terrible et non équivoque le sort funeste qui les attendait, on ordonnait de jeter à la mer leurs misérables effets et les outils des ouvriers en criant qu’ils n’en auraient plus besoin.
Il est bien pénible, bien douloureux, d’avoir à rapporter de pareilles horreurs exercées par des hommes contre des hommes, par des Français contre des Français, mais malheureusement ces faits sont aussi constants que l’existence du jour.
Quand on sut que trente-trois d’entre nous allaient être ainsi déportés, sans autre forme de procès, à l’île d’Anjouan, M. Langlois, habitant de Mahé, dit au commissaire : « Monsieur, si vous les envoyez à Anjouan, il n’en restera pas un dans trois mois. Je connais le climat. » Cette observation fut inutile. Notre sort était décidé [70].
Le 13 mars 1802, le Bélier leva l’ancre et s’éloigna des îles Seychelles.
Quel voyage !
Rien n’égale ce que nous avons souffert pendant ce trajet de huit cents lieues. On nous jeta dans l’entrepont où nous étions extrêmement serrés et privés d’air et de lumière dans un logement qui n’avait tout au plus que dix-huit pieds de longueur sur douze de largeur. Une garde armée était nuit et jour à l’écoutille et, pour nous permettre de satisfaire à nos besoins naturels, on nous escortait comme de vils criminels.
Cependant le vaisseau naviguait sous la zone torride. Nous étions tellement serrés que le moindre roulis suffisait pour nous entasser les uns sur les autres. L’excessive chaleur nous avait forcés à dépouiller tous nos vêtements ; malgré cela, la sueur sortait de notre corps comme l’eau d’une éponge. Cet excès de souffrance et de honte nous faisait souhaiter la mort.
Un jour d’affreux désespoir, Rossignol, le cœur brûlant de colère, demande obstinément à parler au capitaine, car nous étions décidés à en finir. Le capitaine consent à l’entendre, le fait monter sur le pont bien escorté et lui demande ce qu’il veut : « Nous voulons, répond Rossignol, que vous nous fassiez fusiller tous sur votre bord ! Cette mort sera plus douce que le supplice auquel vous nous avez condamnés ! »
Le capitaine hésite et répond qu’il n’a pas le droit de disposer de notre vie.
« En ce cas, reprend Rossignol, laissez-nous respirer ! »
L’équipage indigné protesta en notre faveur. L’émotion était si grande dans tous les cœurs que l’on fut sur le point d’assassiner le capitaine.
Ce soldat stupide, aussi lâche que cruel, baissa les yeux sous le regard de Rossignol ; il eut recours à toutes les bassesses pour calmer les matelots, et, pour conserver sa vie, il consentit à ne plus compromettre la nôtre : nous eûmes la faculté de monter tous les jours sur le pont, pendant deux heures, quatre par quatre.
C’est en vain que les malheureux qui ont souffert cherchent à effacer de leur mémoire les souvenirs douloureux. Ce capitaine est toujours là. Je me vois toujours dans l’entrepont de ce navire pressé contre mes compagnons [71] !
Et nous étions les citoyens d’un pays libre, et Rossignol était un vainqueur de la Bastille, un des premiers soldats de la Révolution !
Le Bélier aborda, le 3 avril 1802, à Anjouan, l’une des îles Comores. On nous jeta sur la plage pendant la plus forte ardeur du soleil, comme des animaux destinés à peupler les déserts.
Le sol, entièrement découvert dans cette partie, n’offrait aucun abri ; nous étions à trois quarts de lieue de la ville. Cette ville, qui porte le nom de l’île, est gouvernée par un roi arabe. Le capitaine Hulot parlementa avec le roi pour conclure le marché de notre réception. Il lui dit que nous étions envoyés par le gouvernement français en signe d’amitié pour contribuer à défendre ses possessions. Pour obtenir plus sûrement qu’il nous gardât, il lui fit donner deux canons de fonte de fer, un autre petit de bronze, une pièce de drap écarlate, de la poudre, du plomb et vingt-huit fusils. Cette convention bien stipulée, le brick cingla vers Île-de-France, ne nous laissant pour toutes ressources que quelques centaines de biscuits et un carteau d’arak [72].
Le capitaine Hulot nous avait sans doute dépeints pour des hommes dangereux, car on refusa de nous recevoir dans la ville.
On nous fit construire un hangar de feuilles de cocotiers. Nous couchions par terre, presque couverts d’eau après les mauvais temps fréquents, ou brûlés par le soleil, lorsque le ciel était pur ; la santé la plus forte et le tempérament le plus robuste n’auraient pu résister au climat de cette île excessivement malsaine ; l’air y occasionne des fièvres malignes ; la plus funeste influence est celle de la nuit.
Et pendant ce temps notre oppresseur vivait au sein de toutes les voluptés, s’enivrait de tous les plaisirs que la mollesse parisienne peut offrir et reposait paisiblement sous les lambris dorés.
Nous avions peu de ressources pécuniaires ; cependant il nous restait quelques pièces de draps et de toiles et des objets de quincaillerie que nous avions emportés de Paris.
Nous demandâmes au roi la permission de construire une case. Il nous l’accorda.
Je fus l’architecte de cette pauvre bâtisse [73] qui devait être pour nous un palais.
Le bâtiment avait quatre-vingt-dix pieds de longueur et les façades latérales quarante-cinq. Dans toute la longueur s’alignait, sur deux rangs, un dortoir contenant trente-trois lits de feuillage. Derrière les deux extrémités du dortoir étaient, d’un côté la cuisine, et de l’autre le réfectoire.
Ces deux pièces formaient deux pavillons carrés, autour desquels j’avais pratiqué une galerie couverte qui les joignait ensuite, en passant le long du dortoir. Chacune des deux façades longitudinales avait cinq portes ou fenêtres.
Avec des pierres et un ciment que l’on compose avec de la chaux de corail blanc, nous voulions élever devant la façade de ce bâtiment un obélisque supporté par trente-trois colonnes dédiées chacune au nom d’un déporté.
L’édifice entier n’aurait pas ressemblé au temple du Soleil dans la ville de Palmyre ; mais il n’en fallait pas tant pour des malheureux. Notre premier désir était de travailler ensemble à quelque chose qui nous rendît la vie moins pénible et qui attestât à la postérité, si loin de la métropole du tyran, ses fureurs et nos infortunes.
Nous voulions enfin donner aux habitants d’Anjouan une preuve des progrès de la civilisation chez les Européens, et peut-être mériter par là quelques égards de leur part.
En effet nos travaux avaient fixé l’attention de tous les habitants d’Anjouan. Notre obélisque surtout les étonnait beaucoup. Ils admiraient nos talents, et chacun d’eux se proposait d’utiliser notre industrie quand une épidémie affreuse se déclara dans l’île d’Anjouan.
Cette maladie, dont nous fûmes presque tous frappés, occasionnait des douleurs aiguës qui se répandaient dans tous les membres et qui n’avaient de terme que dans une mort rapide.
Rossignol fut une des premières victimes de l’épidémie. Jusqu’à son dernier moment ses paroles ne démentirent point son caractère impétueux et son courage intrépide.
Quelques instants avant d’expirer, il s’écria dans des mouvements convulsifs et en se tordant les bras : « Je meurs accablé des plus horribles douleurs, mais je mourrais content, si je pouvais savoir que l’oppresseur de ma patrie, l’auteur de tous nos maux, endurât les mêmes souffrances ! »
Il fut vivement regretté de nous tous et malgré nos propres maux, malgré l’égoïsme de la douleur, nous trouvâmes encore des larmes pour pleurer son trépas. Du reste, par son caractère, il nous était essentiellement utile. Fallait-il agir avec vigueur ? Il était le premier, et son activité paraissait infatigable ; fallait-il souffrir avec résignation ? Il donnait l’exemple d’une âme stoïque. La commune infortune nous avait réunis. La séparation éternelle qui venait de nous isoler répandait autour de nous cette inquiète mélancolie qui remplit l’âme épouvantée.
C’était le 8 floréal an X.
FIN.