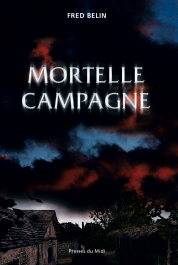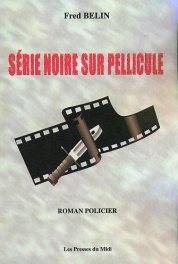Fred Belin
L’IDOLE DÉJEUNE
Nouvelle
Table des matières
À propos de cette édition électronique
L’IDOLE DÉJEUNE
– Victor…
– Monsieur ?
– Je m’ennuie…
Monsieur posa sa grosse tête sur sa paume et poussa un soupir. Quelques vagues se formèrent à la surface de son thé au lait.
– Voyons, Monsieur… Et vos livres ? Comment voulez-vous vous ennuyer avec vos livres ?
Fallait reconnaître que Monsieur n’avait pas bonne mine. En 14 ans de service, je lui en avais connu de meilleures. Mais, bon, je m’en fichais… Monsieur ne m’intéressait plus.
– Oh, tu sais Victor… mes livres… oui mes livres… Bien sûr…
– Si j’écrivais comme Monsieur, je ne m’ennuierais jamais.
C’était sous-entendu : si j’étais une star de chez Gallimard, Plon ou n’importe quel éditeur de renom avec des avances de 100 000 euros et deux cents lettres de fans par jour, ça m’étonnerait que je vienne encore me plaindre.
Mais le sort en avait voulu autrement : j’étais le serviteur, le larbin, la serpillière de l’idole de toute une génération de lecteurs. Un domestique, en somme.
Pour comprendre comment j’en suis arrivé là, il faut reprendre mon histoire depuis le début.
C’était en 1983, lorsque poussé par le vent de la création, je m’étais décidé à poser sur le papier les effluves philosophico-existentielles qui peuplaient à l’époque mon cerveau.
À la fleur de l’âge et d’une plume virginale, j’imaginais le monde littéraire comme un immense territoire de la pensée où, bien que visité depuis des siècles par des hordes d’écrivains plus ou moins doués, beaucoup restait encore à explorer.
Mes idées, pensais-je, sont bien plus profondes que celles des autres. Bien plus intéressantes. Et révèlent de la vie ce que tous mes confrères n’ont pas su exprimer de manière aussi brillante que la mienne.
M’aurait-on donné à la naissance une faculté supplémentaire dont aucun de mes semblables ni aucun de mes prédécesseurs n’aurait bénéficié ?
Une propension à toucher muni d’un simple alphabet les mystères de l’humanité, ses joies et ses tourments ? Et si mes idées pouvaient changer la face du monde ?
J’en étais convaincu.
Jusqu’au 12 mars 1983, je ne fis profiter de mon esprit fin qu’à mes proches. On m’écoutait à table, la cigarette coincée entre deux doigts, et on affichait à mon endroit un profond respect lorsqu’à la fin du repas, j’y allais de mes déclamations sur tous les sujets.
Dans les yeux de mes convives, je lisais l’intérêt. À peine sorties de ma bouche, mes paroles étaient déjà bues. On me questionnait durant des heures. J’inondais de ma science leur dimanche après-midi.
Ainsi coulait jusqu’à lors mon existence…
Mais, un beau jour, mon cerveau se retrouva à l’étroit. Car plus j’avançais dans la vie et plus j’avais d’idées sur tout.
La nuit, au lieu de me laisser en paix, j’entendais toutes ces réflexions cogner sous mon crâne. C’était un peu comme ces valises trop remplies et qu’on continue pourtant de tasser : un matin, elles vous lâchent sur le tapis roulant d’un aéroport.
En mars 1983 donc, mon esprit ressemblait à ces valises. Tassé, à la limite de l’implosion.
Je sentais bien qu’il étouffait. Que toutes les idées brassées depuis ma naissance et qui faisaient la joie de ceux qui avaient la chance de m’approcher s’amalgamaient au point de freiner mes nouvelles réflexions.
Il fallait donc trouver une solution pour désengorger ce trop-plein d’intelligence sans pour autant en perdre le contenu. Le monde en eût souffert, pensais-je comme on pense quand on a vingt-cinq ans. C'est-à-dire mûr, mais un peu con.
Et, puisqu’il me restait encore un peu de place pour gamberger, j’eus l’idée d’étaler mes lumières sur le papier.
Alors là, je me suis dit que c’était le coup de génie du siècle !
Quitte à travailler pour vivre, autant que ce soit pour instruire la plus grande masse. Celle qui était populaire et celle qui était internationale aussi.
Chose que j’entrepris en commençant petit.
Il faut dire qu’à l’époque je maniais assez bien la modestie. Je décidais de me libérer lentement, patiemment… au compte-gouttes. Il fallait que chaque ligne, chaque mot ait son importance. J’y ajoutais un style bien personnel. Sans cesse, je relisais mes phrases. Je les mettais en bouche, les déclamais.
Quelques fois, je me surprenais, la page dans la main, à enchanter mon auditoire. J’améliorais ma technique devant un miroir. J’enrobais chaque syllabe d’une articulation parfaite.
Tout en m’expérimentant, je m’abandonnais avec maestria.
– Victor… je voudrais une tartine. J’aime bien les tartines au petit déjeuner.
– Bien Monsieur… Tout de suite Monsieur…
Monsieur cassa un sucre et le jeta dans sa tasse, sans conviction. Il attrapa sa cuiller et remua son thé. Une fine buée se forma sur ses lunettes puis disparut.
Monsieur reprit sa position d’homme blasé.
Reprenons…
Donc, le 12 mars 1983 fut le jour qui, encore aujourd’hui, reste gravé dans ma mémoire comme étant celui qui changea ma vie car ce matin-là j’eus la bonne idée d’allumer ma radio pour écouter de quoi mes semblables s’informaient localement.
J’appris au milieu de cette masse d’actualités qui ne touchaient guère un esprit aussi élevé que le mien, qu’un concours de nouvelles littéraires avait lieu à quelques pas d’ici.
N’ayant rien d’autre à faire dans la journée et puisqu’il fallait que je me repose un peu, je décidai par jeu d’y participer.
Ce n’est pas sans douleur toutefois que j’écrivis ma première nouvelle. Tout ce qu’à présent j’avais exprimé comme de grandes théories, devait se retrouver construit afin de fabriquer de toutes pièces une histoire.
Et là, l’affaire n’était pas mince.
Souvent, au cours de soirées, j’avais rencontré des gens qui prétendaient qu’écrire était donné à tous. Qu’il suffisait d’avoir du temps devant soi et qu’au bout d’un moment, la main tellement lasse d’avoir attendu se mettait à vibrer et à former des mots, des phrases puis des récits. Qu’y avait-il de plus simple qu’écrire ?
Moi, j’affirme que ceux qui déclament cela avec autant de certitude n’ont sans doute jamais écrit une ligne de leur vie.
Sinon, ils sauraient que l’écriture est une épreuve. Un calvaire parfois.
Ils sauraient que la langue française ne se laisse pas dompter aussi facilement. On croit la tenir, et puis elle vous file entre les lignes. Parfois, ce ne sont pas les idées qui vous manquent, mais les mots. Et de combien de mots faut-il user pour qu’au bout de trois cents pages, le lecteur n’éprouve aucune lassitude ? Combien de synonymes, d’expressions, de formules pour ne pas se répéter ? Combien de constructions, aussi, pour que chaque texte ne soit pas la copie d’un autre ?
Tout cela sans compter, les redites, les non-sens, les contradictions, la profondeur et tout ce qui fait qu’un ouvrage est travaillé ou non.
Vraiment, ceux qui prétendent que l’écriture est aisée ignorent totalement ce qu’est « écrire ». Ils imaginent seulement.
Lorsqu’on les défit, ils vous pondent à grand-peine quelques phrases sans tenue sur une demi-feuille. Le reste suivra, disent-ils, prends patience.
Mais le reste n’arrive jamais. Car le souvenir du travail accompli pour ces quelques lignes sans intérêt leur remémore combien de tortures mentales il faut souffrir pour devenir et demeurer écrivain.
Le sujet du concours de nouvelles étant libre, je m’employais à trouver une construction policière afin de prouver au monde la noblesse de ce genre.
Je ne voudrais pas revenir sur les idées reçues et sur la non-écriture dont nous bassinent les biens pensants du roman blanc. Encore une fois, pleurer sur son sort ou raconter ses ébats amoureux ne demande pas plus de style me semble-t-il.
Moi, je dirais que le polar exige non seulement l’intransigeance quant à la narration, mais en plus une imagination prodigieuse. Et qu’il existe de bons romans blancs comme il abonde de bons polars. Mais laissons ce débat à ceux qui lisent peu et n’écrivent pas.
Mon thème étant choisi (le viager et ses convoitises), j’étalais mes premiers vocables sur la page.
Je ne saurais toujours pas dire pourquoi mais, tout en écrivant, je ressentais les bienfaits de cet écoulement lettré. On eût dit que les mots se précipitaient sous ma plume comme s’ils s’étaient rués vers la sortie d’un bâtiment en feu. Vite, vite… ils me quittaient.
Il me fallait désormais apprendre à les maîtriser.
Malgré la difficulté, j’organisais ma lexie. Enchaînais des paragraphes. M’intéressant à l’histoire au même titre qu’à sa structuration. Tout me plaisait dans l’écriture.
Je me délectais de radiographier mes pensées tout en suant de la matière grise.
Je me souviens très bien de cette première rencontre avec l’écriture de fiction.
Les heures avaient filé sans que je n’y prenne garde, évadé dans mon état de transe. Pourtant, la nuit était déjà tombée sur les carreaux. Dans mes jambes, mon chien affamé réclamait sa gamelle.
Au petit matin seulement, harassé, vidé mais fier de mon travail, j’abandonnai mon corps au canapé glacé. Et quand je m’autorisai enfin à fermer les yeux, c’était comme si la grâce était venue me frapper : je venais d’hériter du besoin d’écrire. Du vrai…
De celui qui ne vous lâche jamais dès qu’il vous a mordu.
– Elle vient cette tartine, Victor ? Ça fait deux minutes que j’attends ! C’est long ! !
– J’arrive, j’arrive Monsieur… Je ne trouve plus le beurre.
– Mais dans le frigidaire, voyons…
– Je vous le concède Monsieur, mais Félicienne a fait les courses et ce dernier est rempli. Le beurre doit se trouver derrière tout un tas d’aliments. Je le cherche.
– Eh bien, cherchez Victor… Cherchez… Mon Dieu, ce que vous êtes empoté mon pauvre ami !
En me réveillant de ce sommeil merveilleux, la tête encore lourde de rêve, je sautai sur mon ordinateur et, après l’avoir dactylographiée, imprimai ma nouvelle.
Les mots, les phrases… Tout y était…
À peine extrait de mes songes, je me replongeai bien éveillé, dans celui de la création littéraire. Je me suis dit que c’était de la magie d’avoir enfanté un texte aussi bon. Et je me fis la promesse (puisque nombre d’auteurs ne me plaisent guère) d’écrire moi-même les manuscrits qu’il me plairait de dénicher en librairie.
Durant la journée, je relus cent fois ma nouvelle. Corrigeant ça et là des expressions ; trouvant des formules plus justes et plus percutantes. Au final, je ne sus quoi dire de plus et ne pus rien changer qui la rendit encore meilleure. Elle était tout simplement parfaite.
Prête à gagner le concours.
Je fis les six copies qu’exigeaient les organisateurs, et les ayant glissées dans l’enveloppe avec un petit chèque (participation aux frais de participation – sic !) j’oblitérai le tout d’un coup de langue rendue sèche par l’excitation.
Et j’attendis…
Oh, pas très longtemps à vrai dire…
Certes, j’eus encore le temps de servir ma science devant quelques auditoires. Auditoires auxquels je cachai subtilement le fait de m’être livré à une compétition de mots. Oui, pensais-je, il sera bien temps de leur apprendre quand j’aurai reçu mon prix.
Et ce jour arriva deux mois plus tard lorsqu’un membre du jury eut la délicate intention de m’informer de ma victoire par téléphone.
Sur le coup, je manquai de sagacité et m’imaginai que mon interlocuteur, comme subjugué par mes écrits, avait ressenti le besoin de m’avertir qu’il se pâmait de mes lignes. Que ce prix, pourtant décerné depuis de nombreuses années, n’avait jamais atterri en de si bonnes mains.
Mais je m’égarais…
En réalité, il en était tout autrement.
Voilà l’explication : le président du jury n’était pas moins qu’un célèbre égyptologue et romancier de renom et ma non-présence à la remise des prix (puisque j’en avais remporté un) eût heurté la sensibilité de ce maître à penser, à écrire, et à lire.
On me conviait explicitement à aller récupérer mon prix à l’occasion d’une cérémonie grandiose…
On m’informa pour finir que le deuxième prix était celui que j’avais décroché. Pas le premier…
C’est peut-être de là que me vint le premier déclic et que les doutes commencèrent à m’assaillir : mes contemporains avaient-ils véritablement conscience de la valeur de mes textes ?
– Voilà, j’ai trouvé le beurre Monsieur. Derrière le persil…
– Ce n’est pas trop tôt. J’aurai bientôt fini mon thé que je n’aurai pas mordu une seule fois dans ma tartine !
– Vous exagérez Monsieur. D’ailleurs, vous n’avez toujours pas touché à votre thé. Il n’est pas à votre goût ?
– De toute façon, rien n’est à mon goût. Je suis malheureux Victor.
– Oh non, Monsieur ! ! ! Pas vous ! ! !
J’appréciai la remise des prix car ce fut pour moi l’occasion de m’exprimer à la presse. Écrite et très locale, mais c’était déjà un premier pas dans la médiatisation de mon talent. J’ai bien dit plus avant que je voulais instruire les masses, non ? ! ?
Le président et non moins auteur de renom se prit volontiers au jeu et me parut beaucoup plus sympathique que ses livres. J’entends par là, plus sympathique que les personnages qui figurent dans ses ouvrages car lui-même, bien qu’un peu « qu’est-ce que je fous là ? » se révéla charmant.
En moins de deux, j’empochai la médaille d’argent, le diplôme et les félicitations de tout le monde. On m'obligea à glisser un mot sur le premier prix que je trouvais totalement nul et immérité, puis on m’abandonna champagne en main aux journalistes du cru auxquels je pus faire passer une partie de mon message : lisez-moi, lisez-moi tous, je suis le meilleur !
Cette première victoire éveilla chez moi l’envie de continuer mon chemin dans l’univers merveilleux de l’écrit.
À la suite du concours, poussé par le vent des félicitations qui soufflait de toutes parts, l’écriture d’un roman s’imposa d’elle-même.
Sitôt rentré, j’allumai mon ordinateur et lançai mon traitement de texte. J’abandonnai le papier et le stylo car cette fois-ci, j’allais travailler un texte plus riche, plus dense, plus gros aussi en terme de contenu. Pour étaler mon imagination débordante, des kilos de cahiers n’auraient pas fait le poids. Aussi, je me mis à bénir l’informatique pourtant élémentaire à l’époque.
Encore une fois, je choisis le thème policier pour les mêmes raisons que j’évoquais plus tôt et peut-être aussi parce que l’envie de tuer – ne serait-ce que celle qui m’avait raflé le premier prix – faisait partie de la bestialité qui, dit-on, sommeillait dans le cervelet de tout un chacun depuis la préhistoire. Il semblerait que chez les êtres à l’intellect particulièrement développé, ces instincts ressurgissent parfois avec beaucoup plus d’intensité. Chose que je confirme.
Et c’était reparti… Les nuits à penser. Les nuits à souffrir. Les nuits à pleurer des mots.
Un roi de Perse, enragé de ce jeu, a affirmé que les échecs pouvaient rendre fou. Mais, a-t-il une seule fois tenté d’écrire ne serait-ce qu’une fantaisie ?
Je proclame haut et fort qu’écrire un roman rend fou d’une manière certaine.
J’ai vécu pendant un an et demi au gré de l’écriture du mien. Durant ces 18 mois d’enfer, je suis passé par tous les stades des émotions que peut connaître l’humain. S’il fallait que je décrive ce que j’ai enduré jusqu’au jour où je plaçai le point final à la fin de mon œuvre, ma vie entière n’y suffirait pas. Et l’écrire me torturerait davantage.
Ce fut un interminable accouchement. Une obsession. Un voyage vers un autre monde avec, tapie au creux des entrailles, la peur de ne jamais pouvoir en revenir. Plus j’avançais dans mon histoire et plus il me semblait m’éloigner de sa fin. À chaque nouvelle idée, il en découlait des dizaines d’autres et ainsi de suite jusqu’à l’étourdissement.
On entend souvent parler de l’angoisse de la page blanche.
Personnellement, mon anxiété ne s’est jamais placée à ce niveau car mon imagination a toujours été débridée, comme je l’ai prétendu et comme je le prétends encore.
Mes craintes les plus intimes ont systématiquement concerné le texte lui-même. Ai-je donné un excellent livre ?
Ai-je eu assez de style ? Mes tournures se sont-elles imbriquées sans gêner la compréhension ? Suis-je allé au fond de ma pensée ? Ai-je dépassé les clichés ? Ai-je maîtrisé mon sujet ? Ai-je été suffisamment original ? Livrer en pâture ses réflexions intimes… n’est-ce pas ridicule ?
– Est-ce vous qui payez le beurre Victor ?
– Non Monsieur… Pourquoi cette question ?
– Parce que ma tartine ressemble à du pain sec !
– C’est pour votre bien Monsieur. Votre cholestérol.
– Je me fiche de ma santé. Veuillez me mettre une bonne couche de beurre. C’est tout ce que je vous demande ! Je vous paie pour obéir, pas pour discuter.
– Bien Monsieur. Je vais en rajouter…
Bien sûr, durant toute cette période, j’écrivis plusieurs nouvelles.
Ces petits textes courts, je les dominais facilement à présent et lorsque je désirais me reposer l’esprit (en m’éloignant du sujet de mon roman), c’était vers eux que je me tournais.
Je confesse avoir participé à d’autres concours que je décrochai tous haut la main. Et je peux le jurer, je me fichais éperdument des prix qu’ils me rapportaient. Seule comptait pour moi la bénédiction des lecteurs que j’interprétais comme un encouragement à continuer.
Le roman terminé, j’éprouvai un véritable soulagement.
J’ai le souvenir de m’être enivré au Gin et d’avoir payé cette petite fête par un état comateux.
Mes esprits retrouvés, je relus mon roman en long, en large et en travers. De manière normale et de manière croisée. J’étais très fier de moi. Tout ce que j’avais voulu faire passer était clairement exprimé. L’intrigue tenait vraiment la route. C’était du bel ouvrage.
On pourra lui reprocher ce qu’on voudra puisqu’il en faut toujours pour critiquer, mais je sais que je n’ai pas volé mon lecteur.
Pourtant, je l’admets, au bout de tant de temps de vie commune, j’étais heureux de m’en séparer. La torture mentale s’en irait d’elle-même, pensai-je.
C’était sans calculer le vide qui s’installa en moi les jours suivants.
Connaissez-vous la dépression des jeunes mères ?
Je suppose qu’elle ne doit pas être très différente de celle qui s’abattit sur moi. Il me semblait avoir abandonné mon enfant, même si je savais que pour lui, le temps était venu de faire sa vie.
Lorsque je me suis repris et que je me suis arraché du fond dans lequel j’étais descendu, je me suis dit que cet enfant était trop beau pour le garder chez moi, enfermé dans un placard comme on emprisonne un joyau. Et puis des millions de lecteurs m’attendaient au virage. Je refusais de les décevoir.
En conséquence, j’envoyai mon bébé aux éditeurs.
Et c’est ainsi que le véritable drame de ma vie commença…
– Voilà Monsieur ! Ça ira comme ça ?
– Ah oui ! Un bon demi-centimètre de beurre ! Ça, c’est de la tartine. Attendez que je la goûte… hum… hum…
On dira ce qu’on voudra, mais l’attente n’a rien de grisant. Elle pèse, même. Malgré tout, je n’étais pas en soucis. Innocemment, fourvoyé par l’aveuglement de cet effort, j’imaginais les éditeurs se battre à ma porte pour gagner ma signature. Je les voyais par grappe se ruer chez moi, contrats et stylo en avant, heureux d’avoir dégoté le talent du siècle. J’en repoussais autant qu’il en arrivait. J’exigeais du temps pour lire l’ensemble des propositions. Je m’arrêtais devant les vitrines des agences immobilières et repérais ma prochaine maison sans regarder le prix…
J’attendais patiemment ce que je considérais comme la juste récompense d’autant de sacrifices pour en arriver là.
La première réponse parvint d’un grand éditeur parisien qui a pour réputation de faire la pluie et le beau temps. À vrai dire, je n’en fus pas surpris sur l’instant. J’estimais à juste titre que le meilleur avait droit au meilleur.
Mais quand je décachetai l’enveloppe et que je lus le courrier qu’elle contenait, mon cœur faillit s’arrêter de battre. Je dus me retenir au chambranle de la porte pour ne pas m’effondrer, fauché par la surprise : c’était une lettre de refus.
Pour couronner le tout, il s’agissait d’une lettre type, tapée par on ne sait quelle secrétaire dans laquelle je découvris une faute de grammaire mais pas la moindre – non, vraiment pas la moindre – trace d’humanité. On m’informait que je ne correspondais à aucune collection, point. Et on me souhaitait bonne chance pour la suite, parce qu’il fallait bien dire quelque chose pour conclure le document.
De rage, je formai une boule avec ce torchon et l’envoyai directement dans la poubelle de la cuisine. C’est drôle comme les abominations s’attirent entre elles. Ensuite, je ressortis le Gin et j’en avalai un verre cul sec pour me remettre de mes émotions. J’évacuai ma hargne en insultant l’éditeur et je me calmai en me disant qu’il allait bien regretter d’être passé à côté de quelque chose d’aussi exceptionnel qui aurait pu faire sa fortune et la mienne.
Bien… puisque c’était ainsi, je laisserai le bonheur de ma découverte à un autre éditeur qui saurait apprécier la sublimité de mon texte et juger de mon potentiel pour les livres à venir.
Le jour suivant, je reçus deux autres réponses. Je devrais dire deux « refus » puisque c’est ainsi que l’on nomme ces courriers pour aller plus vite. Là encore, on ne faisait aucune allusion à la qualité de mon manuscrit. On m’expliquait juste que c’était « non » et qu’ailleurs, peut-être, on m’attendait…
Un post-scriptum m’informait que mes écrits étaient tenus à ma disposition, et qu’il était possible de me les renvoyer contre une certaine somme. Chose que je fis pour les deux derniers.
Connaissez-vous la technique des points de colle blanche ?
Elle consiste à appliquer de minuscules points de colle, invisibles à l’œil nu, entre deux pages et ce toutes les dix pages. Cela ne gène en rien la lecture car il suffit de tourner naturellement les feuilles concernées pour les séparer. Quelqu’un qui lirait ce manuscrit décollerait les pages sans même s’en rendre compte. Par contre, la personne avertie connait exactement leurs emplacements et quels points de colle tiennent encore. Ainsi, à son retour, on sait si l’envoi a été lu, et si oui, jusqu’où… à dix pages près.
Il ne sert à rien de vous faire languir plus longtemps. Les deux manuscrits retournés avaient conservé leurs points de colle en l’état ! La conclusion s’imposait : le refus de ces éditeurs était automatique. Personne chez eux n’avait jamais lu la moindre de mes lignes.
Selon le principe des vases communicants, la bouteille de Gin se vida dans le même temps que l’amertume me remplit.
J’étais comme un enfant qui apprend la non-existence du Père Noël. Avant cela, il me semblait que le milieu artistique et celui de l’édition en particulier étaient un monde intègre parce que tous les protagonistes savaient combien il est difficile de créer du rêve et de la réflexion. Mais en ce bas monde, où tout se monnaye, les dés se révélaient pipés comme partout.
On fabrique des stars pour diverses raisons. Le copinage en est une qui va bon train. L’appartenance à un clan ou à une confession aussi. D’un marginal insignifiant, dont le look importe plus que l’œuvre, on érige un exemple à coup de pub et de télévision. Certains vont même jusqu’à former, au travers de concours, les écrivains de demain comme d’autres le font déjà pour les chanteurs. Ont-ils conscience du mal qu’ils font à leurs concitoyens ?
Et que deviennent les gens comme moi ? Que font les éditeurs de ceux qui se battent pour donner le meilleur d’eux-mêmes ? Ceux qui ayant trop de respect pour elle, n’ont jamais trahi la littérature ? Ceux qui pensent que leur dignité est d’écrire et non pas d’aller faire le beau devant les caméras ?
Et bien ces gens-là crèvent de faim. Lâchés par ceux qu’ils ont fait vivre, puisque « édition » de nos jours n’a jamais autant rimé avec pognon.
En six mois, ils vous balancent un auteur soi-disant incontournable. En six mois, il est aussi vite oublié. Tant qu’on leur en présente, ils en usent. Des mémoires d’artistes préfabriqués, des adaptations de sitcoms débiles, des romans de comédiens bien meilleurs sur scène, des journalistes au vague à l’âme…
Ces éditeurs ont-ils oublié ce qu’était un livre ou un auteur « normal » c'est-à-dire quelqu’un dont le métier consiste à ne pas se foutre de la gueule du monde ? Que la réputation d’un écrivain se forge au fil de ses ouvrages ? Et qu’il faut prendre des risques pour que cela paye un jour ?
Et les lecteurs, s’est-on soucié de leur avis sur ces livres-poubelle ? Combien d’éditeurs en ont déjà pâti en terme de réputation ?
Je leur conseille de chiffrer tout cela sur le long terme. Ont-ils en mémoire l’histoire de la poule aux œufs d’or ?
– Vous savez Victor, elle serait encore meilleure cette tartine avec un peu de miel.
– Tout de suite, Monsieur.
– Ah, je revis moi ! Tiens, je vais peut-être faire deux ou trois lignes ce matin… Histoire de ne pas rouiller… Ça fait un bail que je n’ai rien écrit…
Je suis resté des mois à pleurer de l’intérieur. Je me suis souvent posé la question sur la nécessité d’une vie de frustration et d’incompréhension. Devrais-je, comme nombre de mes semblables, laisser mon cerveau à l’abandon pour supporter l’existence ?
J’étais désespéré.
Cette situation me rendait fou. La tristesse se lisait sur mon visage et dès lors que j’essayais de combler un auditoire comme je le faisais autrefois, j’avais la désagréable impression d’ennuyer le monde.
Un jour, quelqu’un me demanda : Que se passe-t-il ? On dirait que tu es devenu aigri !
Et comment ne pas l’être ? j’aurais aimé lui répondre. Mais afin de ne pas jouer l’incompris, je prétextai une maladie qui me minait.
Une maladie dont je taisais le nom : la reconnaissance.
Ai-je besoin de m’étaler et de vous faire vivre les mois d’enfer durant lesquels je survivais, aux aguets du moindre courrier ?
Je préfère ne pas revenir sur ces heures douloureuses mais plutôt vous parler du jour où la délivrance – du moins, je le croyais – arriva.
Ce jour-là, on eût dit que j’entamais une deuxième existence.
Enfin, un éditeur daigna s’intéresser à moi. D’accord, c’était un petit éditeur de province, mais j’avais perdu de ma superbe et puisqu’il acceptait de me récupérer en l’état…
Par ailleurs, je me suis rappelé les petites portes que l’on doit franchir avant d’aboutir à la grande. Aussi, mon éditeur me fit comprendre qu’il valait mieux être le roi chez soi que le valet chez les grands. Ce que j’interprétai comme : vous êtes un bon cheval, je vais bien vous driver et vous allez grimper sur les podiums. Dans quelques années, vous vendrez des milliers de bouquins.
Vous ai-je déjà parlé des Saints et du Bon Dieu ? Non ?
Tant mieux…
Sinon, j’aurais été contraint de revenir sur mes propos.
Lorsque je pus palper mon roman fraîchement sorti de chez l’imprimeur, j’eus comme l’impression d’avoir gagné le concours du meilleur ouvrier de France catégorie écrivain.
Mon livre était magnifique. La couverture était telle que je l’avais proposée, mon portrait trônait sur la quatrième, le papier était de qualité et la police bien adaptée à l’ensemble.
Mon bébé avait grandi. À présent, c’était un bel adulte. Bien fini, bien construit.
Enfin, je pus respirer l’air frais de la satisfaction. Les couleurs avaient repeuplé mes joues. Le Gin fut transformé en bières, moins agressives pour la réflexion et plus propices à ma restructuration post-dépressive.
Malheureusement, mon émerveillement ne dura pas très longtemps. En effet, j’ignorais que l’écriture d’un roman et sa publication étaient des étapes, certes nécessaires, mais quasi insignifiantes dans la vie commerciale de celui-ci. On peut résumer en disant que le roman étant sorti de l’imprimerie, tout le travail restait à faire !
Heureusement, il existe des gens payés pour distribuer le catalogue des éditeurs. On appelle cela « la distribution ».
Le seul problème, c’est que cette distribution est effectuée à 95 % par des gens possédant la plupart des grandes maisons d’édition. Le calcul était vite fait… Mon éditeur ne faisant pas parti de la grande famille, point de distribution pour mon roman !
En clair, les libraires pouvaient me vendre mais uniquement sur commande. Pas un exemplaire ne leur fut déposé ni pour se faire une idée de la qualité de mon texte, ni pour présenter aux lecteurs… renommés acheteurs dans ce cas précis.
Il aura fallu prier beaucoup, téléphoner beaucoup, se vendre beaucoup, et surtout y croire beaucoup pour contacter autant de monde que je l’ai fait. Il fallait que le plus grand nombre ait connaissance de l’existence de ce livre. Par miracle, j’arrivai à toucher la presse, quelques radios et aussi une télévision. Je fabriquai un site web où je me présentais. Je ne sais pas si mon éditeur eut conscience de tout cela. S’il a même remarqué la montagne que je déplaçais quand lui, de son côté, remuait à peine le petit doigt.
Ne parlons pas des libraires chez qui je tentais d’organiser un dépôt-vente trop fatigant pour eux car il fallait commander les livres chez l’éditeur et les gérer. C’est dingue, non, tout ce travail à faire ! ? ! Parce qu’aujourd’hui, il faut savoir qu’un libraire vend des livres parce qu’il n’a pas réussi à vendre du poisson. C’est un encaisseur de livres, c’est tout. Et il faut savoir aussi, que pour ce travail épuisant de quelques minutes, il touche trois fois plus d’argent que l’auteur qui en a bavé pour que son livre arrive dans les mains de ce petit commerçant.
Voilà, en pratique, comment cela se passe : le distributeur amène des bouquins qui doivent obligatoirement faire des best-sellers, alors le libraire vend ça et c’est tout. On lui dirait : tu vois l’étron que vient de faire ce chien devant ton magasin, et bien tu le mets en vitrine (en dégageant tous tes livres, là, qui ne servent à rien) et tu le vends, tu auras un bon pourcentage… qu’il le ferait.
Alors, pensez si c’est la peine de se fatiguer pour aider des auteurs même pas distribués ! !
C’était à crever sur place : même signé et publié, il m’était toujours interdit d’exister…
De frustration en frustration, je me suis vraiment rendu malade. Tout ceci est arrivé voilà pas mal d’années, pourtant j’ai toujours gardé au fond de moi un sentiment d’injustice. Pourquoi ceux qui fabriquent et qui vendent les livres ne les aiment-ils pas ? Je n’ai jamais pu répondre à cette question. Et c’est peut-être pour cela que je me suis réfugié dans la dépression.
Depuis, j’ai écrit quatre nouveaux romans. Mais, je refuse de les noyer dans l’eau sale d’un torrent commercial où j’irai mourir moi-même. À ne rien vendre, autant les laisser en paix, dans ma bibliothèque, aux côtés d’auteurs que j’estime. Dans mon imagination, je leur invente une vie. Une vie paisible, normale. La vie que devrait avoir n’importe quel livre si le système était bien pensé et les hommes moins corrompus.
– Vous pensez à quoi Victor ? Le miel dégouline sur vos mains. Allons, faites attention… Vous tachez la nappe.
– Je pense que j’ai raté ma vie Monsieur. Eh oui, je ne peux rien y faire… c’est obsessionnel, je pense encore à mes livres…
Monsieur fit une moue agacée…
– Mais enfin, Victor, que connaissez-vous de l’édition ? Vous l’imaginez encore comme mon grand père la voyait. Mais si j’étais comme vous et que je me soucie autant de mon lecteur, croyez-vous que je serais devenu millionnaire ? Aujourd’hui, vous savez bien, il suffit que je pète ou que je rote quelques mots pour que le monde applaudisse. Mes livres ne valent rien, je le sais. Mais je m’en moque, ils m’enrichissent. Oh, on peut parler du style… du contenu… Il est vide… ne cherchez pas. Et ils sont mal écrits, je vous l’accorde. Mais pourtant j’intéresse tous les éditeurs, ils se précipitent à ma porte parce qu’un jour j’ai pondu trois lignes qui ont choqué. Et savez-vous pourquoi, j’ai tenu si longtemps ? Parce que je suis doué pour faire de l’argent. C’est tout. Ça n’a rien à voir avec l’écriture. Je fais de l’argent. C’est ça l’écriture aujourd’hui… Ah, quel doux rêveur vous faites, mon pauvre Victor…
– Mais Monsieur… de tout ce que j’ai fait au cours de ma vie, rien n’a été plus important que l’écriture. Tout le temps, je me suis surpassé. J’ai écrit mes tripes, mes angoisses, mes joies, mes peines. Tout ce qui me constitue y est passé. Je n’ai rien gardé pour moi. J’ai tout donné. J’ai sacrifié mon temps, ma jeunesse, mes nuits. Mon cœur n’a vécu que pour cela. Et je puis le jurer : j’ai bien fait mon travail. Honnêtement, sans jamais léser mon lecteur quitte à y laisser des plumes. J’ai toujours voulu qu’on admire ma volonté d’écrire des textes qui font rêver, réfléchir et aident bon nombre d’entre nous à vivre. Je suis malheureux, je voudrais continuer à écrire…
– Allons, allons Victor… Vous vous emportez… Allez, je vais vous vomir deux phrases que vous allez taper… Vous allez vite comprendre comment tout cela fonctionne…
La tartine chatouillait trop mes doigts. En moins de temps qu’il n’en fallut pour le dire, je me suis levé et je l’ai envoyée avec beaucoup d’énergie dans la tronche de Monsieur.
– Au nom de la Littérature ! j’ai crié.
Sur ce, j’ai tourné les talons, abandonnant derrière moi ce représentant des « auteurs » modernes à son business. J’ai rendu mon tablier.
Et je me suis dit qu’un jour, un éditeur qui ferait bien son travail me donnerait peut-être ma chance…
Bibliographie de l’auteur
Romans policiers et de SF :
MORTELLE CAMPAGNE
Fragilisé par son divorce, Bruno Dumas quitte Paris et s'installe à la campagne où il espère de l'air pur et du calme pour se requinquer. Mais sa rencontre avec Paul Maurin, un handicapé assoiffé de vengeance, va compromettre ses projets. De parties d'échecs en parties d'échecs, les deux hommes se confient leur mal de vivre et décident bientôt d'un plan pour l'exorciser. L'été arrive et le petit village auparavant si tranquille est le théâtre de macabres découvertes. Dans une maison au fond du bois, un drame est en train de se nouer…
STRANGE MAGIC
Une invasion venue d'ailleurs, une piscine habitée par d'étonnantes créatures, une malédiction nichée au bord d'une route, les habitués d'un bar frappés par une curieuse maladie…
Voici quelques-uns des thèmes de ces nouvelles étranges et magiques qui vous feront rire… mais surtout frémir !
SÉRIE NOIRE SUR PELLICULE
Dijon, quelques jours avant Noël. Un criminel disperse des restes humains dans les lacs de la périphérie. Noblet, un flic du cru, est chargé de l'enquête. Pour démasquer le coupable, il profitera de l'expérience de Fouvreaux, fin limier de la Crime Parisienne envoyé en renfort. C'est dans cette atmosphère de fin d'année et de psychose que Mickey et Sébastien vont faire une étrange rencontre…
Disponibles chez tous les libraires sur commande et sur Internet (Alapage.fr, Auchan.fr, Fnac.com, Amazon.fr, Chapitre.com, etc.)
À propos de cette édition électronique
Auteur contemporain – Utilisation privée libre
Toute utilisation commerciale ou professionnelle est soumise à une demande
d’autorisation auprès de l’auteur
Édition par
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Novembre 2005
—
Coordonnées de l’auteur :
Fred Belin
N’hésitez pas à lui parler de votre lecture.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER
À FAIRE CONNAÎTRE
CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES